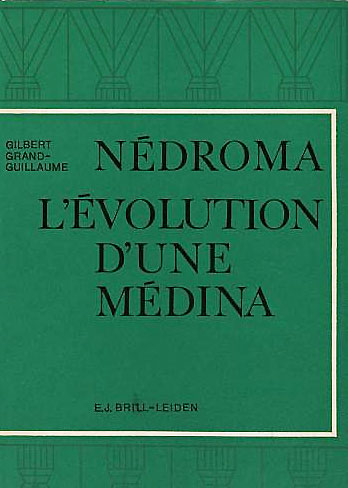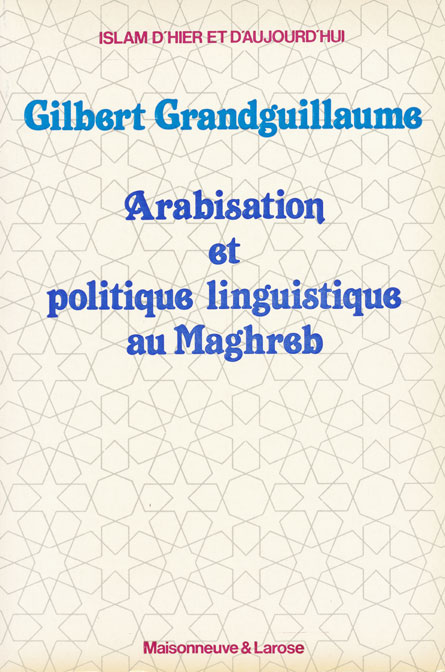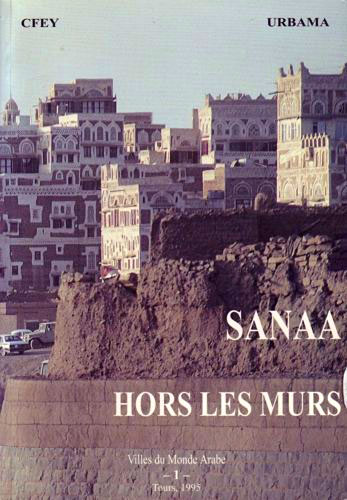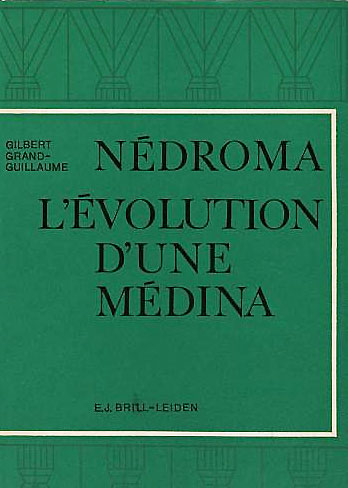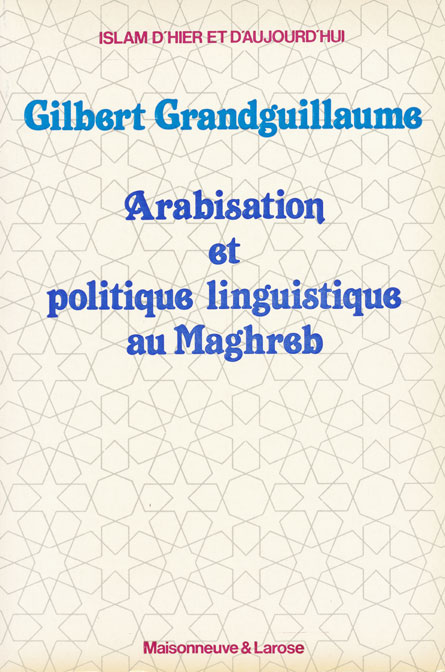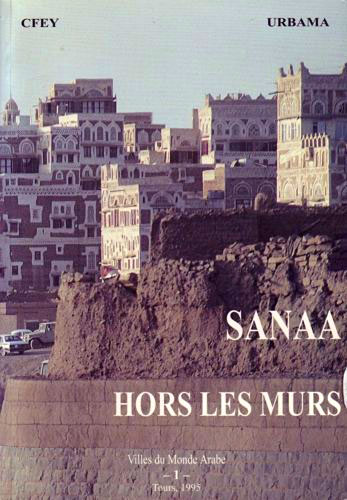|
Articles
| L'Algérie entre la violence et la loi |
Etudes 98.doc |
: Etudes, février 1998, pp.149-160
|
La situation dramatique que traverse l’Algérie suscite la stupéfaction de tous. Les Français, qui croyaient bien connaître ce pays, n’en reçoivent désormais qu’une information partielle, partiale, faite de rites électoraux surréalistes, et de massacres horribles. Les interprétations des spécialistes s’anéantissent à l’épreuve des faits. Expliquer en effet implique de donner un sens, alors que les éléments de la situation semblent échapper à toute rationalité : la contradiction s’est installée avec la violence. La population elle-même ne sait plus d’où viennent les coups, qui recherche quoi, où va l’Algérie en tant que nation. L’opinion publique française ne peut vivre ces événements dans l’indifférence, même si elle tente de les oublier : trop de liens ont été tissés entre les deux pays . Une vague conscience de “Nous avons fait l’Algérie”...à notre image empêche de voir “ce qu’elle est devenue”. La France découvre une autre Algérie, mais cette Algérie-là est-elle “elle-même” ?
La violence a envahi le champ, au point de mobiliser toute l’attention. Quelles perspectives se dessinent ? Le pouvoir en place, un pouvoir militaire qui s’est instauré depuis l’indépendance, sous le couvert de pouvoir civil d’abord, puis ouvertement depuis 1992, ne peut remporter une victoire décisive sur les islamistes ou dénommés tels : car la violence s’est tellement diluée qu’elle englobe, au-delà de maquis islamistes organisés, des groupes à l’identité douteuse, des milices armées par l’un ou l’autre camp, et se diffuse dans une anarchie généralisée. Le parti islamiste (Front Islamique du Salut) qui avait été frustré de sa victoire aux élections de 1991 n’a pu conserver longtemps le contrôle de l’action armée, qui a abouti à des Groupes Islamiques Armés (GIA) dont il se démarque : il a ainsi réduit ses chances d’accès au pouvoir par les urnes ou par la force. De cette situation incertaine, nul ne semble pressé de sortir : l’insécurité généralisée permet au pouvoir en place de procéder, sans risque de troubles, à la privatisation de l’économie, avec le chômage et la baisse de niveau de vie qu’elle entraîne. Cette même insécurité contraint les autorités à se donner une coloration musulmane, susceptible de les légitimer, en donnant des gages aux islamistes : elles instaurent ainsi le type de société que ceux-ci auraient édifiée ( moins les avantages du contrôle de l’économie et du pouvoir), mais en prétendant aux yeux du monde défendre les valeurs de la démocratie. Dans l’espace défini par l’anarchie, prenant appui sur ces deux bords, se développent les réseaux maffieux, où la délinquance met en place les forces occultes qui géreront l’Algérie de demain, où l’argent issu du pillage de l’Etat viendra rejoindre celui du racket pour édifier une société libérale.
Bilan pessimiste, qu’on souhaiterait faux. Il est pourtant important de comprendre que la fin de la violence ne réglera pas tous les problèmes de l’Algérie. Elle peut laisser la place à une violence plus radicale : celle qu’une société éprouve quand elle n’est pas régulée par la loi, quand elle ne peut pas vivre son identité par rapport à ce centre reconnu, lieu d’un consensus minimal qu’on nomme légitimité. La nation Algérie ne peut bien vivre que si elle se reconnaît dans le lieu symbolique du pouvoir. La tradition d’autrefois voulait qu’il émanât de Dieu ou de l’histoire, la pensée contemporaine la préfère comme émanant du peuple : mais elle ne peut en aucun cas être créée par l’exercice, même prolongé, de la violence : l’expérience coloniale de la France en Algérie est là pour en témoigner.
La violence par contre est destructrice de toute construction sociale. Elle naît de l’impossibilité d’accèder à l’humain, au niveau du sens, de la loi. Son émergence est corrélative de la carence de la loi, du droit. C’est pourquoi on s’étonne moins de la situation de l’Algérie si on réalise à quel point cette société a affronté, durant la colonisation et ensuite, le déni de droit. Elle l’a rencontré dans cette situation particulière où celui qui détient le pouvoir, par la force, se réclame d’une loi universelle et la bafoue dans son application : telle fut la situation de la France en Algérie, telle est celle du pouvoir qui l’a remplacée.
Il est question de loi, d’identité : mais de quelle loi s’agit-il ? Quand la France a envahi l’Algérie en 1830, ce pays n’était pas constitué en unité politique. C’est la France qui en a défini les frontières géographiques, les structures administratives. L’Algérie s’est constituée sur le modèle de la France, mais contre elle. Cette référence identitaire “en creux” s’est appuyée sur ce qui était le fondement concret de l’identité : l’appartenance tribale ou régionale, disons ethnique, et l’appartenance à l’Islam, qui a fonctionné comme référence identitaire principale (les Français d’Algérie s’étant attribués la qualité d’Algériens). La lutte nationale, arc-boutée sur l’Islam, devait aboutir à une identité nationale axée sur l’Etat reconnu : la crise actuelle a pour fondement principal l’incapacité du pouvoir en place à représenter cette référence identitaire nationale, renvoyant ainsi les Algériens à leurs identités ethniques et musulmane. Telles sont les principales étapes de ce processus qu’il faut rappeler maintenant.
La situation coloniale : violence et déni d’identité
La conquête française de l’Algérie , à partir de 1830, s’est heurtée à une forte résistance. Les tribus attaquées ne défendaient pas le régime de la Régence d’Alger, qui s’était d’ailleurs rapidement écroulé, mais leurs territoires, leurs biens, leurs personnes. En même temps, elles identifiaient les Français comme chrétiens, comme roumi, et leur combat était celui de musulmans contre une agression d’infidèles. C’est à ces racines identitaires, régionales et musulmanes, que la France s’est attaquée.
Au-delà des confiscations de terres, c’est la rupture du cadre social des tribus algériennes que les conquérants ont cherchée. Les chefs traditionnels, les grandes familles ont été soit mis à l’écart, soit maintenus dans leurs fonctions dans des conditions telles qu’elles les rendaient suspectes à leurs propres contribules. Le régime d’administration directe, militaire ou civile, a établi les populations dans des conditions de sujétion étroite : contrôle des réunions, des déplacements, impositions diverses, tout en les livrant à l’arbitraire de fonctionnaires locaux. L’administration avait une telle conscience de l’injustice de la situation qu’elle craignait sans cesse les révoltes, et en épiait les moindres signes précurseurs. Le moyen privilégié de maintenir son pouvoir était d’exercer sur les populations une terreur dissuasive, pratique codifiée dans de nombreux “traités” de théoriciens coloniaux.
L’ambiguité de la présence française, à la fois “civilisatrice” et répressive, devint plus manifeste avec l’installation d’une colonie de peuplement européen, qui eut pour seul souci d’étendre ses avantages aux dépens des “indigènes”, des “arabes”, des “musulmans” voués au plus profond mépris en tant que “barbares”. C’est à partir de cette minorité de “pieds-noirs” que, dès la fin du XIX° siècle, s’est constitué à Alger un véritable contre-pouvoir qui a tenu en échec toutes les initiatives, souvent humanitaires, en tout cas légalistes, venues du pouvoir en métropole. Un des “sommets” de cet arbitraire fut le fameux Code de l’indigénat, promulgué en 1882 après des années de discussion tant à Alger qu’à Paris, qui officialisait la discrimination entre les Français d’Algérie (qui se qualifiaient d’Algériens) et les habitants du pays, dits indigènes ou musulmans.
Il n’a pourtant pas manqué d’hommes lucides, associés au pouvoir en Algérie et en France, pour conseiller au gouvernement de Paris une politique conforme à ses idéaux républicains et civilisateurs. Si leurs efforts permirent de contenir les excès des colons, ils ne purent empêcher ceux-ci de noyauter régulièrement le pouvoir métropolitain et ses représentants en Algérie, rendant impossible, jusqu’à l’indépendance, toute réforme susceptible de procurer à ceux qu’ils appelaient “les indigènes” un cadre législatif et administratif respectant leur dignité d’hommes.
Parmi la minorité d’Algériens à qui le cadre colonial permit, avec l’accès à l’instruction, de jouir d’un certain crédit moral, il y eut des hommes courageux pour dénoncer non seulement l’injustice de cette politique, mais aussi sa nocivité aux intérêts de la France : celle-ci aurait eu intérêt à promouvoir, dans son sillage, une société équilibrée dans le respect du droit. C’est le cas, entre autres, de M’hammed Ben Rahhal (1858-1928). Originaire de Nédroma, de brillantes études lui permirent d’accéder à de hautes fonctions administratives puis représentatives (Délégué Financier). Egalement à l’aise dans la culture et la langue française et arabe, il fut souvent invité à conseiller des personnalités en Algérie et en France, où il rencontra les plus hautes autorités. Il est significatif de voir qu’un homme aussi intégré à la société française que pouvait l’être un Algérien de cette époque termina sa vie dans sa ville natale comme responsable d’une confrérie religieuse. Durant sa longue carrière il ne cessa de multiplier les avertissements : “Quand on rêve de s’annexer la moitié d’un continent, réduire l’indigène à la misère, même par la voie légale, n’est pas une politique ; le charger de tous les crimes n’est ni une justification ni une solution. Nous sommes de ceux qui croient qu’il n’est pas difficile de faire mieux. Mais il faut se hâter si l’on ne veut pas que toute réconciliation devienne impossible. Le vingtième siècle verra nécessairement une politique franco-musulmane mieux appropriée ou une catastrophe. Si l’Islam occidental africain ne se civilise pas par la France et pour la France, il se civilisera malgré elle et contre elle ”.
L’aveuglement de cette politique conduisit à refuser à la majorité des “indigènes” l’accès à la langue et à la culture françaises, de crainte de les voir s’émanciper. Un écrit colonial de 1897 l’énonçait clairement : “Notre langue n’est pas un instrument à mettre entre les mains de populations que l’on veut gouverner sans leur consentement. Quand vous les aurez familiarisés avec la Déclaration des Droits de l’homme, que leur répondrez-vous quand elles vous demanderont de leur en faire application ? Si vous cédez, c’en sera fait de la colonisation “.
Parallèlement à cette déstructuration sociale, l’autorité s’en prit aussi à l’islam, et à son support, l’enseignement de la langue arabe, par laquelle passait la formation religieuse. Cet enseignement, largement diffusé en Algérie avant la conquête, reposait matériellement sur un ensemble de fondations pieuses (dites habous), dont les revenus permettaient de rétribuer le enseignants, d’entretenir les édifices religieux et les écoles de premier ou de second degré. L’un des premiers gestes des conquérants fut de confisquer tous ces biens, en prétextant que l’Etat prendrait en charge les actions qu’ils supportaient. Ce fut évidemment loin d’être le cas. Cette asphyxie matérielle, jointe à la suspicion administrative, conduisit à la ruine cet enseignement. On ne peut apprécier la gravité de cette situation que si, dépassant son aspect strictement religieux, on réalise le rôle de cette référence musulmane dans l’identité des habitants : c’était la seule qui leur restait, et elle se trouvait effectivement persécutée, en dépit de quelques déclarations officielles utilisées, de plus ou moins bonne foi, pour donner le change.
C’est à partir de la conscience musulmane que se répandit en Algérie, à partir des années trente, un mouvement de renaissance religieuse, animé par Abdelhamid Ben Badis . Il voulut contribuer, par des ressources propres, au renouveau de l’enseignement de l’islam et de la langue arabe, en fondant des écoles et en formant des maîtres prédicateurs. Sans aller jusqu’à la revendication d’indépendance, ce mouvement voulait fournir à l’identité algérienne le fondement qu’elle ne pouvait trouver que dans l’islam. C’est à la même époque que virent le jour des partis politiques, les uns réformistes, tels les Jeunes Algériens, animé par Ferhat Abbas, d’autres plus radicaux, tels le PPA (Parti du Peuple Algérien) fondé par Messali Hadj .
A tous ces interlocuteurs possibles, l’administration coloniale ne répondit que par la violence et la répression, interdisant les partis, incarcérant leurs dirigeants, faisant peser sur tous ceux qui pouvaient être taxés de musulmans ou de nationalistes le poids d’une répression aveugle. Il faut citer ici, pour sa valeur hautement symbolique, la journée du 8 mai 1945. Alors que la métropole célébrait dans la joie sa libération et son retour à la liberté, l’administration coloniale ne trouvait rien de mieux que de répondre à des provocations par des massacres qui durèrent plusieurs jours. Cette journée consacrait le divorce entre une France qui affirmait des principes sans avoir le courage de les imposer, une minorité de colons décidée à tout pour défendre ses privilèges, et une majorité d’Algériens qui savait qu’il n’y avait plus rien à attendre de ce côté. L’effacement de la loi laissait le champ libre à la violence.
La guerre de libération
C’est en novembre 1954 que se déclenche la lutte d’indépendance, sur l’initiative d’un groupement politique, le Front de Libération Nationale, qui va s’imposer comme le représentant unique du peuple algérien. De ce fait il mènera sa lutte non seulement contre la France, son armée, son administration, mais aussi contre les autres partis concurrents qui ne se rallient pas à lui, et contre la fraction de la population qui soit collaborerait avec l’occupant, soit serait peu encline à participer à l’effort de guerre. La période 1954-1962 est donc une période de grande violence. Celle d’un camp appelle celle de l’autre. Le cycle de l’agression et de la répression entraîne tant les Français que les Algériens au mépris des droits de l’homme : un chef de groupe s’arroge le droit de vie et de mort sur d’autres hommes. A l’insécurité généralisée s’ajoutent les perturbations liées aux mouvements de populations : des zones interdites vers les camps de regroupement, des campagnes dangereuses vers les villes protégées, C’est pourtant dans ce climat de violence que réussit à s’imposer peu à peu l’idéal d’une Algérie nation. Même si, pour une large partie de la population, cette lutte est une lutte “pour l’Islam” contre les impies, même si pour d’autres elle se résume à l’espoir de prendre la place des colons (leurs terres, leurs maisons, leurs usines), l’idée se fait jour de recouvrer une patrie, de ne plus être étranger, humilié, sur son propre sol. On ne saurait accorder trop d’importance, eu égard à ce qui s’est passé par la suite, à cette soif de dignité que comportait pour les Algériens l’accès à l’indépendance, un désir d’être reconnu comme homme, avec ses droits. La violence de la guerre de libération pouvait être supportée, voire trouver sens, dans cette perspective.
La période de l’indépendance
La population qui fêtait l’indépendance dans les premiers jours de juillet 1962 ignorait que les chefs du pays libéré s’étaient déjà affrontés pour le pouvoir durant la guerre . Pour elle, la France avait reconnu l’Algérie comme pays indépendant, l’Algérie deviendrait un pays comme la France, avec des lois, une constitution, des élections, des partis, des syndicats. Elle ne tarda pas à constater qu’elle était régie par un régime arbitraire, soucieux de conserver son propre pouvoir et de ne le voir contesté par personne. Les chefs surent bien expliquer que la situation du pays était fragile, qu’il était entouré d’ennemis qui voulaient sa perte : bref ils continuèrent de tenir le langage de la guerre pour faire considérer comme légitime un pouvoir qu’ils ne souhaitaient pas détenir du peuple. Le modèle de la “démocratie populaire” servi d’alibi à la réalité de la dictature. Le socialisme servit de masque à l’étatisme bureaucratique. Même si l’exaltation facile du chauvinisme, des gloires nationales, de quelques succès diplomatiques put pendant un temps rallier au régime une bonne partie de l’opinion, la majorité de celle-ci ne fut pas dupe. Elle le supporta tant que les facilités de l’économie pétrolière purent faire espérer la réussite économique et le succès du développement. Cependant les causes de la destruction de ce qui était en germe dans la lutte pour l’indépendance, la naissance d’une patrie pour tous, étaient en place dès l’été 1962, et ne firent que s’accentuer avec les années . Cela commença par le spectacle des “cadres” empressés à se servir eux-mêmes au lieu de servir la nation, par le constat que la solidarité nationale cédait le pas aux combinaisons régionales ou claniques. Au sommet de l’Etat le souci de conserver le pouvoir à tout prix, y compris le coup de force (en 1962, puis en 1965), de le protéger par une police secrète omniprésente, se traduisit par l’encadrement autocratique de la population : parti unique, syndicat unique, pas de liberté d’association ni de liberté de presse, instauration de la “langue de bois” à tous les niveaux de la société. Il n’est pas question ici de dire que rien ne fut fait pour le pays : développement de l’enseignement, création d’usines, d’hôpitaux : mais ce qui fut fait le fut dans une optique paternaliste qui tint la société à l’écart de sa propre gestion, au lieu de l’y associer, comme le prétendaient les slogans autogestionnaires. Aux regards de l’opinion internationale, cette dictature militaire se présentait comme le champion de la lutte anti-impérialiste, réfutant à l’avance toute critique par un nationalisme ombrageux et se targuant d’incarner un peuple héroïque qui avait conquis son indépendance au prix d’”un million et demi de martyrs” .
Connaissant la fragilité de sa légitimité propre, le régime a été conduit à en rechercher des éléments dans les références identitaires de la société algérienne : l’opposition à la France, et l’islam.
Le premier se basait sur le recours au discours de la guerre dès qu’une opposition interne se manifestait ou qu’une critique externe surgissait : c’est le fameux thème de “la main de l’étranger” qui, comme un refrain lancinant, est venu ponctuer chaque crise traversée par le régime. Il permettait de culpabiliser, en la qualifiant de traître ou “parti français”, tout opposition à velléité démocratique. Le contenu positif à donner à cette référence eut été de réussir le développement. Sous l’aspect économique, il y eut d’abord une phase d’expansion, qui retomba bientôt, dans les années 80, au point d’entrainer un rejet de l’Etat dont profita le mouvement islamiste. Sous l’aspect social et humain, le développement fut nul, l’étouffement des libertés ne pouvant qu’en provoquer l’échec.
Du côté de l’islam, où le peuple algérien voyait la source de toute légitimité, l’action du pouvoir fut démagogique et opportuniste. Par diverses mesures, il tenta de se créditer d’une légitimité islamique. La politique d’arabisation, par laquelle il substitua l’usage de la langue arabe classique à celle du français dans les domaines de l’enseignement, de l’administration et de l’environnement , outre ses aspects sociaux et culturels, fut politiquement destinée à donner au pouvoir le rôle de protecteur de l’islam par langue arabe interposée. Cette mesure, dont une réalisation raisonnable eut été justifiée, fut habillée des slogans habituels : assurer la face culturelle de l’indépendance. Elle n’aboutit en fait qu’à déstructurer l’enseignement et à faire le lit de l’islamisme. D’autres mesures, tout aussi démagogiques, allèrent dans le même sens. Retenons seulement ici le Code de la Famille - promulgué en 1984, toujours en vigueur à ce jour - qui, flattant les tendances machistes de la société mâle, enferme la femme dans un statut de mineure perpétuelle sous prétexte de loi musulmane (chari’a)
La mauvaise gestion du pays avait laissé émerger des problèmes cruciaux : crise du logement, de l’emploi, de la production agricole, manque d’eau, pénuries chroniques, croissance démographique incontrôlée. Les grandes villes du pays étaient ceinturées de banlieues populaires abandonnées à elles-mêmes. L’étalement des fortunes mal acquises, la corruption affichée au sommet de l’Etat aboutirent à un état de tension extrême, éclatant parfois en émeutes (Constantine, Sétif, Oran, Alger), et donnèrent à la majorité de la population le sentiment d’être l’objet, de la part du pouvoir indépendant, du même mépris (hogra) que de la part des colons d’autrefois. Le pouvoir, qui avait cru en favorisant des tendances islamiques, en tirer une légitimité vit celle-ci lui échapper à leur profit : le succès du Front Islamique du Salut aux élections communales de 1990 et législatives de 1991 fut du en grande partie à la façon dont il sut tirer profit de ce rejet massif du pouvoir étatique. La réaction de la hiérarchie militaire, interrompant le processus électoral et déclenchant une violente répression sur le parti vainqueur fit entrer le pays dans le nouveau cycle de violences où il se débat encore aujourd’hui.
Pour l’Algérie en tant que nation, la situation est revenue au point de départ : l’expression “seconde guerre d’Algérie” , souvent employée pour décrire la crise actuelle, exprime le fait que la population algérienne, plus de trente ans après son accession à l’indépendance, en est toujours à chercher à se soustraire à un pouvoir considéré comme illégitime, et à souhaiter la mise en place de ce lieu de consensus minimal à partir duquel pourra se construire la nation algérienne : le lieu de la Loi par référence auquel chaque citoyen se percevra algérien.
Questions sur une violence de longue durée
La violence d’aujourd’hui apparaît plus effrayante parce qu’elle traduit une désintégration toujours plus profonde du lien social, une situation proche de la guerre civile, où plus aucune règle ne vient tempérer l’usage de la violence comme moyen de régler les conflits. Le pouvoir en place en renvoie toute la responsabilité sur les islamistes, et se présente comme le rempart des libertés dans ce pays. Tout ce qui précède montre au contraire que la violence est apparue en Algérie depuis longtemps, comme un déni de droit, une carence de loi. Aucune reconstruction ne peut être valable si elle ne prend pas les choses à ce point.
Cette longue histoire de la violence n’a pas pour but d’établir des responsabilités, de générer des culpabilités. Le problème est de tenter d’en comprendre la source . Peu de sociétés ont été malmenées de la sorte, avant même de pouvoir prendre conscience du lien qui les soudaient. La voie concrète de la prise de conscience d’elle-même s’est faite pour l’Algérie dans le cadre de la colonisation, mais dans un cadre qui la niait en même temps. L’injonction contradictoire (“fais” et “ne fais pas”) rend les enfants fous. Le pouvoir colonial disait à l’Algérie : “sois” et “ne sois pas”. A ces dérèglements radicaux la société algérienne avait pu faire face pour aboutir à l’indépendance, mais ce fut pour retomber très vite sous l’emprise d’un pouvoir tout aussi méprisant et peu soucieux des intérêts supérieurs du pays.
L’Algérie est un pays d’une grande diversité. L’immensité du territoire inclut des populations ethniquement, culturellement et linguistiquement différentes. Par rapport à l’islam, un dénominateur commun recouvre des croyances, des pratiques, des opinions très variées. Le rapport au monde moderne est vécu différemment dans les zones rurales et urbaines, dans le Sud et le Nord du pays. La condition minimale de l’adhésion de tous à la communauté nationale est que chaque différence s’y sente reconnue, acceptée : sinon elle se trouve renvoyée à la négation de soi qui a marqué l’Algérie depuis si longtemps. L’idéal est même que chacun sente que la communauté a besoin de lui tel qu’il est : condition particulièrement difficile à réaliser dans un pays où l’Etat tire 95% de ses ressources du pétrole.
Cette diversité est-elle un handicap ou un avantage ? L’Algérie a hérité de la France le jacobinisme centralisateur, qui tend à ressentir chaque différence comme une menace pour l’unité nationale, à la vivre dans un phantasme de dislocation. Cette expérience a été vécue par la France dans une période de fragilisation du pouvoir central. D’autres pays considèrent au contraire cette diversité comme une richesse. Ce devrait être le cas pour l’Algérie, mais cela suppose deux conditions. La première est que la légitimité au sommet de l’Etat représente un consensus si fortement reconnu qu’il soit à même de bannir tout risque d’éclatement de la société, toute peur de la division. La seconde est que les diversités puissent se rencontrer, s’affronter, dans des lieux où les conflits pourront être résolus selon des règles, selon la loi reconnue par tous. La vieille sagesse du Maghreb et d’Afrique a depuis longtemps valorisé les vertus de la palabre. La parole échangée ne sert pas seulement à exprimer les conflits, elle les transforme et les déplace de leur lieu d’origine, celui de la violence, de la peur, de la négation de l’autre, à un autre lieu qui est celui du sens, du rationnel, de l’humain. Elle saisit les archaïsmes dont se nourrit la peur et les expose à la lumière de l’échange pour en constituer du lien social . Parler de démocratie en Algérie, pour mettre fin à la violence, ce n’est pas organiser n’importe quelle élection, c’est mettre en place, à tous les niveaux, de l’école aux partis, en passant par les professions, la gestion de la vie publique, les structures qui permettront cet apprentissage de l’échange par la parole, seul moyen de garantir la dignité de l’individu et de la société. C'est dans un climat totalement différent qu’a vécu l’Algérie jusqu’à présent : l’unanimisme obligatoire des opinions, des croyances , des pratiques, des modes de vie a engendré l’intolérance et la violence jusqu’à ce point extrême où nous les voyons aujourd’hui.
|
|
|