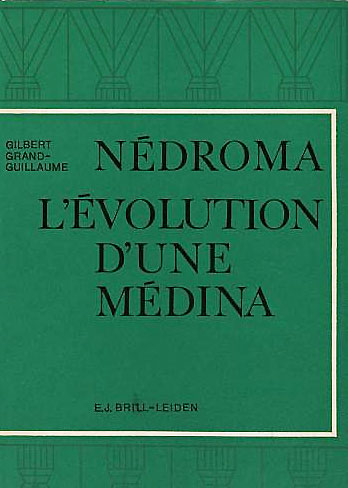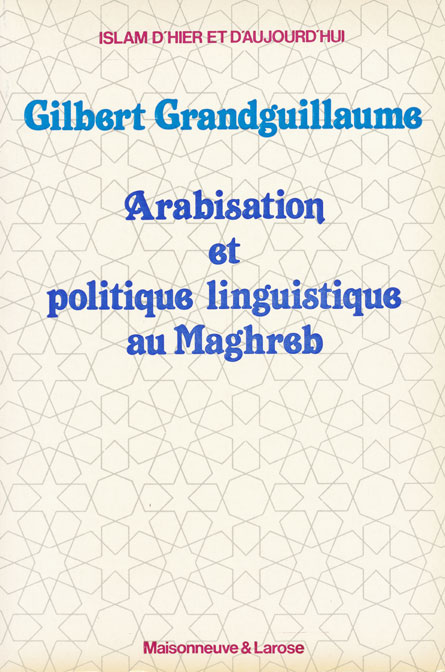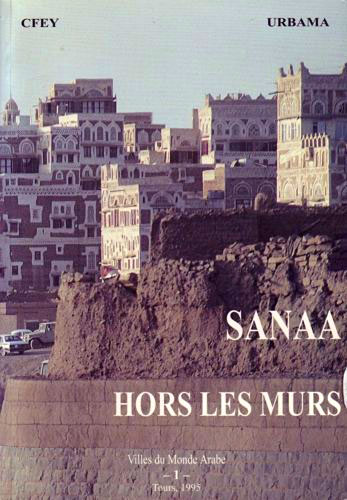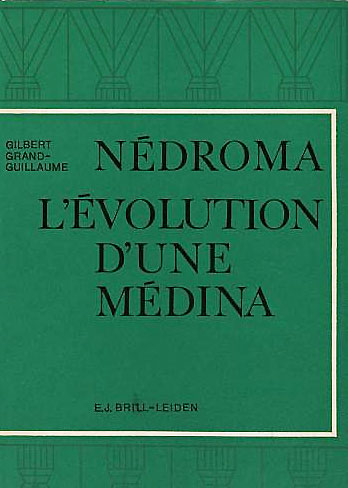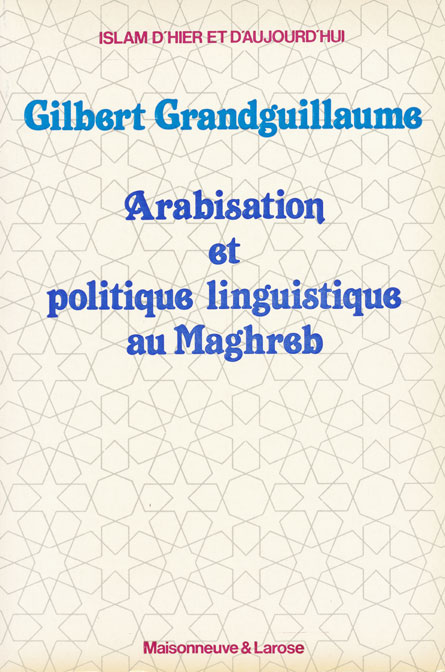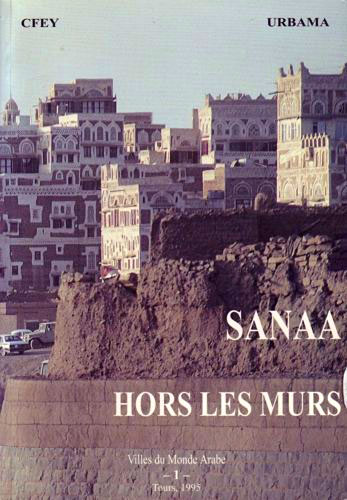|
Articles
| Comment a-t-on pu en arriver là ? |
. |
Esprit, Avec l’Algérie, N°1, janvier 1995, p.12-34 ; : Les violences en Algérie, Editions Odile Jacob, coll. Opus, 1998, p.7-59
|
Devant l’évolution tragique de la situation en Algérie, une sorte de stupéfaction s’est emparée de l’opinion publique : comment a-t-on pu en arriver là ? Une explication est dès lors présente dans tous les esprits : c’est l’islamisme qui a conduit l’Algérie dans cet état de décomposition où nous la voyons aujourd’hui. L’empressement à se rallier à cette “explication” est ce qui fait problème : outre qu’elle satisfait trop de bons esprits, elle n’est pas loin de faire la jonction avec les tendances xénophobes qui sommeillent au cœur de la société, dans une dénonciation facile : les Arabes, les musulmans, les étrangers...
Dans la multiplicité des écrits qui abordent la “question algérienne” - toujours posée après plus de trente ans -, ce numéro voudrait tenter de dépasser les analyses sommaires pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette société, et ce qui se passe entre elle et la nôtre. Tenter du moins de poser les questions qui sont habituellement mises de côté.
Un constat initial s’impose : en Algérie, tout n’a pas commencé cette année, ni en 1991, ni en 1988, ni avec l’émergence du mouvement islamiste. Les faits qui ont entraîné la situation actuelle sont bien antérieurs. Seulement, il était de bon ton de ne pas les voir. L’Algérie était devenue indépendante en 1962, la question était désormais sacrée : respecter la souveraineté des nations, ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures, assumer notre culpabilité dans la colonisation et la guerre d’indépendance. Pendant des années, surtout à gauche et chez les libéraux, il n’a pas été possible d’aller au-delà. Et pourtant....
Qu’en était -il depuis le début de ces questions qui nous paraissent à juste titre si importantes aujourd’hui : la démocratie ? les droits de l’homme ? les libertés publiques ? la liberté d’expression ? la liberté de se réunir, de s’organiser en association, en syndicats ?
Le problème ici, dans ce numéro, n’est pas d’engager des procès en responsabilité, de réveiller les culpabilités toujours latentes et dont certains savent si bien jouer à l’occasion. Il est certain que l’Algérie vit en ce moment une phase de mutation importante, sans doute plus radicale que jamais. Que des processus longtemps refoulés tendent à émerger. Il est d’autant plus important de ne pas se laisser aveugler par les soubresauts de l’actualité que soulignent les médias, pour accéder enfin à cette vérité capitale : il existe une Algérie différente de la France, qui n’est pas “notre Algérie”, mais qui demande à être reconnue. Pour éviter toute ambiguïté dès le départ, je dirai que je n’entends pas par là une Algérie islamiste, ni une Algérie “démocrate”, je dis tout simplement : ce pays qui est l’Algérie.
L’effort de ce numéro est donc avant tout un effort de lucidité, de compréhension, conduit avec bienveillance, mais qui est conscient de la nécessité de prendre des distances même par rapport à ces attitudes d’esprit qu’engendre “l’amitié”. Cela est bien entendu lié à la conviction que, aujourd’hui, sont à dire des choses qui n’ont pas été dites, à effectuer des constats qui n’ont pas été faits. Un effort de redécouverte de l’Algérie s’impose, une reconnaissance en soi de ce partenaire, afin de ne pas renouveler indéfiniment les erreurs du passé, d’autant plus regrettables qu’elles sont généralement construites sur le sable de la bonne intention, de la bonne volonté. Le but de tout cela est bien entendu d’espérer poser les jalons d’une relation toujours privilégiée, mais avec un autre que nous-mêmes, de poser les jalons d’une reconstruction.
L’heure de la violence
Certes, en ces temps-ci, la violence semble avoir submergé toute réflexion, toute initiative, tout projet. Il ne faudrait plus que parler d’elle, entend-on, c’est le problème à régler avant tout. Oui. Mais d’où vient cette violence ? Est-elle seulement, principalement, celle des kalachnikov qui exécutent dans la nuit, ou aussi, et plus profondément, celle que subit une société sans loi pour se structurer, sans repère auquel s’identifier, sans objet à qui attribuer sa foi, une société déniée en soi, méprisée, trompée en permanence sur ce qu’elle est, sur ce qu’elle sent être : une société qui n’arrive pas à exister telle qu’elle est définie officiellement, parce qu’une vérité sur elle-même lui est constamment refusée ? Dans une telle situation, la violence vient prendre tout naturellement la place de la loi. Il y a eu pendant un certain temps une violence officielle, étatique, reconnue : celle de la colonisation, puis celle de l’Etat indépendant. Il y a aujourd’hui la violence qui conteste l’Etat, qui provoque la réaction de celui-ci, mais aussi qui se diffuse dans tout le corps social, en subvertissant peu à peu les liens sociaux antérieurs, récents ou anciens.
C’est l’inventaire de tous ces problèmes non-résolus, souvent même pas posés, que voudrait initier ce numéro. Il n’y suffira évidemment pas, mais il faut entreprendre cette tâche. C’est le constat d’une Algérie qui n’a pas pu prendre possession d’elle-même qu’il faut envisager. L’ayant constaté, il faudra poser la question de la légitimité, de la loi affichée et de la loi pratiquée, tenter de retrouver les mécanismes profonds de cette société. Enfin, c’est la question de la relation avec la France qui doit être réexaminée : la France voit-elle en l’Algérie un autre elle-même, ou peut-elle la reconnaître différente ? A tous ces problèmes, la réponse rapide est facile, la position officielle est toujours claire, la bonne intention est parfaite, mais qu’en est-il réellement, que nous apprennent les pratiques ?
Une Algérie qui n’a pas pris possession de soi
A la suite d’un séjour prolongé que j’ai effectué en Algérie, je garde l’impression d’une société qui ne s’est pas autorisée à être elle-même. C’est ce que je voudrais expliquer maintenant, mais, pour le faire comprendre d’emblée, j’invente un petit apologue : “ Une famille algérienne de paysans, qui vivait depuis des générations sur le domaine possédé par un colon, a, à la suite de la libération, pris possession de sa terre. Elle est maintenant chez elle dans tous ces beaux bâtiments, mais le colon est toujours là : discret - il ne dit rien -, il n’intervient en rien, il serait même sympathique, mais il est là : de ce fait, on n’ose pas parler arabe, on n’ose pas manger avec les doigts, on n’ose pas abattre certains hangars, on n’ose pas faire d’autres cultures, on n’a pas l’idée de faire autrement qu’il ne faisait, on n’ose pas pratiquer certaines magies, on fait ses prières discrètement. Bref, apparemment, il n’est pas gênant, mais si un jour ce regard permanent s’absentait pour de bon, quel soulagement : c’est seulement à ce moment qu’on se sentirait chez soi, en Algérie...”
Pour continuer le même apologue : “ Au début, le colon était seul “hôte”. Puis, quelque temps après, des Algériens sont venus, habillés comme lui : costumes, cravates, parlant français, buvant de l’alcool, gens d’autorité. Envoyés par le baylek 1 pour contrôler la gestion des comptes et assurer la direction des domaines des colons, ils sont certes des Algériens, mais très ressemblants aux Français. Au début, ils étaient simplement désagréables parce qu’étrangers à la région et agents d’une autorité externe. Puis on s’est aperçu qu’ils profitaient de leur position pour être arrogants, pour détourner des fonds, pour s’octroyer des avantages, sans par ailleurs compenser ces inconvénients par une compétence particulière. C’était bien le gouvernement de l’indépendance, mais cette famille ne se sentait toujours pas chez elle. De plus, ils représentaient un modèle étrange : était-ce cela l’Algérien nouveau?”
Mon impression dominante était celle-ci : l’Algérie ne pourrait-elle souffler un peu, ne pourrait-elle parler sa langue, pratiquer ses coutumes sans que quelqu’un parle de “sciences”, de développement, de codes nécessairement sentis comme étrangers ? C’est comme si cette société n’avait jamais pu se sentir chez elle dans son propre pays. Pour le préciser, il suffit de passer en revue certains secteurs tels que l’élaboration des lois, l’histoire, l’économie, le paysage et surtout la langue : tous secteurs où il apparaît nettement que l’on n’ose pas - ou que l’on ne se reconnaît pas le droit - de “faire algérien”.
La fabrication des lois.
Il y a quelques années à Alger, à un repas officiel, un expert français, se trouvant à côté d’homologues algériens, leur fait part de son étonnement. Il vient de voir la loi que le gouvernement a promulguée sur l’environnement. Cette loi reprend mot pour mot une loi française récente. Or, dit l’expert français, cette loi n’est déjà pas applicable en France parce qu’elle devance trop les mentalités. Pourquoi en Algérie n’avoir pas fait une loi adaptée, qui prenne en compte les urgences, qui ne sont pas celles de la France. La représentante de l’Ambassade est naturellement offusquée qu’un Français de passage vienne tenir de tels propos : que peut-on faire de mieux que d’imiter la France au plus près ?
Dans la contribution à ce numéro qu’il consacre à la langue, Mohamed Benrabah cite une conséquence cocasse de ce suivisme : s’inspirant d’une loi française de 1975 “ sur l’emploi de la langue française”, destinée à contrecarrer les “invasions anglo-américaines”, M. Naït Belkacem propose une loi identique contre l’invasion culturelle du français, et ce faisant, il ne trouve pas mieux que de “brandir la loi française en appelant à faire de même !” 2
Je n’ai pas fait d’inventaire exhaustif de la question - cela ne manquerait pas d’intérêt -, mais il m’a été dit de plusieurs côtés que les lois algériennes étaient souvent des reprises textuelles des lois françaises. Cela s’ajoute naturellement à la disposition qui, en 1962, a repris au compte de l’Algérie l’ensemble de la législation française, hormis ce qui contrevenait à la souveraineté et à l’islam. 3
L’enseignement de l’histoire
Dans l’étude qu’il a consacrée à cette question, Hassan Remaoun 4 montre la faible part tenue par l’enseignement de l’histoire spécifique de l’Algérie dans les programmes élaborés pour les jeunes Algériens. Ceux-ci reçoivent une information plus importante sur les Etats arabes du Moyen-Orient que sur leur propre pays. L’analyse des manuels scolaires d’histoire révèle que le référent Algérie s’y situe autour de 8% du programme, la référence au monde arabo-islamique comme cadre identitaire global s’y situant par contre aux environs de 75%...
L’économie
Dans l’article qu’elle consacre à l’économie dans ce numéro, Lucile Provost 5 montre comment l’économie est demeurée un secteur externe à la réalité algérienne, principalement par le fait qu’il se fonde sur une ressource privilégiée, le pétrole, qui est un “artefact” dans la culture algérienne, qui ne met en cause ni l’histoire, ni le travail, ni le génie de la société algérienne.
En un domaine où il s’imposait de mettre une marque nouvelle sur une réalité du terroir, l’organisation “socialiste” - en fait bureaucratique - de l’économie algérienne n’a fait que copier les pratiques des régimes collectivistes, en laissant totalement de coté la culture algérienne.
Les paysages
Quiconque parcourt les plaines de la Mitidja ou de l’Oranie est frappé de voir les vestiges des grandes exploitations coloniales d’avant 1962. Elles sont encore là telles quelles, comme si elles attendaient le retour de leurs anciens occupants. Seules ces propriétés sont plantées de palmiers. Les caves vinicoles, les hangars, les entrepôts, les bâtiments d’habitation sont restés tels qu’ils étaient. Quelquefois de nouveaux bâtiments ont surgi à côté, mais n’ont jamais été intégrés aux bâtiments coloniaux. Devant ce spectacle, à vrai dire assez émouvant pour le Français que je suis, je ne savais que penser : a-t-on voulu conserver une marque, préserver un lien, ou bien au contraire n’a-t-on pas osé “y toucher”, comme s’il y avait là quelque interdit ?
La vue du paysage urbain, ces innombrables villas construites à Alger ou partout, sans goût particulier, sans recherche de plan, par simple accumulation de briques et de béton, laisse perplexe. Comment peut-on construire dans un pays où des étrangers ont fortement marqué leur empreinte, sans être tenté de mettre la sienne propre? A l’opposé, un désintérêt total est marqué à ce qui incarnait une culture nationale. Les beaux villages de Kabylie sont défigurés par les entassements de béton qui les dominent. Et que dire de la Casbah d’Alger, seul témoin d’une période où Alger fut souveraine, où la désintégration de ces belles constructions n’est souvent stoppée que par des restaurations qui les défigurent, et cela sans qu’aucune autorité responsable ne veuille s’en soucier, alors même que cette Casbah a été promue patrimoine mondial par l’Unesco en 1993.
Dans un article qu’il avait consacré à ce sujet, Marc Côte montrait comment l’Algérie avait, en ce domaine, préféré à la filiation à sa propre organisation de l’espace un affrontement à la société coloniale, quitte à brutaliser son propre espace, et il continuait : “Les Algériens ne se reconnaissent pas dans ces maisons, ces grands ensembles, ces macro-exploitations , ces villes, qui depuis vingt ans ont été construits pour eux, mais en dehors d’eux. Ils ne se sentent pas à l’aise dans ce nouvel espace. Comme l’on dit de quelqu’un qu’il est “mal dans sa peau”, l’on peut dire que les Algériens sont “mal dans leur espace”. Il y a désormais quelque chose de cassé entre la société algérienne et son espace.” 6
Dans l’article qu’il consacre dans ce numéro à l’architecture en Algérie, Abdenour Djellouli 7 nous montre l’étendue de cette non-prise en charge par l’Algérie de ses paysages, qui sont à la fois beaux et abandonnés.
La langue
S’il est un domaine typique de la situation ici décrite, c’est bien celui de la langue. Quelles sont les langues de l’Algérie ? Avant la colonisation, les langues parlées étaient berbères ou arabes (dites dialectes). Il y avait une langue écrite, l’arabe classique, langue du Coran, qui fut pour ainsi dire mis en veilleuse durant la colonisation : ce qui l’a empêché d’évoluer, et de passer dans le domaine des utilisations modernes, comme ce fut le cas au Moyen-Orient. Durant la colonisation, la France a imposé sa langue. Elle ne l’a certes pas tellement répandue dans la population, du fait du faible taux de scolarisation. Mais le français a été la langue officielle de l’administration, et du service public. Lors de l’accession à l’indépendance en 1962, la situation était celle d’une large prédominance de la langue française. A coté, en face, comme marque algérienne, il y avait la réalité des langues parlées, arabes ou berbères.
Que fallait-il faire ? Il était évident qu’il fallait restaurer la langue arabe écrite, pour restaurer par là une référence historique et culturelle, sinon religieuse. La question était de faire aimer une origine. Il s’y ajoutait une pression des pays du Moyen-Orient, pressés de faire rentrer l’Algérie dans la grande famille des pays arabes, après cette longue colonisation. Enfin émergeait la nécessité de s’affirmer différent de la France, d’être indépendant, voire même par là de faire intérioriser un transfert de légitimité.
Face à cela, qu’a-t-on fait ? Les pouvoirs en place ont imposé la langue arabe écrite, l’ont confondue avec une langue orale. Au lieu de s’en servir pour faire aimer une tradition spécifique, ils l’ont utilisée pour traduire le français, pour faire dire péniblement en arabe ce que chacun savait mieux dire en français. Bien plus, ils s’en sont servi pour tenter de légitimer (en arabe) le pouvoir qu’ils détenaient du droit de succession coloniale (en français).
Le plus grave - par rapport à ce qui me préoccupe ici, à savoir la prise de conscience par les Algériens de leur algérianité - est que cette politique d’arabisation s’est réalisée dans un mépris total de la responsabilité politique et dans une hypocrisie flagrante. Lors d’un conseil des ministres des années 60, Ahmed Taleb Ibrahimi, alors ministre de l’Education nationale, avait dit à propos de l’arabisation :”Cela ne marchera pas, mais il faut le faire...”, phrase qui lui fut objectée par Mostefa Lacheraf, ministre de l’Enseignement primaire et secondaire en 1977, lorsque son prédécesseur lui reprochera son manque de ferveur pour l’arabisation. Dans un contexte où le gouvernement imposait une politique d’arabisation, la plupart des personnalités et des hauts cadres de l’Etat tentaient d’y faire échapper leurs propres enfants. Dans le choix même des matières à arabiser, on plaçait en premier lieu celles qui étaient le moins valorisées : sciences humaines, philosophie, tandis qu’on ne touchera qu’en dernier ressort aux sciences exactes, à la médecine, au droit. D’une façon plus large encore, si l’exigence d’arabisation s’est imposée à l’enseignement et aux degrés inférieurs de l’administration, l’économie et les secteurs de pointe y ont échappé presque totalement. La signification de ces observations ressort d’elle-même : à travers ces pratiques, soi-disant nationalistes, c’est un mépris de la langue arabe et de la culture qui s’y rapporte qui a été affiché, alors que le dénigrement du français, à visée purement politique, s’accompagnait de la valorisation sociale de ceux pour qui il constituait le fondement de leur pouvoir.
Pour les zélateurs de l’arabisation, le tableau est aussi sombre. Loin de témoigner d’un attachement sincère à cette langue, ils ne s’en sont servis que comme tremplin politique pour la conquête de positions de pouvoir. Sinon, comment expliquer l’absence totale de mise en valeur du patrimoine culturel arabe, la pauvreté de la réflexion, même théologique, finalement l’échec sur l’essentiel : faire aimer cette langue et la réinsérer dans la trame de la vie moderne. L’acharnement à imposer l’arabisation n’a tenu aucun compte de la qualité des institutions à maintenir, et n’a jamais pris en charge la dimension algérienne de la question.
Car la langue dont il est question dans l’arabisation, en dépit des allégations trompeuses, n’est pas la langue algérienne. Celle-ci est même la seule à être exclue du jeu. Et pourtant, elle est la langue du peuple, celle qui lui a permis de conserver durant cent trente ans la conscience de son identité algérienne. Au contraire, la politique d’arabisation, si elle témoigne d’une certaine reconnaissance de la langue française en tant que langue étrangère, référence positive ou négative, ne laisse aucune place aux “parlers” nationaux : ceux-ci sont l’objet au mieux d’une hautaine condescendance, au pire d’une hostilité déclarée. La contribution de Mohamed Benrabah dans ce numéro est particulièrement éclairante à ce sujet 8 .
Ce n’est pourtant pas faute de soulever la question. Il est bien connu que la langue arabe, dans sa version moderne, est une langue internationale. Chaque pays a en revanche sa ou ses langues parlées. Cette dualité écrit-oral est pour le moment la pratique commune des pays arabes. L’Algérie seule agit comme si elle avait pour objectif de réduire cette dualité, au profit du seul arabe international, dit langue nationale pour l’occasion.
La question des langues parlées a été longtemps sujet tabou. Il y eut même quelques positions extrémistes, telle celle de ces enseignants algériens qui, dans une lettre à Jeune-Afrique 9 proposèrent qu’on utilise l’arabe dialectal dans l’enseignement, en l’écrivant en caractères latins. L’article provoqua des réactions indignées. La question qui se pose à ce sujet était de savoir si la seule reconnaissance possible pour une langue parlée est son passage à l’écrit. Dans la mesure où il est question de reconnaître une structure linguistique spécifique fondée sur l’opposition écrit-oral, la valorisation nécessaire des langues maternelles devrait tenir compte de cette situation. Il n’empêche que, pour l’opinion traditionnelle, l’opposition écrit - oral correspond toujours à une structure élite- masse, comme l’avait remarquablement formulé le père du réformisme algérien, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, dès les années 30 : “ Le langage utilisé par les “langues” au marché, sur les chemins et tous autres lieux populaires fréquentés par la masse ne peut être confondu avec le langage des plumes et du papier, des cahiers et des études, bref, d’une élite.” 10
Ainsi l’échec sur le plan linguistique est double. Par son mépris pour les langues parlées, le pouvoir s’est privé de l’adhésion populaire, tout en se créant de faux problèmes politiques, tels que le “régionalisme” qui serait lié à la revendication linguistique berbère. Par sa politique d’arabisation, il n’a pas su renouer avec une tradition arabe vivifiante, mais s’est engagé dans un traditionalisme stérile : fondé sur une pédagogie désuète, préférant la mémorisation à l’éveil, il a sous couvert de langue favorisé la promotion des médiocres et des politiciens, perdant le bénéfice de la crédibilité politique que la langue arabe aurait pu lui apporter.
Bref, de nos jours, la société algérienne ne se trouve pas bien dans ses langues. Elle utilise le français dans la dénégation, elle dispose de l’arabe qui l’enferme dans une extranéité moyen-orientale, elle parle sa propre langue dans la honte : où est le “chez soi” que l’indépendance devait lui assurer ?
Une loi pour exister
La violence démontre la carence de la loi. Qu’est-ce que la loi dans une société, sinon cette institution symbolique qui est reconnue comme le lieu de la légitimité du pouvoir ? La carence de la loi entraîne bien sûr la violence, mais surtout elle prive les membres de cette société du repère par rapport auquel ils peuvent se reconnaître une identité. L’identité algérienne, celle qui résulte d’un consensus minimal autour du pouvoir en ce qu’il doit être une réalité stable, capable de supporter toutes les diversités, les pluralités, les alternances. Je propose d’y réfléchir à partir de deux entrées : celle de la nature de la loi, et celle de la transmission.
La légitimité en Algérie
Dans la mesure où langue et loi sont en étroite corrélation, les langues en usage en Algérie peuvent aider à y réfléchir. Ces langues sont au nombre de trois : la langue arabe coranique, qui incarne la loi de l’Islam, la langue maternelle (arabe ou berbère) qui exprime la loi de la communauté d’origine, la langue française, qui s’imposa longtemps comme loi coloniale. Je laisse pour le moment de côté la langue arabe moderne, introduite récemment par la politique d’arabisation.
Il est bien évident qu’il y a une légitimité dernière qui vient de l’Islam. Aucun pouvoir politique ne peut contrevenir ouvertement à une prescription qui serait évidemment coranique (Habib Bourguiba en fit l’amère expérience dans les années 1960 en Tunisie, quand il voulut interdire la polygamie et restreindre la pratique du ramadan). La question est que le contenu de cette loi est extrêmement vague. Il n’est même pas évident (il est même historiquement prouvé) qu’un pouvoir politique, pour bénéficier d’une légitimité islamique, doive appliquer la chari’a. La limite extrême doit être en ce domaine que ce pouvoir ne combatte pas la foi musulmane ni les musulmans...
Du fait de cette imprécision extrême, la loi islamique concrète a toujours composé avec celle des ethnies et épousé leurs modulations. C’était même une des fonctions des oulémas des tribus berbères que d’élaborer de minutieux compromis respectant à la fois la chari’a islamique et les coutumes de la tribu.
Chaque “renaissance” de l’Islam, résurgences intellectuelles de la doctrine estimée plus pure, vient mettre en question ces fragiles équilibres entre loi et coutume. Ce fut le cas en Algérie dans les années 1930 à 1950, lorsque le réformisme urbain des disciples de Ben Badis voulut interdire leurs coutumes aux populations rurales, voire citadines populaires. C’est encore le cas de nos jours en Algérie, lorsque les intégristes veulent par exemple imposer le port du voile, interdire les réjouissances aux mariages, proscrire les chants populaires, etc.
Il est donc nécessaire qu’une autorité reconnue vienne dire la loi en ce domaine. C’est ce qu’aurait du faire une autorité algérienne. Or le pouvoir n’a pas assumé ses responsabilités en ce domaine, il a toujours estimé que les coutumes, comme les langues populaires, n’étaient pas dignes de considération.
C’est que, en même temps, une autre source de légitimité est à l’œuvre en Algérie : celle qui serait liée à la langue française, et qui est liée à la modernité et au développement. Cette légitimité issue de la France est en quelque sorte une arme qui s’est retournée contre elle-même. Les principes issus de la Révolution française portaient en germe la revendication d’indépendance de l’Algérie. Il peut sembler étrange de parler de ce type de légitimité comme étant à l’œuvre en Algérie. C’est en fonction de cette source que sont affirmés des principes de démocratie, même si la conception qu’en a la majorité est sans doute différente de celle qu’en ont les “démocrates”.
Dès les débuts de l’indépendance de l’Algérie, le pouvoir s’est trouvé pris en étau entre ces deux légitimités. Sans avoir la possibilité de trancher, il s’est contenté d’arbitrer au gré des pressions 11. C’est ce qui explique que nombre de problèmes ne purent être tranchés, ou ne le furent que pour ainsi dire ”à la sauvette” , sans vrai débat national : c’est le cas de la dernière décision sur le Code de la famille, ou de la décision d’arabisation totale de 1991. C’est du fait de cette double allégeance, sans instance d’arbitrage, que nombre de problèmes majeurs demeurent aujourd’hui sans solution. C’est la raison pour laquelle ils ont tendance à être réglés dans la rue, par la violence.
Légitimité et transmission
Il y a une transmission entre les individus, au sein des familles, entre ancêtres et descendants, entre parents et enfants. Une transmission entre Etats existe-t-elle ? Question nouvelle posée par la situation algérienne. Lors de l’installation de la colonisation, il y eut bien une résistance algérienne, mais il n’y avait pas d’Etat algérien, le pouvoir du dey ne pouvant être considéré tel. L’échec d’Abdelkader à unifier la résistance en créant un Etat moderne en témoigne. Durant la colonisation, il n’y eut pas de structure symbolique représentative, au même titre que le sultan au Maroc ou même que le bey en Tunisie. La nation algérienne a donc été constituée par la France et contre elle. Là est la référence principale. L’Etat algérien de juillet 1962, issu des accords d’Evian, s’est donc trouvé être l’héritier de l’Etat français. Ne faudrait-il pas dire plutôt qu’il était l’héritier du GPRA ? En partie peut-être. Mais l’essentiel de sa visibilité comme Etat était la reprise de l’administration mise en place par la France et qui fut reconduite, au même titre qu’une bonne part de la législation antérieure. Il y eut bien un transfert juridique de souveraineté. Mais y eut-il un transfert de légitimité ? Il ne le semble pas, parce que, dès l’été 1962, le gouvernement issu des accords d’Evian était renversé par un coup d’Etat, amenant au pouvoir Ahmed Ben Bella. Depuis, tous les chefs d’Etat ont été désignés par l’armée, ils sont issus de ces coups d’Etat successifs.
Où se trouve donc la légitimité en Algérie ? Qui, quelle institution est qualifiée pour gouverner ? Je pense qu’un transfert de légitimité entre la France et l’Algérie ne s’est pas réalisé en profondeur. Dans la mesure où une nouvelle institution, un nouveau lieu symbolique du pouvoir n’a pas été reconnu, la situation est demeurée trouble, non réglée. L’Algérie a pu se constituer contre la France, elle a du mal à se structurer sans elle. Un lien profond a été maintenu entre les deux sociétés, qui les empêche d’entretenir une relation comme entre deux entités différentes. Cette remarque est valable tant pour la France que pour l’Algérie, mais ses effets sont beaucoup plus destructeurs en Algérie, faute d’ancêtre symbolique propre. Cette rupture du lien aurait nécessité que l’Algérie s’aime elle-même, qu’elle aime son histoire, ses langues, ses paysages, ses traditions religieuses : il ne semble pas que, de ce point de vue, l’Algérie se soit aimée suffisamment. La cause en est sans doute que, à tout moment, c’est l’obsession du pouvoir, l’invasion du politique, qui ont empêché les mécanismes de la légitimité de se mettre en place. Faute de ce point d’appui, l’Algérie n’arrive pas à se reconnaître elle-même 12 .
De ce fait, il est bien évident que, derrière la façade des légalismes, des paravents juridiques, des manifestations officielles, ce sont d’autres règles qui mènent le jeu. Faute d’avoir pu installer la loi symbolique, le pouvoir a livré le pays à ses lois propres, antérieures, lois dans lesquelles il est lui-même immergé. Quelles sont ces mécanismes et que peut-on en dire aujourd’hui ?
Une société qui fonctionne selon ses propres lois
L’Occident a une telle confiance en ses instruments d’analyse qu’il a du mal à imaginer que d’autres règles fonctionnent ailleurs. Plus précisément dans le cas de l’Algérie, dont on se sent tellement proche, la différence des comportements ne peut être saisie que sous la qualification morale : or le problème est ici de tenter de voir la réalité des choses pour les comprendre. Cela dit, la prise en compte de la spécificité de la culture algérienne ne signifie pas que celle-ci serait « hors du circuit » des valeurs démocratiques. La question est plutôt de savoir comment y accéder..
Le recours à l’anthropologie
Il existe depuis bien des années une théorie diffusée en anthropologie qui est nommée “théorie segmentaire”. Elle est dite aussi la structure des sociétés sans Etat, ou même structure de l’anarchie. Sa description, objet de nombreux ouvrages et articles complexes 13 , peut se présenter de façon simplifiée. La société se représente comme un ensemble de segments, ou groupements, qui, par un processus de fusions ou de fissions, s’unissent ou s’opposent, selon les occasions. L’ensemble de ces stratégies d’alliances ou d’oppositions est souvent renvoyé à un arbre généalogique ou à une structure tribale définissant les options possibles. L’essentiel du système est son intentionnalité : il a pour but d’empêcher la concentration du pouvoir au sein d’un groupe particulier. Si un groupe devient trop puissant, les autres s’allient entre eux pour lui résister et le ramener à une taille non menaçante pour les autres. Cette description a été faite à l’origine dans le jeu social de tribus africaines. Son application au monde arabe, et au Maghreb (comme l’avait fait Evans-Pritchard pour montrer comment la dynastie régnante en Libye était parvenue au pouvoir) est éclairante si on sait la maintenir dans des limites raisonnables. Elle est en somme la théorie d’une société sans Etat. Elle doit empêcher l’émergence d’un chef , d’un groupe dominant. Elle règle l’équilibre des clans, seule réalité sur le terrain. Quiconque veut régler des conflits entre ces groupes par la médiation doit être faible (hors-jeu ou homme de Dieu...), car la médiation peut être source de pouvoir.
Cette théorie se trouve, à titre de mentalité, à la racine de beaucoup de comportements apparemment inexplicables en Algérie. On se demande depuis longtemps pourquoi les partis politiques d’opposition “démocrate” n’arrivent pas à se regrouper pour constituer une force politique cohérente. C’est que, pour les leader de ces mini-formations, l’essentiel n’est pas le regroupement, mais de savoir au profit de qui il s’effectuera. En 1993 à Alger, lorsque Saïd Sadi voulut faire un regroupement de ce type (le Mouvement pour la République) par une grande réunion ouverte à tous, la principale remarque qui fut faite à ce sujet était que Saïd Sadi voulait organiser sa propre promotion, visant la tête de l’Etat. Quelque temps auparavant, le leader de l’UGTA Benhamouda s’était vu soupçonner d’ambitions analogues après la manifestation du 22 mars, “pour la démocratie”.
Cette pratique fait partie de l’expérience quotidienne et embrasse même les rapports individuels, situant les personnes dans de constantes rivalités. Comme le disait un vieil observateur du Maghreb, Serge Michel, décrivant cette stratégie : “Quand deux hommes sont sur un bateau, l’un cherche à monter au mât, et l’autre le savonne...”
Cette règle de l’équilibre des groupes doit être complétée par une autre. S’il doit y avoir affrontement entre des groupes, il est important de ne jamais être dans le camp du perdant. C’est la stratégie ancienne des guerres bédouines. Elles opposaient des groupes tribaux, au départ en partie équilibrés. Quand la victoire penchait d’un côté, la plupart des groupes passaient au camp vainqueur, ne laissant chez les vaincus que ceux qui ne pouvaient décemment pas le quitter. Dans son ouvrage sur le Maroc, John Waterbury note un comportement identique dans les partis : un parti vainqueur aux élections voit se rallier à lui beaucoup d’adhérents. L’adhésion à un groupe n’est donc pas fonction d’une option idéologique personnelle, elle est déterminée par des stratégies d’appartenance à des groupes.
Où se trouve donc le pouvoir en Algérie ? L’opinion pense toujours que c’est l’armée, et dans l’armée, celui qui est mis en avant : Boumediène, Chadli, Nezzar, Zeroual. Or il est à peu près certain qu’aucun de ces personnages n’a concentré ou ne concentre en ses mains beaucoup de pouvoir personnel. La désignation de chacun à la tête de l’armée, puis de l’Etat, est le résultat d’un compromis entre les divers clans de l’armée. Celui qui est ainsi mis en avant est quelqu’un dont les clans pensent qu’il n’est pas à même de se constituer un pouvoir personnel indépendant des clans qu’il a pour mission de représenter. La structure de décision est une structure de marchandage entre les factions, à l’image de ce qui se fait traditionnellement dans les djemaa du Maghreb, ou dans les conseils de tribus, où la discussion dure jusqu’à ce qu’une unanimité se soit établie entre les plus puissants des clans. C’est ce qui explique qu’en Algérie, la politique suivie durant les dernières années, à une période qu’on estimerait cruciale pour l’avenir du pays, résulte de décisions de compromis.
Enfin il faut préciser que l’homme qui est délégué par les clans pour être le représentant de leur compromis non seulement n’a pas d’autorité personnelle, mais de plus, il est, comme tout individu dans cette structure, chargé des intérêts de son propre clan. Personne ne comprendrait qu’il ne le fasse pas. C’est ainsi que, au plus fort de la crise algérienne dans les années 1993 et 1994, lorsque des gouvernements, qu’on pensait être de la dernière chance, étaient constitués, ceux qui y entraient n’y étaient jamais choisis pour leur compétence personnelle, mais parce qu’ils faisaient partie de telle clientèle, de tel réseau (tel le groupe de Batna), voire de la famille ou des proches du chef de l’Etat. Vu de l’extérieur, cela semble être un mépris total de l’intérêt national. Vu dans la structure, d’abord il semble impossible que quelqu’un agisse autrement, c’est-à-dire agisse comme un individu isolé et responsable (ce qui serait probablement sa perte), et que de toute façon, son clan saurait lui rappeler bien vite qu’il n’est rien sans lui.
A la lumière de tout ceci, il apparaît combien la solution d’élections, présentée comme une panacée par toutes les institutions internationales et tous les démocrates du monde, s’avère fragile, si tant est qu’elle en soit une. Un choix politique n’est jamais une affaire de décision individuelle. Un groupe a l’habitude d’être représenté par son leader. Le chef naturel d’une communauté est le chef de famille, d’une famille étendue, ou d’une collectivité plus grande. A un niveau plus élevé, un consensus politique stable ne peut surgir que d’une longue concertation entre grands chefs de clans : même les résultats d’élections à l’occidentale devraient être avalisés par une structure de ce genre pour pouvoir bénéficier d’une quelconque crédibilité. Ce sont là les règles profondes qui régissent les comportements politiques, et vouloir les ignorer, comme le font avec constance les institutions occidentales alors qu’elles-mêmes y sont confrontes sur leur propre champ, ne peut qu’aboutir à prolonger la crise. Le verdict des urnes peut sans doute être présenté dans l’abstrait , et même être considéré comme juste, mais il ne peut suffire à créer une légitimité politique. Je réalise le caractère choquant de telles remarques pour l’opinion occidentale, ou occidentalisée, mais à quoi sert d’entretenir des illusions et de se voiler la face devant la différence, somme toute légitime, de l’autre ?
Le statut de la femme
Lorsqu’il est question de l’islamisme, et de son empreinte dans la vie sociale, l’impression qui prévaut est que tout tourne autour de la femme d’une manière obsessionnelle : interdire la mixité, porter le voile, laisser la femme au foyer, etc. : comme si tous les problèmes sociaux et politiques tournaient autour de cette question. D’Occident, on peut bien s’en gausser. Il y a pourtant là quelque chose de très profondément enraciné dans les traditions.
La question a été souvent posée : dans la population algérienne, la moitié d’hommes, autant de machos ? De quoi s’agit-il au fond ?
La femme au cœur de la société
Il existe dans l’ensemble du monde arabe, et sans doute aussi sur tout le pourtour de la Méditerranée, comme l’avait bien remarqué Germaine Tillion 14 , une conception spécifique du rapport hommes-femmes. Alors que, selon la vulgate anthropologique issue de Claude Lévi-Strauss 15 , la différence des sexes sert à la fois de paradigme et d’initiation pédagogique à l’altérité, sous la forme plus précise du mariage exogamique, dans l’aire culturelle qui nous concerne, la relation homme-femme est constituée en pilier de l’honneur. Cet honneur, loin d’être placé dans l’échange, est au contraire placé dans la conservation de la pureté de sa propre lignée. C’est ce qui explique que le mariage idéal, de temps immémorial, ait été le mariage endogamique, qui consiste plus précisément dans le fait qu’un jeune homme épouse la fille du frère de son père : ce système permet de revenir, toutes les quatre générations, à l’unicité de la lignée. Il entraîne un soin jaloux de la pureté du sang, d’où l’accent mis sur la préservation de la virginité des filles jusqu’au mariage. Au-delà de la matérialité de la chose, l’honneur consiste ainsi, pour les hommes, dans le contrôle des femmes : que même la rumeur ne puisse pas entacher la réputation d’une famille. Par le fait même, le comportement des femmes, même supposé, est le point le plus vulnérable de l’honneur familial, assumé en premier lieu par les hommes, mais aussi partagé par les femmes. L’origine de cette conception est fort ancienne, sans doute bien antérieure à l’islam, mais celui-ci en a repris les pratiques et l’esprit. Il l’a même conforté, en étendant cet esprit de supériorité de sa lignée à l’ensemble de l’islam, meilleure des religions, dernière des révélations. C’est ce qui explique que ce système peut aujourd’hui être présenté comme islamique. C’est dire aussi combien il est enraciné profondément dans la tradition culturelle, et l’adhésion spontanée, sinon sur ses détails, du moins sur son esprit, qu’il peut trouver auprès du sexe masculin.
Cette mentalité endogamique révèle le handicap qui fait obstacle au rapport à l’autre, qu’il s’agisse de l’autre humain, ou de l’autre comme réalité sociale, économique, culturelle. Elle rend l’adaptation au monde moderne non seulement difficile, mais surtout douloureuse, par la blessure narcissique que celle-ci ne peut qu’infliger. Elle explique les réactions que peut opposer cette culture, fragilisée par le contact avec la civilisation occidentale, à ses conceptions féministes.
Ces explications n’ont pas pour but de protéger à tout prix une conception qui peut paraître archaïque. La réalité est que le milieu arabe, et notamment algérien, évolue dans ses conceptions, s’adapte progressivement. Comme il s’agit précisément d’une structure de l’honneur qui est mise en cause, cette évolution s’accomplit d’autant mieux qu’elle n’est pas mise sur la place publique. Dans nombre de familles qui sont certainement aussi “libérées” que ne le sont les familles occidentales, les femmes elles-mêmes, épouses et filles, ont le souci de protéger une façade qui maintient l’honneur de l’homme : elles assument en commun ce maintien d’une forme de l’honneur, qui ne peut être mise en cause brutalement, et à laquelle on n’a toujours pas trouvé de substitut. Ce faisant, elles reconnaissent que ce maintien d’une structure symbolique de la famille est ce qui peut lui permettre de s’adapter sans heurt grave à des situations nouvelles, pensant peut-être que la virilité, au même titre que la féminité, doit y être protégée, et que sa fragilité, accrue par les attaques des féministes, est un point de grande vulnérabilité de la structure familiale algérienne. Si l’honneur des hommes n’est plus, comme autrefois, dans le contrôle des femmes, où est-il ? Si la virilité se définit par rapport au groupe des hommes, et non par rapport à la femme, comment passer à une autre relation homme-femme ?
Ce qui précède ne peut naturellement pas faire oublier les souffrances endurées par les femmes d’Algérie ni mésestimer le grand courage qu’elles manifestent dans la situation actuelle, où elles figurent le plus souvent parmi les victimes.
Car si j’ai décrit plus haut la configuration traditionnelle séculaire, il faut ajouter que celle-ci a subi une forte altération : elle s’est maintenue dans son idéologie, mais elle s’est décomposée dans ses structures. La femme d’autrefois était certes dominée par le milieu masculin familial, mais elle était aussi protégée, l’honneur était d’assurer sa protection. Aujourd’hui, principalement dans les villes, la femme n’est plus protégée : le milieu s’est désintégré, les hommes obéissent à d’autres solidarités que celles de la lignée, ils sont soumis à d’autres pressions. La décomposition du pouvoir de ces dernières années, l’absence de la loi, ont aggravé la condition de la femme. Elle est devenue objet de désir et de violence. Une violence qui est le reflet de l’ampleur de la frustration de l’homme : frustration de son désir, qui le pousse au plaisir brutal, frustration de son honneur, qui lui fait transférer en violence sur la femme le mépris dont il est l’objet comme homme, comme citoyen, comme travailleur. La chronique quotidienne nous abreuve de ces récits de viols (attribués aux islamistes, et parfois commis par des voisins), de violences, de tortures sadiques, d’humiliations et de mutilations.
Un souvenir me revient : “Je suis en France, durant l’été 1994, peu après mon retour d’Algérie. Je regarde le journal de vingt heures. Soudain apparaît Khalida Messaoudi, habillée à l’européenne comme beaucoup d’autres Algériennes. Elle intervient énergiquement pour dénoncer les pressions dont sont victimes les femmes en Algérie, celles qu’on tue parce qu’elles ne portent pas le voile. Elle dénonce cette violence qui se porte surtout sur les femmes. Elle affirme que le peuple ne cédera pas à la dictature, d’où qu’elle vienne, ni à l’obscurantisme. Le peuple algérien restera debout. Les femmes refusent de se laisser enfermer dans un monde rétrograde, elles veulent être libres.” Mon premier mouvement est d’admirer le courage de cette femme, qui risque sa vie en parlant à visage découvert, sachant qu’une grande partie de l’Algérie, et pas seulement ses amis, regarde cette émission grâce aux paraboles. Dans un second temps, je pense à toutes ces femmes en Algérie, dans les campagnes ou les faubourgs urbains : que peut représenter pour elles cette intervention ? J’imagine que, même si elles approuvent son courage, ses idées, son personnage ne peut les concerner en profondeur. C’est une femme qui a réussi, qui apparemment n’est pas mariée, n’a pas de mari, pas d’enfants, c’est une femme qui affirme du pouvoir devant des hommes : elles doivent avoir du mal à s’identifier à elle, à penser que la femme algérienne devrait être comme cela.
La grande habileté de l’islamisme a été de faire croire à l’identification de l’islam et du statut de la femme le plus traditionnel. L’histoire montre que ce statut a varié selon les régions et les époques, et qu’il continue de changer, en s’adaptant aux sociétés. C’est ce qui se passe à notre époque, d’une façon sans doute plus intensive. Mais on comprend mieux une évolution quand on a saisi son point de départ.
Ce point de départ, je le schématiserai de cette façon :
- un équilibre général intérieur-extérieur, dans lequel l’extérieur n’est pas conçu comme pouvant amener un changement favorable, mais plutôt déstabiliser, et est à ce titre perçu comme négatif : c’est l’esprit endogamique ;
- un équilibre femme-homme, où la femme représente l’intériorité, et l’homme la structure apparente qui ne peut que gagner à être cohésive (d’où la préférence pour le clan sur l’individu) ;
- une structure linguistique oral- écrit, dans laquelle la langue maternelle est fortement marquée d’intimité, et se trouve protégée de l’intrusion extérieure par un écrit fortement valorisé, voire sacralisé.
Ces divers traits ont dû être durant des siècles des données spécifiques d’une civilisation bédouine nomade, qui avait développé une civilisation de ce type 16.
Aurions-nous là de l’archaïque refoulé, et d’autant plus actif que refoulé ?
Entre la France et l’Algérie : le malentendu
Entre la France et l’Algérie, on croit se connaître. Il y a eu une longue fréquentation mutuelle, beaucoup d’échanges de personnes dans les deux sens et une importante immigration algérienne en France.. La langue française permet de bien se comprendre.... Là est le malentendu.
La langue en est le symbole et le terrain le plus frappant. Même dans la matérialité du signe : une connaissance approximative du français en Algérie fait croire que l’information est passée : souvent, il n’y a eu que communion affective dans le son des mots. Même lorsque le sens passe, les références, les mentalités qui sont derrière sont supposées être identiques : le peu que j’ai pu en dire en ce texte le montre amplement. Une certaine communauté de langue fait supposer une proximité, elle en crée l’illusion.
Pour reprendre une expression de Abdelmalek Sayad 17 , il faut considérer trois âges de la relation entre la France et l’Algérie :
1. le premier est celui de la colonisation. Les deux parties se sont bien senties et affirmées comme différentes, mais l’une dominait l’autre et lui imposait son pouvoir, sa culture, sa langue ;
2. le second a suivi l’indépendance. Il aurait du être celui où les différences étaient reconnues et où des relations se seraient créées sur cette base. Cet âge, qui s’achève dans les événements actuels, a été celui de l’illusion entretenue, de la confusion, du malentendu. La France a considéré l’Algérie comme étant toujours son double et son prolongement, l’Algérie n’a pas su s’aimer suffisamment pour s’arracher à l’ancien lien pour structurer sa propre personnalité ;
3. il faut souhaiter qu’il y ait un troisième âge, qui serait celui des différences reconnues, permettant à deux sociétés d’échanger sur pied d’égalité, et essayant peut-être, sur la base d’une histoire commune et d’intérêts communs, de créer une greffe de deux civilisations méditerranéennes.
Pour l’heure, on en est loin. L’illusion a été entretenue par l’élite dirigeante et intellectuelle de l’Algérie, si proche de la France même quand elle la maudissait, quand elle lui opposait sa face si ressemblante. Cette ressemblance a fait oublier l’autre Algérie, celle des banlieues et des campagnes, qui vivait selon d’autres règles. Cette similitude des élites est certainement ce qui a été le plus trompeur, car elle voilait totalement la différence. J’ai mentionné plus haut les normes des comportements politiques, qui épousent les lignes de partage des clans. Les chefs s’entourent d’hommes choisis non en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leurs appartenances familiales, claniques ou régionales. Les Occidentaux, imbus de leurs jugements, ont tendance à qualifier ces pratiques d’étiquettes morales ; il ne s’agit en réalité que de différences : ces hommes qu’ils ont choisi de cette façon, ce sont peut-être effectivement les seuls auxquels ils puissent se fier, et c’est le plus important du point de vue du pouvoir... Autre exemple : les petits partis démocrates n’ont jamais pu s’unir entre eux pour constituer une vraie force politique, parce que le réflexe d’empêcher l’ascension de l’autre a toujours été prédominant.
Comment un tel aveuglement a-t-il pu régner si longtemps ? La raison en vient de chacune des parties, qui y trouvait son compte.
Du côté algérien, l’obsession de se trouver “à la hauteur” des nations modernes a imposé une langue de bois dans le discours sur la société : l’Algérie était moderne, elle avait vaincu une grande nation appuyée par l’Otan, elle portait en elle tous les germes du développement, et parler autrement était faire preuve de racisme, d’impérialisme et de néo-colonialisme. Participant à Alger en 1974 au Congrès international de sociologie, réuni au Club des Pins, je fus, comme des centaines de chercheurs de tous pays, témoin de la violente diatribe lancée par Mohamed Seddik Benyahia, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La cible en était l’ethnologie, science coloniale, qui n’avait plus sa place en Algérie : celle-ci relevait désormais de la sociologie, au même titre que les sociétés modernes, et non plus de cette science des sauvages ! L’heure n’était pas à cultiver la différence, celle-ci ne pouvant être que sauvagerie et barbarie. Que de nombreux chercheurs du tiers-monde aient été séduits par ce discours de promotion, il n’y a guère à s’en étonner. Mais que les universitaires occidentaux, et notamment français, aient manifesté à l’égard de cette tendance démagogique une telle complaisance, est plus surprenant : les conséquences en sont apparues par la suite 18.
Les Algériens ne voulaient pas savoir, les Français non plus. Pour les libéraux qui avaient tant investi, moralement et matériellement, dans la cause algérienne, il était difficile de risquer une telle désillusion. L’entretien dans ce numéro avec Paul Thibaud et Pierre Vidal-Naquet en est une remarquable expression, qui se conclut par cette remarque sur l’histoire du FLN : “C’est parce qu’elle était affreusement tragique que beaucoup de gens se sont raconté des histoires pour qu’elle le soit moins.” 19
Dans le domaine de la coopération culturelle et technique, l’objectif a toujours été l’Algérien en tant que ”autre nous-mêmes”. Dans tous les secteurs, le but était de maintenir l’arrimage à la France, de ne jamais favoriser les facteurs qui auraient pu faire que l’Algérie fût autre. Le domaine de la langue est particulièrement éclairant. Quelles que soient les réserves que j’ai faites plus haut sur la façon dont a été conduite la politique d’arabisation, il était bien évident que cette nation avait besoin de retrouver par cette langue une référence à un patrimoine qui l’aide à se sentir différente de la France, qui l’avait constituée. Il eut été à la fois honnête et habile d’aider ce pays à réaliser une arabisation moderne par un appui pédagogique éclairé, la place de la langue française étant de toute façon largement assurée par ailleurs. Au lieu de cela, sur le thème de la francophonie, on a construit autour de ce pays un mur de sable, dispensant largement les crédits sur le Maroc voisin, et ne pratiquant en Algérie qu’une assistance honteuse à la langue et à la culture françaises, toujours sur l’air de l’amour déçu : “Ils ne veulent pas de nous !”
L’odyssée - qui serait pittoresque si elle ne s’était déroulée dans une occasion aussi tragique - de deux ministres français 20 décidant brusquement de débarquer à Alger en négligeant tout préalable diplomatique en dit plus qu’un long discours sur les réflexes inconscients sous-jacents aux conduites : dans ce monde ténébreux de l’archaïsme, l’Algérie, c’est toujours la France... Si l’Algérie a du mal à couper le cordon ombilical pour se constituer elle-même, la France elle-aussi hésite à couper le lien. Il le faudrait pourtant, pour pouvoir devenir partenaires.
***
Au moment où l’on croit que tout un monde s’écroule, il est bon de voir la situation dans sa globalité. En réalité, une situation était bloquée depuis longtemps, et rien ne se passait qui fût susceptible de la débloquer. Or c’est le cas aujourd’hui, même si les conditions en sont tragiques, le coût énorme.
J’entends souvent dire : “C’est une autre guerre d’Algérie”. Certes les signes en sont identiques : les mêmes lieux qu’autrefois sont mentionnés, et bien souvent hélas les mêmes méthodes. Mais la comparaison est certainement à chercher ailleurs : tout le pays est pris dans une tension vers autre chose, vers une libération d’une situation qui n’aurait jamais dû advenir.
Vers quel but peut bien s’orienter cette quête de libération ? Je pense que l’Algérie aspire enfin, après 160 ans de gestion par autrui, à être elle-même.
Etre elle-même, pour cette société, consisterait à assumer ses origines, celles que lui désignent ses langues, à savoir:
- les origines du terroir, du sol algérien, qui fut berbère, punique, romain, puis arabe en ses diverses phases, origines qu’évoque la langue maternelle, qu’elle soit du berbère ou de l’arabe parlé ; des origines qu’évoque aussi la structuration du pays en quartiers de villes, en segments de tribus, en affiliations régionales.
- les origines de l’histoire arabo-islamique, qui a façonné le pays à son empreinte, et particulièrement certaines villes, qui l’a constitué dans la croyance et la culture, et dont la prestigieuse langue arabe est le témoin.
- les origines coloniales, qui, à travers certes la domination et l’exploitation, ont constitué l’Algérie comme nation moderne, ayant eu accès à la modernité par la langue française.
Assumer ses origines ne signifie pas s’y réduire. Bien au contraire, elles ne peuvent être dépassées si on ne les a pas d’abord assumées. Aimer ses origines, c’est s’aimer soi-même, c’est se reconnaître le droit de suivre la vie, de se transformer. Cela est aussi vrai des sociétés que des individus.
Accepter d’être elle-même, pour l’Algérie, ce serait aussi prendre conscience de tâches à accomplir, des tâches qui toutes se résument à assurer le difficile passage entre le passé et l’avenir, entre les traditions et l’ère moderne, entre la fermeture sur soi, même valorisée, et l’ouverture à l’extérieur, entre la référence régionale et le sens national. Ce serait créer suffisamment d’attachement à la patrie pour que soit supportable la nécessaire diversité entre les langues, les opinions, les partis, les comportements d’adaptation à un style de vie différent. Ce serait pour ceux de la diaspora de ne plus chercher seulement à disparaître dans le paysage d’accueil, mais de conforter leur identité dans l’attachement à leur origine. Ce serait pour tous une fierté d’appartenir à leur jeune nation et une volonté de la construire.
Du côté de la France, il faut cesser d’entretenir une relation fantasmatique à l’Algérie, en finir avec un vague sentiment de propriété prolongée. A une Algérie sûre d’elle-même et différente, la France a tout à gagner. Pour le dire en bref, il faut aider l’Algérie à se passer de la France. C’est la seule garantie de relations vraies pour l’avenir. Pour l’instant, il est urgent que les rapports cessent d’être l’affaire des Etats, et qu’ils deviennent celle des sociétés civiles.
Dans l’immédiat d’une situation chaque jour plus difficile, il faut déterminer quels sont les vrais enjeux.. Dans une société tellement fragmentée, seule une concertation réunissant physiquement ceux qui sont reconnus comme leurs représentants par les divers clans, groupements, partis, a des chances d’aboutir au consensus minimal permettant le rétablissement de la loi. Aucun homme ne s'avancera seul, aucun clan n'ira au-delà de lui-même. Sant'Egidio 21 est sans doute une initiative positive. Une société segmentaire a besoin de médiateurs, de gens qui organisent le dialogue. La France, si elle ne s’en était tenue trop longtemps à une position bureaucratique et timorée qui la rangeait du côté du pouvoir en place par le simple jeu de l’inertie, aurait pu être en meilleure position pour le faire. J’ai quitté l’Algérie en étant convaincu que c’était encore cela que le peuple algérien attendait d’elle.
|
| 1 nom donné traditionnellement en Algérie au pouvoir central : autrefois le dey, les Turcs, puis les autorités coloniales, plus récemment le pouvoir d’Alger : la représentation attachée au terme est que le principal souci de ce pouvoir est de lever les impôts....
2 cf. Mohamed Benrabah, “La langue perdue », dans ce numéro, se référant au quotidien algérien El-Moudjahid du 24 octobre 1990, p.5.
3 Ceci jusqu’à la loi du 5 juillet 1973, qui a abrogé, à compter du 5 juillet 1975, toute la législation antérieure à l’indépendance.
4 cf. Hassan Remaoun et Gilles Manceron, D’une rive à l’autre. La Guerre d’Algérie, de la mémoire à l’histoire. Paris, Syros, 1993, et “La place de l’enseignement de la guerre de libération dans le cursus scolaire en Algérie”, in La guerre d’Algérie dans l’enseignement en France et en Algérie, IMA et CNDP, 1992. Cf également, Hassan Remaoun, “Sur l’enseignement de l’histoire en Algérie ou de la crise identitaire à travers et par l’école”, Alger, NAQD, N°5, 1993, pp.57-65.
5 Lucile Provost, “L’économie algérienne et ses avatars”, dans ce numéro.
6 Marc Côte, “Une société “mal dans son espace”, Economie et Humanisme, Algérie 89, N°309, sept.oct.1989, p.14.
7 Abdenour Djellouli , “La ville algérienne, une identité introuvable ?”, dans ce numéro.
8 Mohamed Benrabah, “La langue perdue”, dans ce numéro.
9 “Il faut enseigner l’arabe vivant”, Jeune Afrique, n° 418, 6-12 janvier 1969. Pour plus de détails sur cette question, cf. mon ouvrage Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Maisonneuve et Larose, 1983, pp.26-28
10 Ben Badis, cité par Odette Petit, “Langue, culture et participation du monde arabe contemporain”, IBLA, N°128, 1971, pp. 259-283.
11 Cette tension a aussi opposé les cadres, comme si un choix eût été à faire entre l’authenticité et la compétence. Il suffit de rappeler l’opposition, au sein de l’armée, entre les officiers issus des maquis, et les officiers formés dans l’armée française.
12 Cette carence de l’Algérie à se structurer comme Etat est bien décrite et expliquée dans deux ouvrages récents : Ahmed Rouadjia, Grandeur et décadence de l’Etat algérien, Karthala, 1994, et Lahouari Addi, L’Algérie et la démocratie. La Découverte, 1994.
13 Evans-Pritchard, The Nuer, Oxford, Clarendon Press, 1937; The Sanusi of Cyrenaica, Oxford, Clarendon Press, 1949 ; E.Gellner, Saints of the Atlas, London, Weidenfeld and Nicolson, 1969 ; théorie diffusée en France par Jeanne Favret, “La segmentarité au Maghreb”, L’Homme,1966, N°2 . Une analyse allant dans ce sens avait été faite, pour le Maroc, par Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires (groupe chleuh), Travaux de l’Année sociologique, 1930. La théorie fut appliquée avec succès au Maroc contemporain par J.Waterbury, The Commander of the Faithful, trad. Le Commandeur des croyants : la monarchie marocaine et son élite, Paris, PUF, 1975. La théorie en France fut combattue à la fois par les marxistes (comme structuraliste), et par les adversaires de l’orientalisme, comme interprétation culturaliste de l’histoire... La théorie segmentaire est généralement ignorée des politologues.
14 Germaine Tillion, Le Harem et les Cousins, Seuil, 1966.
15 Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Mouton, 1967.
16 cf. la thèse de Manaf Sami, Economie et politique du nomadisme arabe, Paris, EHESS, 1989 , non publiée : où la cohérence entre une organisation spatiale, temporelle, économique et rituelle est bien marquée : une sorte de reconstitution du milieu que l’islam comme système est venu combattre et remplacer. Du même auteur : “La politique des généalogies parmi les Nomades arabes”, in Peuples Méditerranéens, Mythes et récits d’origine, N°56-57, 1991, pp.129-141.
17 Abdelmalek Sayad, Les trois âges de l’émigration algérienne en France, Actes de la recherche en sciences sociales, N°15, 1977, pp.59-81.
18 Pour ne citer qu’un échantillon de cette littérature de complaisance : P.Lucas et J.C.Vatin, L’Algérie des anthropologues, Maspéro, 1982.
19 Dans ce numéro : “Le combat pour l’indépendance algérienne : une fausse coïncidence. Entretien avec Paul Thibaud et Pierre Vidal-Naquet.”
20 Il s’agit du déplacement que les ministres des Affaires Etrangères (Alain Juppé) et de la Défense nationale (François Léotard) ont effectué à Alger le 3 août 1994 à l’occasion de l’assassinat de cinq fonctionnaires français en Algérie.
21 Rencontre organisée entre diverses personnalités politiques algériennes par la communauté catholique de Sant’Egidio en Italie, à la fin du mois de novembre 1994. |
|