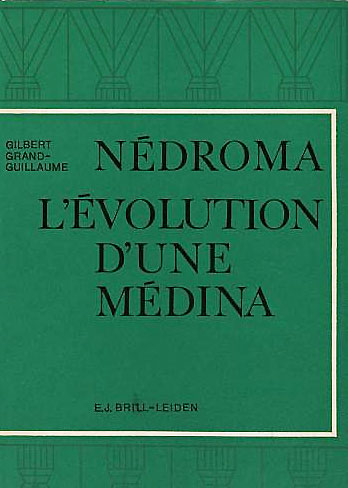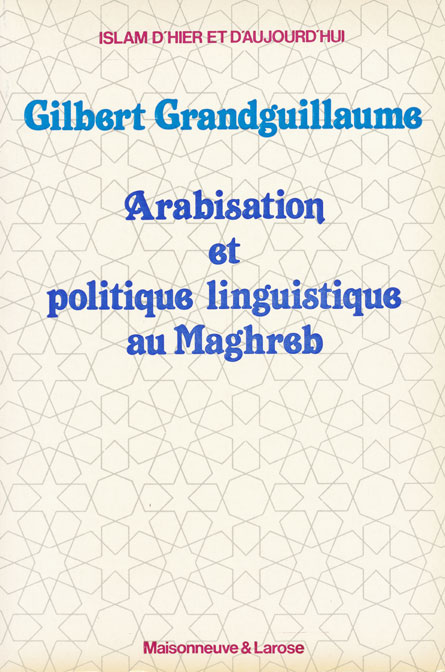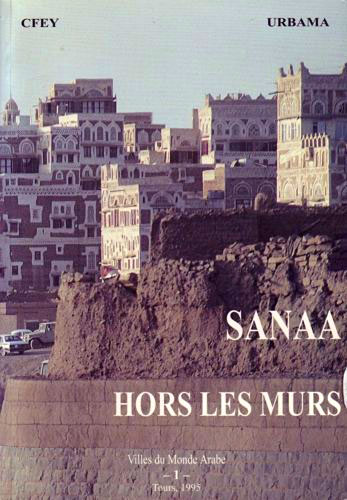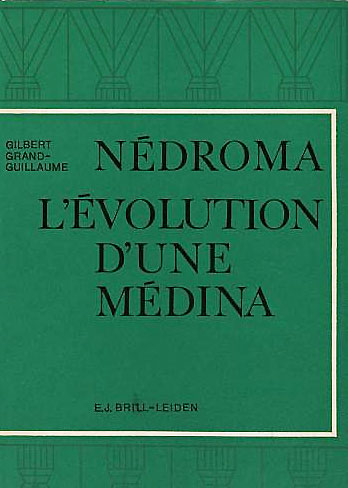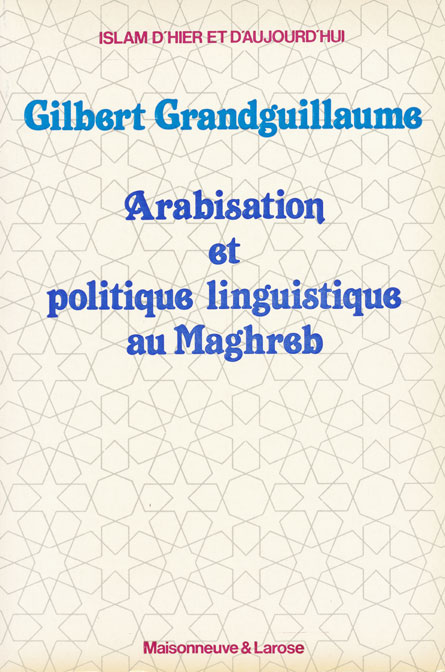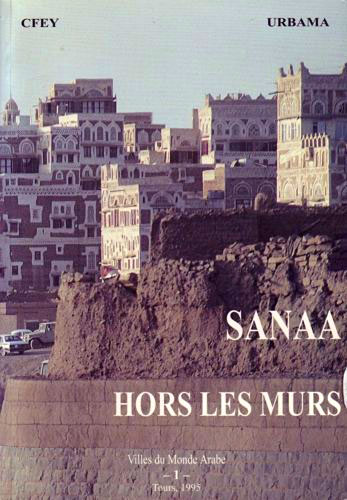|
Articles
| ARABIE SAOUDITE 2 |
. |
: La Péninsule arabique d’aujourd’hui, dir.Paul Bonnenfant, tome II, Etudes par pays, Editions du CNRS, Aix-en-Provence, 1982, pp 623-654.
|
Suite du texte de l'article Arabie Saoudite 1
Chant, musique et danses
Quiconque parcourt aujourd'hui l'Arabie Saoudite est frappé par la morosité de la vie sociale, par l'absence apparente de réjouissances populaires et de manifestations collectives spontanées. Il est important de noter qu'il n'en a pas toujours été ainsi, même dans un passé récent. C'est ce qu'atteste l'existence de poésies et de chants en langue dialectale, auxquels on réserve, curieusement, le qualificatif de nabati (littéralement « nabatéen •), le même par lequel on qualifie les monuments de la civilisation antérieure à l'Islam, tels que ceux de Madayn Sâlih.
L'univers traditionnel
La vie collective en milieu bédouin et citadin était marquée de fêtes, de réjouissances, au cours desquelles hommes et femmes dansaient en chantant et en s'accompagnant d'instruments de musique, et même, dans la période récente, en faisant parler la poudre.
Beaucoup de ces traditions ont maintenant disparu, mais nous sommes bien renseignés sur ce qu'elles furent, grâce à l'intérêt d'un certain nombre d'auteurs saoudiens tels que `Abdallâh al-'Alî az-Zâmil ou 'Atiq ibn Ghayth al-Bilâdî qui ont écrit des ouvrages sur al-'adab ash-sha`bi, qu'on peut traduire par " culture populaire ". Ils nous décrivent combien fut vivante cette tradition populaire.
Ainsi en est-il du qasîd, une danse pratiquée dans le Hijâz. Elle se pratiquait la nuit, hommes et femmes y participaient. Ils se disposaient sur deux rangs, face à face ; le meneur de jeu - râwî - lançait le premier vers du poème, repris par son rang, puis par l'autre rang : le tout au rythme des tambourins et des flûtes, mains et pieds marquant la cadence. Ces danses impliquaient souvent une compétition entre les deux rangs, et leur talent respectif d'improvisation poétique. Dans d'autres danses telles que le `arza, les hommes faisaient tournoyer au-dessus de leurs têtes leurs fusils chargés, puis, brusquement, les fixant avec leurs pieds, ils tiraient tout en sautant en l'air, donnant l'illusion qu'ils avaient été touchés. Des danses se pratiquaient aussi dans les villes, telles que La Mekke, Médine ou Tayf. Très célèbre parce que né dans cette ville est le majrûr tâ'ifî : le rythme est donné par le batteur de tambour, placé au milieu des deux rangs, tandis que les participants, un tambourin à la main, l'accompagnent en exécutant des pas de danse.
La participation des femmes était plus active dans certaines danses : c'est le cas de celle qui était appelée al-hâshî (le chamelon), pratiquée dans le nord de l'Arabie. Les hommes étaient disposés sur deux rangs, chantant et rythmant de leurs mains, tandis qu'une belle s'avançait entre les deux rangs, évoluant avec grâce et agitant de la main une baguette souple (khayzarâna). Un homme s'avançait alors hors du rang, faisant mine de l'approcher : elle le frappait alors énergiquement de sa baguette, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Puis elle sortait et une autre jeune fille prenait sa place.
Une danse analogue était pratiquée dans la tribu des `Utayba : elle porte le nom significatif de shubbat an-nâr (le fait d'allumer le feu...). Les hommes se plaçaient sur deux rangs, et les jeunes filles venaient, dévoilées, la chevelure dénouée. L'une d'elles se mettait à défiler gracieusement entre les deux rangs, balançant pour faire voler de droite et de gauche sa longue chevelure, déployant tout son charme pour se présenter à ces hommes qui, dans cette tribu, ne la voyaient pas le reste de l'année. Elle portait à la main la khayzarâna et en frappait le plaisantin qui tentait de l'approcher. Puis elle sortait et une autre entrait.
Il existait au Hijâz des chants d'amour auxquels, dit-on, les femmes étaient particulièrement sensibles : c'est le cas du kasra, usité des Médinois et des habitants des environs. 'Atiq ibn Ghayth rapporte l'anecdote suivante : « L'un des shaykh de la tribu de Harb était avec sa femme, en train de manger des dattes; à quelque distance se trouvait un jeune homme, juché au haut d'un palmier, qui se mit à entonner un kasra : saisie, la femme laissa échapper la datte de sa bouche... Le shaykh s'enflamma de colère et partit rosser ce jeune homme... »
Certains chants accompagnaient les activités quotidiennes, tel le hawbala, chanté par ceux qui tiraient l'eau du puits. Plus célèbres étaient les chants des chameliers, très appréciés des oreilles féminines. Pour cette raison, les habitants de Gharan les avaient interdits à tous ceux qui traversaient leur territoire.
Il était important d'insister sur le dynamisme de cette culture qui fut oblitérée par la suite. On peut se demander si ses traces ont été totalement effacées, ou si elles se sont simplement réfugiées dans les profondeurs de l'âme populaire, prêtes à resurgir sous cette forme ou sous une autre. Ce qui est certain, c'est qu'elles manifestent, au cœur de la culture saoudienne, la profonde imbrication du chant, de la poésie, de la musique, de l'expression corporelle et d'un type de rapport entre les sexes.
La réaction wahhâbite
Philby rapporta un jour à Thesiger l'anecdote suivante : « Un jour. assis en compagnie du Roi sur la terrasse du palais de Riyadh, ils entendirent quelqu'un chanter dans le lointain. Très sincèrement choqué, Ibn Saoud s'écria : « Que Dieu me protège ! Mais qui est donc en train de chanter ? » Il envoya un serviteur quérir le coupable. C'était un jeune bédouin qui venait d'amener à la ville un troupeau de chameaux. D'un ton sévère, le roi l'admonesta : « Ne vois-tu donc pas que chanter, c'est succomber aux tentations du diable ? x et, pour le punir, il ordonna qu'il fût fouetté. » (rapporté dans « Le Désert des Déserts », p. '309).
Cette réaction d'Abdalazîz est significative de l'attitude des wahhâbites par rapport à tout ce qui est musique, chant et danses, considéré comme manifestation diabolique et ouvre de corruption.
Cette attitude est ancienne : en 1854, à Riyadh, alors que Faysal ibn Turkî était au pouvoir, une épidémie de choléra se déclara. La police religieuse des wahhâbites, les mutawwa`, interprétèrent cette épidémie comme un signe de la vindicte du ciel contre la décadence des moeurs, et ils commencèrent à interdire le tabac à fumer et à priser, les vêtements luxueux de soie brodés d'or, le chant et l'usage des instruments de musique.
Ces mesures furent étendues à l'ensemble du territoire au fur et à mesure des conquêtes. Les chroniqueurs rapportent que, dans le 'Asîr, danses, chants et fêtes furent proscrits. Au Hijâz, la même interdiction fut promulguée. mais les autorités saoudiennes durent revenir sur la rigueur de cette décision. Quant à la province d'al-Hasâ, elle fut elle aussi promptement ramenée à l'orthodoxie sous la férule d'Ibn Jiluwi. Dans tous les cas, la mixité d'usage dans ces fêtes fut sévèrement bannie.
La censure wahhâbite sur toutes ces pratiques populaires s'est exercée de deux façons. La première et la plus fréquente fut l'interdiction brutale, sous peine d'être fouetté en public et emprisonné. La seconde fut le discrédit islamique dont elles furent frappées, comme pratiques de juhl, c'est-à-dire relevant de l'ignorance des tribus d'avant l'Islam.
Bien caractéristique de cette dévalorisation intériorisée est cette phrase de l'un des deux auteurs cités plus haut : « La mixité des hommes et des femmes chez les bédouins du Hijâz, à l'occasion des danses et des fêtes, est un fait bien connu : cependant, elle a commencé à disparaître, du fait de la propagation de la « science » : la science religieuse dont il est question ici - 'ilm - étant l'opposé du juhl. Ainsi, peu à peu, une culpabilité s'est imposée par rapport à ces pratiques : elle apparaît nettement dans ce fait rapporté par 'Atiq ibn Ghayth :
« Un homme d'âge mûr se trouvait assis avec d'autres dans le lieu de réunion quand le tambour résonna et les femmes se mirent à chanter un chant de khabîtî :
La la ya khayzarâna fi-l-hawa mayyalû-kî
La la wa in mayyalû-kî mâlati-r-ruh ma’a-ki
La la wa zîmâm sayyîdî tâh fi jummat-al-bîr
La la wa jinnîyat abû khayyâl lalli ijîb-u
chant qu'on peut traduire approximativement de la sorte :
O belle, ils t'ont fait pencher vers l'amour
Mais s'ils te font pencher, son esprit penchera avec toi
La puissance de mon maître est chue au fond du puits
Et qui l'en sortira sinon la sorcellerie d'Abû Khayyâl_.. (1).
Toute l'assistance vit alors ce vieillard respectable se mettre à trembler, puis s'élancer et se mettre à danser entre les deux rangs de femmes. Celles-ci comprirent qu'il était envoûté, comme inconscient durant tout le temps que durèrent chants et musique, puis il tomba inanimé tant il avait dansé, comme cela arrive dans le zâr : à la fin du chant, on demeure malade quelque peu... Quand le vieillard réalisa plus tard ce qui s'était passé, il en eut honte et se repentit...»
On peut se demander ce que permet la loi wahhâbite en ce domaine. Le chant par excellence est la psalmodie du Coran, diffusé en permanence par la station de radio de La Mekke, ainsi que par les autres stations et par la télévision à certaines heures. Les programmes de télévision présentent assez souvent des chanteurs populaires entourés d'un petit orchestre, ou des chanteurs d'autres pays arabes, et même quelquefois aujourd'hui des chanteuses arabes non saoudiennes. L'impression qui s'en dégage est celle d'un art trop contrôlé, ne laissant échapper aucune spontanéité, et par là facilement ennuyeux.
L'influence de la musique occidentale
La musique occidentale est connue des Saoudiens qui ont voyagé à l'étranger, mais aussi de tous ceux qui disposent de radio et de télévision. Toutefois la diffusion des rythmes étrangers s'est surtout opérée par la cassette, qui, comme le magnétophone, est vendue à très bas prix.
Certes, la musique occidentale qui attire la population n'est pas la musique classique, de même que, pour la danse, ce n'est pas la valse. C'est toute la musique moderne qui déferle sur la jeunesse, transportant avec elle tous les mythes de libération, de consommation, de passion débridée. A Riyadh, le marché des cassettes de musique occidentale s'est déplacé vers les quartiers neufs, où la musique peut être déversée dans la rue par des hauts-parleurs. Les photos qui illustrent ces cassettes - femmes lascives ou dénudées, blondes vaporeuses ou brunes provocantes - sont une claire indication de l'univers imaginaire auquel renvoie cette musique. A travers elle, c'est l'influence occidentale qui se diffuse dans le pays, particulièrement parmi la jeunesse. Hormis dans les zones rurales ou les petites villes, les milieux conservateurs ne peuvent l'interdire, bien qu'ils la considèrent comme un élément particulièrement nocif pour la jeunesse et le pays dans son ensemble.
Ainsi dans ce domaine de la musique apparaissent aussi trois univers : la spontanéité de la musique traditionnelle se trouve doublement condamnée par le wahhâbisme qui se méfie de son primitivisme anarchique, et par le monde occidental, qui n'y voit que reliques d'un passé révolu.
Le statut de la femme
Le statut de la femme tient une place centrale comme valeur significative, au cœur de chacune des trois cultures; pour cette raison, il est le sujet de tensions et de conflits importants dans la période de changement actuelle. En effet, parler de la femme signifie qu'on évoque la sexualité, fondement de l'opposition homme-femme, et renvoie nécessairement à la place que tient celle-ci dans les pratiques sociales et l'imaginaire de la culture, ainsi qu'aux effets de pouvoir qui leur sont liés. On ne sera donc pas étonné de trouver ici trois optiques différentes sur cette question.
La femme dans la société préwahhâbite
Il est important de rappeler ici que parler de société préwahhâbite ne renvoie pas à un repère historique, mais à un univers culturel. Ce qui est dit ici se rapporte donc parfois à des pratiques disparues, parfois à d'autres qui existent encore aujourd'hui en coexistence - plus ou moins pacifique - avec la culture wahhâbite : l'important est de noter que, manifestes ou latentes, permises ou refoulées, elles sont présentes dans l'actuel de la culture saoudienne.
Tous les témoignages écrits et oraux sont unanimes à souligner le fait que le voile. devenu le symbole de la « femme musulmane » n'était pas porté dans cette société. Il ne l'était pas - et ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui - dans les zones rurales et bédouines de l'Asir, du Hijâz, du Nord, et même du Najd, tandis que le port du voile - burga' - est attesté chez certaines tribus telles que les Harb, les Sulaym et quelques fractions des 'Utayba.
Tout ce que nous avons rapporté ci-dessus à propos des chants, danses et fêtes atteste que la société n'était pas coupée en deux, même si les usages attribuaient à chaque sexe une place déterminée dans les travaux, l'habitation, et les diverses fonctions sociales. `Âtiq ibn Ghayth note que les femmes du Sud sont dévoilées, et tout à fait à l'aise dans leurs relations avec les hommes, leur parlant sans réticence : ce qui lui fait dire qu'elles sont «comme des hommes ».
Un trait caractéristique de cette société est que l'homme attache une grande importance à la renommée qu'il peut acquérir auprès des femmes : elles sont en quelque sorte la caution de sa virilité. Tous les actes de bravoure que l'homme pouvait accomplir dans les combats trouvaient leur contrepartie dans cette réputation qu'il gagnait auprès d'elles, et qui se répandait dans leurs conversations, leurs chants, leurs poésies. Ce trait marquait l'ensemble de la vie sociale, plus fortement les actions d'éclat accomplies en certaines circonstances telles que la guerre. On en trouve toutefois un indice particulièrement significatif dans les pratiques relatives à la circoncision.
En effet, à côté du rite de circoncision conforme à la tradition islamique, en existait un autre, très répandu dans la région ouest de l'Arabie, plus particulièrement dans la Tihâma (mais qui l'était peut-être aussi ailleurs). Ce rite, particulièrement rude, était observé tardivement, alors que le jeune homme avait entre quinze et trente ans. Au cours d'une fête publique, au son de la musique et des chants et en présence des hommes et des femmes de la tribu, le jeune homme subissait le prélèvement d'un lambeau de peau, depuis le bas-ventre jusqu'à son sexe : cette opération était exécutée à l'aide d'un poignard aiguisé et sans anesthésie. Le jeune homme devait supporter publiquement cette douleur horrible : c'est le courage manifesté à cette occasion qui soulevait l'admiration des femmes de la tribu et permettait au héros de la fête de réaliser un beau mariage par la suite. A ce sujet, `Atiq ibn Ghayth cite l'anecdote suivante, narrée par un homme d'une tribu noble du Sud (ashrâf) :
« Mon père m'avait circoncis selon le rite islamique, comportant le simple découpage de l'extrémité du sexe; quand je fus grand, je devins amoureux d'une fille de notre tribu; nous gardions les troupeaux ensemble; quand je lui fis part de mon amour pour elle, elle me dit : « Moi, je t'épouserais, alors que tu n'es pas circoncis ? - Je suis circoncis, mais à la façon islamique - Non, dit-elle, je ne t'épouserai pas avant que tu ne sois circoncis comme le sont les jeunes gens de ta tribu. » Je demandai plusieurs fois à mon père de me circoncire comme les jeunes gens de mon âge, mais il refusa. Alors, un jour que je gardais les troupeaux, je m'éloignai de cette jeune fille, je pris un fil et un couteau effilé, je fichai un pieu dans le sol. Puis je découpai l'extrémité d'un lambeau de peau, et l'attachai à ce pieu avec le fil; puis, en me tenant, je continuai à découper le lambeau jusqu'à la fin de l'opération. Ne me voyant plus, ma compagne partit à ma recherche. Quand elle me découvrit, ensanglanté sur le sol, elle ressentit une immense fierté de me voir circoncis, et elle courut au campement en porter la nouvelle. Absolument tous les hommes et toutes les femmes vinrent contempler mon geste, et faire l'éloge de mon courage. »
Les wahhàbites interdirent cette pratique au nom de l'Islam, mais leur interdit se heurtait à une grande résistance, et ils durent recourir à des mesures violentes : on peut citer ici le témoignage de Thesiger, qui remonte à 1948 :
« J'étais hanté par le souvenir de trois jeunes gens rencontrés, quelques mois auparavant, à la lisière d'un village dans la plaine de la Tihâma. Chacun d'eux tenait serré contre lui un paquet de pansements souillés qui cachaient un moignon suppurant. Ils avaient été amputés de la main droite pour avoir été circoncis selon un rite interdit par le Roi. Je n'arrivais pas à oublier le regard douloureux d'un des garçons, dont le visage doux et délicat se crispait sous l'effet de la souffrance. On m'avait raconté qu'en voyant l'esclave de l'émir hésiter avant d'exécuter ce châtiment barbare, il avait tendu la main en disant : « Coupe. Je n'ai pas peur ». (Op.cit.,p.302).
Toutes ces pratiques nous révèlent une société ou la femme est profondément présente, où sont profondément impliqués honneur, virilité, courage, où l'affirmation de la virilité est une loi rigoureuse que la femme impose à l'homme, mais c'est une loi qui projette celui qui s'y soumet à un statut d'honneur, reconnu par le groupe.
La femme selon le wahhabisme
Le statut de la femme prôné par le wahhâbisme est bien connu ; il est devenu Ia loi appliquée en Arabie Saoudite. Son principe de base est la stricte séparation des sexes dans la vie sociale. Nous avons vu qu'elle a été imposée partout dans le royaume. Elle se traduit, entre autres pratiques, par le port du voile, obligatoire pour toute femme saoudienne dès sa puberté : il s'agit du voile noir qui couvre la totalité du visage, mais qui est suffisamment fin pour que la femme puisse voir à travers. Cette séparation est également appliquée avec rigueur à tous les degrés de l'enseignement, y compris à l'université. Elle l'est également dans le travail : elle est la raison principale de la réticence - allant parfois jusqu'à l'interdiction - ressentie à l'égard du travail des femmes. Enfin de nombreuses mesures ont pour fondement implicite qu'une femme n'est jamais majeure, mais doit toujours être sous la protection sociale d'un père, d'un frère, d'un époux, ou de quelque parent mâle : ainsi en est-il de l'interdiction de conduire des voitures, de prendre l'avion seule pour se rendre à l'étranger. Cette perspective, essentiellement moralisante, est en quelque sorte la prise en charge, par la communauté musulmane, de l'honneur de la femme, autrefois affaire du groupe tribal. Mais elle est aussi, de la part du rite le plus austère de l'Islam sunnite, l'expression d'un pessimisme profond qui se sent toujours menacé par la corruption - fasâd - . Un vieux croyant de ce pays citait ce proverbe : « Quand un homme est seul avec une femme, il y a toujours un troisième : le diable... . »
La femme et l'influence occidentale
La femme en Arabie Saoudite n'a pas échappé â l'influence extérieure. Celle-ci est partout présente, et de plus en plus, avec le développement de la consommation. Les voyages â l'étranger ont pu révéler â certaines femmes la condition différente faite à la femme tant en Occident que dans d'autres pays arabes. Cette constatation peut aussi être faite par celles qui sont restées au pays, lorsqu'elles voient les femmes étrangères qui y séjournent, spécialement les femmes arabes qui ne sont généralement pas voilées, et qui exercent divers métiers tels que enseignantes, infirmières, et même hôtesses de l'air...
Toutefois, deux facteurs ont une influence prépondérante sur cette évolution : l'instruction des filles et la télévision.
L'instruction des filles a commencé en Arabie en 1960 : elle était jusque là interdite. A cette époque fut créée une direction générale de l'enseignement des filles, dépendant, non du ministère de l'éducation, mais des autorités religieuses : mesure destinée à satisfaire l'opposition que cet enseignement rencontrait dans les milieux wahhâbites. Depuis cette date, cet enseignement s'est considérablement développé. Il en résulte un changement dans la mentalité des filles; après leur passage â l'école, elles acceptent moins facilement la soumission d'autrefois, ont soif de participer â la vie publique, et se trouvent, du fait de leur instruction, soumises à l'influence de la culture occidentale.
La télévision fonctionne en Arabie depuis 1965. Du fait de l'absence de vie sociale extérieure, ses programmes sont très suivis par les femmes et les filles. Celles-ci apprécient beaucoup - trop au gré des hommes -- les feuilletons télévisés, d'origine égyptienne ou libanaise, qui posent généralement le problème de la liberté de la femme, de son droit à épouser celui qu'elle aime : le caractère mélodramatique de la plupart de ces films n'empêche pas qu'ils aient une profonde influence. De plus, ils montrent une femme arabe moderne, conduisant sa voiture, vêtue â l'européenne. maquillée, parfois en train de fumer : image d'autant plus impressionnante qu'elle n'est pas celle d'une étrangère avec qui on n'aurait rien â voir, mais celle dune femme arabe musulmane : un modèle qui pourrait être suivi... On comprend dès lors l'extrême résistance - d'ailleurs souvent vaine - opposée par les hommes â la télévision : elle va directement à l'encontre des habitudes actuellement imposées dans le pays, et les hommes qui en parlent ne se privent pas de le souligner. Certains chefs de famille l'interdisent chez eux, totalement, ou pour certaines émissions : la permissivité en ce domaine reflète directement la profondeur de l'évolution dune famille.
L’image occidentale de la femme représente un élément troublant pour la culture saoudienne; elle est â la fois attirante et inquiétante : séduction pour les hommes, espérance d'affranchissement pour les femmes, elle comporte une remise en cause des rapports entre les sexes, et suscite de ce fait résistance et anxiété chez les hommes. Face â ces valeurs de la consommation, qui se sont introduites dans un monde déjà fait pour l'homme, la femme n'a pas tardé à récupérer l'arme de l'adversaire. La femme somme son mari de lui acheter ce que sa voisine a obtenu : défi à son statut social, défi porté à sa virilité, réinterprétée en termes de puissance à consommer. Dans un monde dont l'évolution semblait l'avoir laissée pour compte, la femme a retrouvé, face à son mari, la vieille arme du défi tribal : faire des choses difficiles pour obtenir une satisfaction qui, à l'instar des produits importés, n'atteint jamais de limite...
III. - VALORISATION ET DÉVALORISATION : LA DYNAMIQUE DES CULTURES
Trois normes culturelles coexistent en Arabie Saoudite. Profondément enracinées dans une langue, arc-boutées sur une longue tradition culturelle, elles présentent, pour tout ce qui concerne l'homme, une option spécifique, une solution propre, un comportement adapté. La question est maintenant de voir quels rapports s'établissent entre ces cultures, quels rapports chacune d'elles entretient avec les deux autres.
Trois références d'identité culturelle
Les trois cultures que nous avons examinées renvoient à des identités différentes. Chacune constitue un système.
La culture préwahhâbite
Cette culture n'est pas à identifier à un état naturel, même si les autres cultures ont tendance à la considérer sous cet aspect. Elle constitue un code, fondé sur ses propres valeurs : valeurs du sang, de la virilité, de l'honneur et de la cohésion du groupe, à l'opposé de l'individualisme légaliste. A ce titre, elle constitue, pour l'individu, son insertion première dans un groupe, son identité radicale, liée à la langue maternelle. En Arabie, cet enracinement de base apparaît surtout dans la conscience de l'appartenance tribale. A travers l'évanescence apparente de ce lien, on en perçoit encore la solidité dans les alliances matrimoniales. Pour beaucoup de Saoudiens, qui ont conscience d'avoir une réelle ascendance tribale - qabîlî - , il est à la fois inconcevable et impossible, c'est-à-dire, refusé absolument par le milieu social, de se marier avec quelqu'un qui serait sans ascendance tribale, ou qui appartiendrait à l'une des tribus de statut inférieur - khadîrî - . Ce critère est le dernier test - mais combien solide - de la permanence de ce qu'on peut appeler la culture bédouine.
La culture wahhâbite
La référence essentielle du wahhâbisme est l'Islam. Mais toutes les tribus, même étrangères au wahhâbisme, se sont toujours considérées comme musulma-
nes. Le propre du wahhâbisme est de se réclamer d'un Islam plus pur, et de considérer les autres musulmans comme étrangers à la voie droite, pour les assimiler à l'état des tribus avant l'Islam.
Si le wahhâbisme s'est souvent en Arabie imposé par la contrainte, en s'appuyant sur le bras séculier des Al Saoud, c'est au nom de cette légitimité d'un Islam plus pur. Il représente en effet la science - 'ilm - opposée à l'ignorance - juhl - . Sa force de persuasion se fonde sur cette supériorité de ceux qui savent sur ceux qui ignorent : à ce titre, par rapport à la culture précédente, il se présente avec une connotation de rationalisme religieux. Ce trait est corrélatif d'autres, qui sont la primauté du droit et de l'ordre dans la vie sociale (opposée à l'instabilité et à la turbulence des nomades). Au sujet de leur mouvement des ikhwân, Thesiger (op. cit., p. 310) dit qu’ « ils jugeaient la vie nomade incompatible avec une stricte conformité aux principes de l'Islam, qui exigeait une scrupuleuse observance des jeûnes, des prières et des ablutions. »
Actuellement, le wahhâbisme représente pour la majorité des Saoudiens une identité islamique supérieure, qui les place non seulement au dessus des ethnies ignorantes - la jâhiliyya , mais aussi des autres Arabes musulmans, qui ne suivent pas le rite wahhâbite - les shiites d'abord, mais aussi les sunnites des autres rites - et cèdent si facilement à l'influence occidentale, et naturellement, au-dessus des non-musulmans.
La culture occidentale
Il s'agit ici non pas de la culture occidentale en elle-même, mais de son influence en Arabie, c'est-à-dire de la façon dont elle y est perçue.
C'est sous l'aspect des techniques de développement qu'elle y a été introduite par Abdalaziz, souvent contre le gré des wahhàbites (comme ce fut le cas pour la radio, le téléphone et la télévision). Elle y apparaît sous deux aspects : la supériorité de la technique, et le pouvoir de l'administration. Dans la période récente, avec l'afflux des richesses dues au pétrole, elle apparaît dans le pouvoir de l'État qui, par ses subsides et ses interventions, reprend peu à peu en charge toutes les responsabilités autrefois dévolues aux familles et aux communautés : les veuves, les vieillards, les orphelins, etc.
Moins visibles sont les conséquences globales de cette inflation de consommation qui, dans la logique du système économique occidental, crée sans cesse des besoins nouveaux à seule fin de les satisfaire. Cette logique implique l'exaltation de l'individualisme, l'action de la publicité qui manipule l'imaginaire. Elle repose fondamentalement sur un système de contrôle social différent, qui libère en apparence une anarchie individualiste, pour mieux la contrôler par les mécanismes du conformisme social : système qui implique à la fois un excès d'individualisme et un excès de pression sociale intériorisée, dont on peut voir le symbole dans l'image de l'individu, seul devant son poste de télévision, livré à lui-même face aux messages publicitaires. C'est par le canal de cet imaginaire, là et ailleurs, que s'exerce la séduction sur l'homme saoudien de la culture occidentale.
Convergences et divergences
Dans cette imbrication de cultures au sein d'une même société, certaines convergences apparaissent, qui opposent deux d'entre elles à la troisième, selon des axes particuliers.
Culture traditionnelle et wahhabisme
Bien que différentes, ces deux cultures se situent sur un même continuum, l'appartenance à l'Islam, qui a toujours représenté un élément important pour les tribus. Cette appartenance à l'Islam fait que l'homme de la tribu peut se sentir valorisé par l'adhésion à un Islam plus pur : ce phénomène a joué particulièrement sur les tribus du Najd, les premières à être au contact de l'idéologie wahhâbite. Il s'y est produit une convergence qui confondait en une même réalité la double fierté d'être membre d'une tribu et disciple de `Abdalwahhàb : deux éléments ressentis comme conférant une supériorité. On peut ajouter que de nombreux traits de culture relèvent d'une inspiration commune, telle que celle qui définit le rapport de l'homme à la femme, et le sens de l'honneur.
Cette convergence constitue un élément décisif dans le nationalisme, qui oppose le Saoudien, en tant qu'homme du désert et de l'Islam, à l'étranger, dans la conscience d'une fierté encore renforcée par la richesse du pays, au point qu'elle est souvent ressentie par l'étranger, même arabe, comme de la xénophobie. Elle constitue sans nul doute la base solide d'une culture nouvelle centrée sur l'État.
Wahhâbisme et occidentalisme
Ces deux cultures ont en commun le culte qu'elles ont de l'explication rationnelle et la place qu'elles attribuent à la science. Certes ce mot est compris en deux sens différents : le `ilm que l'Islam oppose au juhl se situe au plan de la connaissance religieuse, mais ce courant joue souvent sur l'amalgame avec la science au sens laïque, en une philosophie proche de celle du siècle des lumières : certains plaidoyers sur les bienfaits de l'instruction ont un parfum très XIX° siècle. Cette convergence s'opère aussi en faveur de l'ordre, dans une dévalorisation de l'ignorance du bédouin, ignorance identifiée selon la culture soit au vice, soit à la sauvagerie.
Culture traditionnelle et culture occidentale
Ces deux cultures s'opposent au wahhàbisme dans ce que ce dernier comporte d'esprit d'austérité et de contrainte moralisatrice. Face à celui-ci, elles apparaissent comme marquées par une certaine spontanéité, un certain défoulement, une exaltation du corps qui apparaissent bien dans les chants et les danses d'autrefois, et dans les « rythmes américains » d'aujourd'hui. Un signe caractéristique en est, pour les jeunes gens, le port de cheveux longs, pratique qui réfère à une signification dans les deux cultures. Le bédouin d'autrefois, et encore aujourd'hui dans certaines régions, telles que le Sud-Ouest, porte les cheveux longs. Par ailleurs, cette coiffure passe pour être, chez les Occidentaux, le signe d'un caractère efféminé, associé à une certaine déviance, personnalisée dans le beat-nick. C'est pour cette raison que les rnutaawwa' pourchassent les jeunes gens, spécialement durant le mois de Ramadân, et leur font parfois couper les cheveux jugés trop longs. Comme ces jeunes gens, et particulièrement les étudiants, ont de plus en plus tendance à garder leurs cheveux longs, on peut se demander s'ils ne jouent pas, plus ou moins consciemment, sur l'ambiguïté de ce double registre symbolique, pour défier le moralisme tatillon des milieux religieux.
Cultures et pouvoir
Ces cultures que nous avons décrites dans leurs pratiques, leurs symboles, se présentent, de par leur cohésion interne, comme des structures. Mais dans le contexte global de la dynamique sociale, elles ne sont pas des entités autonomes, qui seraient dotées d'une efficacité propre et dérouleraient leurs effets selon la pure logique de leur propre système. Ces cultures sont des lois, mais elles n'exercent leur pouvoir que par les groupes sociaux, qui les reprennent, mais peuvent aussi les modifier. L'exemple le plus frappant en est le wahhâbisme : comme structure, il est bien aujourd'hui tel qu'il était à l'époque du roi Abdalazîz, mais quelle différence dans son contenu : sans se déjuger, il a intégré bien des éléments violemment refusés au départ : on voit aujourd'hui des imâm wahhàbites prêcher à la télévision... Ces cultures ne sont donc pas autonomes par rapport aux groupes sociaux.
On serait dès lors tenté de croire que ces cultures sont en relation privilégiée avec des groupes sociaux bien définis. Or la réalité n'est pas si simple : il n'y a pas d'homme, pas de groupe ni de catégorie sociale, et encore moins de classe, qui se réclame d'une seule de ces cultures à l'exception des autres. Bien plus, il faut dire que tous, individus et groupes, participent de ces trois cultures, ou si l'on veut, qu'ils subissent tous, d'une façon indissociable, la loi de ces trois normes. Il faut donc plutôt comparer ces trois cultures à des armes dont pourraient user également, selon les circonstances, tous les agents de la compétition sociale. On ne peut donc que tenter de préciser à quel usage chacune d'elles peut être utilisée.
La culture populaire a vu, avec la constitution de l'État, ses racines brisées dans l'éclatement de la structure tribale, et il en résulte une conscience de dépossession. Dépossession des territoires des tribus - dîra - : le territoire, par décret royal, a été ouvert à tous, est devenu propriété de la dynastie; des gens y sont venus d'ailleurs, de la part du gouvernement, et ont reçu en propriété des terres de la tribu : opération choquante quand elle a conduit à l'enrichissement des intrus par la spéculation immobilière, alors que les anciens propriétaires restent dans la pauvreté et dans l'humiliation. Dépossession des rites, (les chants, des danses, voire de la spécificité religieuse (dans le cas des shiites ou des zaydites), quand ces pratiques ont été dévalorisées, déconsidérées, quand ce n'est pas brutalement interdites. Dépossession même de la langue, avec l'extension du dialecte najdi, dévalorisant les autres, que leurs locuteurs n'osent plus proférer à Riyadh, par honte de trahir leur origine rurale. On peut se demander si la conversion à un autre genre de vie a été réellement intériorisée, ou si elle est encore vécue comme une contrainte imposée. La présence lancinante du débridement occidental ne facilite certes pas le processus. Toute la population est actuellement sous le charme de la société de consommation, mais on se demande où peuvent bien s'investir toutes ces énergies en sommeil, qui ne s'actualisent plus dans la guerre, la danse, la vie risquée, la sensibilité affinée : le stylo a-t-il vraiment enterré le sabre ?
Le wahhâbisme demeure le pilier du pouvoir : il reste le fondement de sa légitimité. Il en représente aussi la base historique, même si le roi Abdalazîz a dû se séparer des ikhwân pour pratiquer sa politique d'ouverture au monde moderne. Toutefois, ce courant est gêné par l'enlisement dans le matérialisme de la nouvelle société; il est conduit à se trouver en position de frein, de réaction permanente, de défensive, face à la formidable pression exercée par l'Occident. Son épreuve la plus grande se produisit lorsque le second roi de la dynastie, Sa'ûd ibn Abdalazîz, se laissa prendre aux appâts de la facilité et du luxe : le choc en est ressenti encore aujourd'hui et se manifeste dans le refoulement total imposé sur le personnage : portrait retiré des séries, nom omis, silence pesant... Certes, dans le passé, le wahhâbisme a fait montre de capacités d'adaptation étonnantes : l'instruction des filles, après de longues résistances, a été acceptée, alors qu'elle est en train de bouleverser la société en profondeur. Maintenant, d'autres licences lui sont demandées : les cinémas ? les femmes au volant ? l'alcool ? Ces points, et quelques autres, constituent des éléments symboliques de reconnaissance et de résistance. Il faut reconnaître que les arguments deviennent difficiles, qui permettraient aux wahhabites de convaincre leur opinion publique : celle-ci a sous les yeux, en images réelles ou télévisées, le spectacle de la « licence » que se permettent d'autres pays arabes se prétendant bons musulmans. Plus grave sans doute est la rumeur toujours amplifiée des excès que se permettraient certains privilégiés du régime, à l'ombre des murs de leurs palais ou durant leurs séjours à l'étranger. On se demande souvent quelle force sociale constitue la base de cette force politique réelle que représente le wahhâbisme. Peut-on, pour le déterminer, se baser sur un clivage de génération, de région, de catégorie sociale, telle que celle des petits fonctionnaires ? On ne tarde pas à découvrir que, là non plus, il n'y a pas de référence unique, c'est-à-dire que, sur certains points, l'ensemble de la population se retrouve wahhàbite : tel est sans doute le cas de la majorité des hommes par rapport à la question du statut de la femme.
L'influence occidentale constitue elle aussi un support important du pouvoir. C'est en prenant appui sur elle, par la technique et les alliances, que le roi Abdalazîz put asseoir définitivement son autorité sur les tribus. Elle est présente dans le pays par l'idéologie du développement qui conduit, sous l'étendard de la modernité, à effacer soigneusement les traces du passé, telles ces villes à architecture en pisé comme Burayda, ou de bois et de pierre comme Jedda, qu'on éventre à coups de bulldozer. Sur l'habitat comme sur les autres domaines, l'Occident fait intérioriser de nouvelles valeurs, qui conduisent les Saoudiens « évolués » à avoir honte de ce passé et à tenter d'en gommer toute trace.
L'imbrication toujours croissante de l'Arabie Saoudite dans l'économie mondiale par le biais de sa production pétrolière, le profond bouleversement que les nouveaux modes de consommation introduisent dans la mentalité, conduisent à renforcer sans cesse en ce pays le rôle et le pouvoir des technocrates, dont la couche supérieure est formée aux États-Unis et en revient avec le propos de moderniser le pays et de le gérer à l'américaine. Comme leur idéologie trouve une secrète complicité dans l'appétit de consommation répandu dans la population, ils se trouvent être dépositaires d'un pouvoir toujours plus fort. Il faut noter toutefois que l'excès de leur pouvoir risque de se retourner contre eux, car leur politique conduit à une occidentalisation, à une nouvelle identité, qui se trouve en contradiction avec l'identité arabo-islamique incarnée dans les deux autres cultures : les récents événements d'Iran ont brutalement révélé au monde la fragilité de ces grands jeux de construction baptisés développement.
Quelles perspectives ?
L'Arabie Saoudite est profondément marquée par le pluralisme des cultures. Nous les avons ramenées à trois, mais la culture préwahhâbite représente en réalité une multiplicité de cultures différentes les unes des autres, bien qu'elles tiennent une place unique dans la structure globale. Ces cultures ne sont pas juxtaposées, elles sont profondément imbriquées. Il ne subsiste aucune plage du psychisme de l'individu, aucun arpent de l'immensité du désert qui ne subissent aujourd'hui l'influence de chacune d'entre elles. Ces cultures présentent parfois des convergences, mais, plus souvent, ce sont des divergences qui les opposent et engendrent des conflits. Si ces conflits se traduisent parfois par des effets de pouvoir directs tels que l'interdit, c'est le plus souvent par la valorisation ou la dévalorisation que se traduisent ces oppositions.
Ces lois que représentent les cultures, les divers groupes sociaux tentent de les faire jouer à leur profit, sans qu'il y ait, pour le moment, identification d'aucune catégorie sociale avec une culture précise. Ces tentatives font surgir les conflits culturels dans l'univers politique. Le trait le plus clair actuellement en est la tentative d'une classe privilégiée de la fortune ou du savoir de se ménager un accès toujours plus large aux libertés de la culture occidentale, en en interdisant l'accès aux autres, ce qui conduirait à un clivage social des références d'identité : les classes populaires seraient chargées de perpétuer la culture arabo-islamique et la langue arabe, tandis que l'intelligentsia représenterait la vitrine moderniste par sa technologie, son style de vie et son langage anglais. Cette évolution, qui conduit à accentuer une division de classes, fondée non sur les structures de la production, mais sur celles de la consommation, et à imposer des normes culturelles différentes aux couches de la population, représente sans doute l'aspect le plus dangereux et, à terme, le plus explosif, de l'évolution actuelle. Elle conduirait en effet à rejeter dans l'insatisfaction et dans l'arabisme marginal de larges fractions de la population, tandis que d'autres se ménageraient des accès toujours plus larges aux facilités de la vie occidentale : une même étiquette nationale de « saoudien » pouvant être chargée de jeter un voile pudique sur cette disparité.
L'autre évolution possible serait que soit comprise et assumée la richesse du pluralisme culturel et les perspectives qu'il offre, dans l'avenir, à une synthèse qui en intégrerait les composantes majeures. Certes, dans le passé et le présent, l'acharnement wahhâbite à extirper la culture populaire comporte un danger extrême pour l'identité saoudienne future : cette culture en effet, appuyée sur l'Islam, même sur certaines de ses formes wahhâbites, est seule susceptible d'opposer un rempart solide à la formidable entreprise de dépossession qui menace la péninsule, â travers l'influence occidentale. Celle-ci peut toutefois être bénéfique, à condition que soient préservées dans le pays les structures capables d'assimiler les éléments utiles pour une évolution harmonieuse de la culture saoudienne.
|
| (1) La khayzarâna est la baguette souple que la jeune fille tient à la main dans certaines danses, mais son symbolisme renvoie à la jeune fille elle-même, la souplesse des mouvements imprimés à la baguette évoquant la sveltesse de la danseuse; elles sont ici identifiées. Quant à Abu Khayyâl, c'est un personnage fantastique qui évoque le monde des esprits (jinn).
BIBLIOGRAPHIE
Nous nous bornons à indiquer ici quelques ouvrages cités dans le texte précédent, ou particulièrement utiles.
ABDALLAH AZ-ZAMIL, Min al-adab ash-sha'bî [La culture populaire]. Riyadh, 1978.
'ATIQ IBN GHAYTH AL-BILADI, Al-adab ash-sha'bî fî-l-hijâz [La culture populaire au Hijaz], Damas, 1977.
HOBDAY (Peter). Saudi Arabia today. London, The Macmillan Press, 1978.
LACKNER (Helen), A House built on Sand, London. Ithaca Press, 1978.
PHILBY (H. St .J.), Arabia of the Wahhabis, London, Frank Cass, 1928.
PROCHAZKA (Theodore), Dialects of Saudi Arabia. (A paraitre).
RENTZ (G.) , Article : Ikhwân. Encyclopédie de l'islam. 2ème éd., t.III, 1971, pp. 1090-1095.
SOULIE (J. L.) et CHAMPEN0IS (L.), Le Royaume d’Arabie Saoudite à l’épreuve des temps modernes, Paris, Albin Michel, 1975.
THESIGER (Wilfred). Le Désert des Déserts, Paris, Plon, 1978 (traduction de Arabian Sands, 1959).
|
|