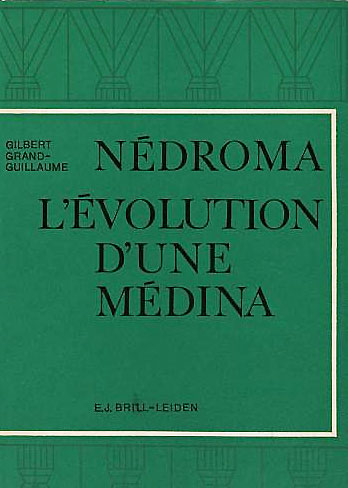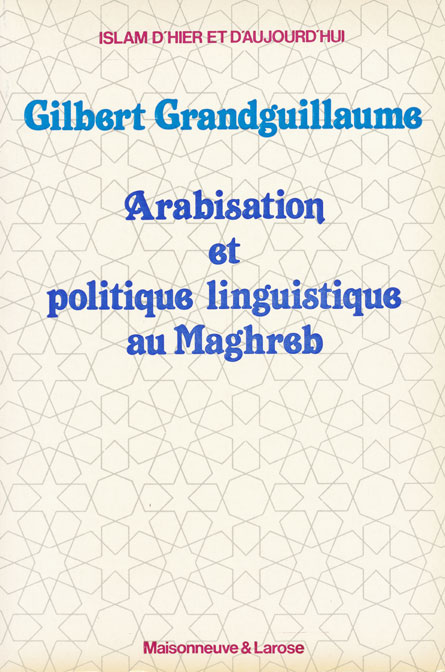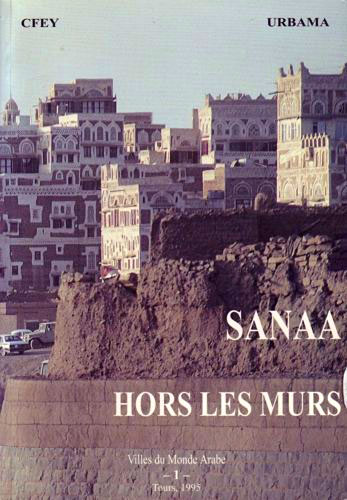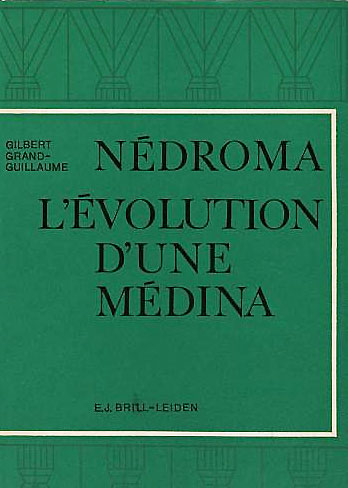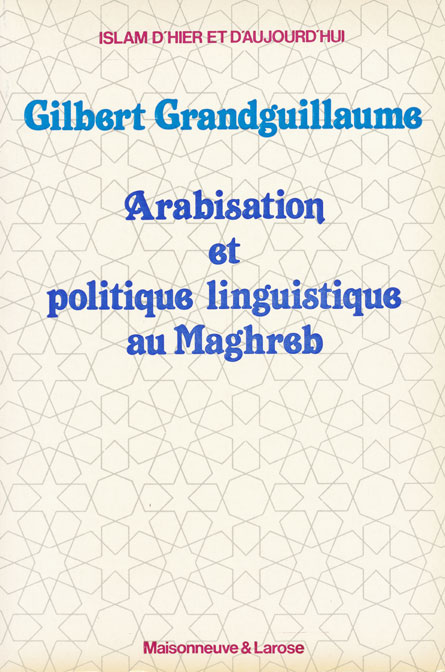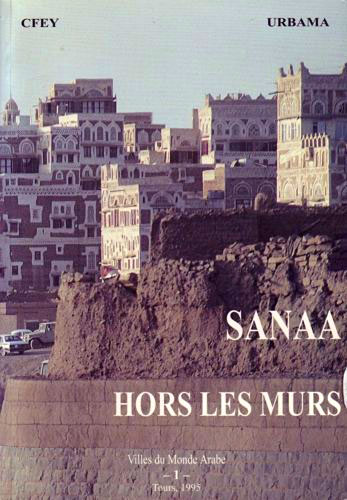|
Articles
| L’arabisation en Algérie des ‘ulamâ’ à nos jours |
. |
La France et l'Algérie : leçons d'histoire. De l'école en situation coloniale à l'enseignement du fait colonial
|
La question de l’arabisation, posée depuis 1962, continue à faire problème dans l’Algérie de 2006. Conçue au départ comme une volonté de réintroduire dans l’univers linguistique algérien une langue arabe « classique » (c’est-à-dire différente de la langue parlée), elle est devenue de nos jours un enjeu politique et idéologique majeur : symbole de l’ « école sinistrée » pour les uns, elle est pour les autres l’emblème de l’islam et de la référence au monde arabe. Le pouvoir qui tente de rénover l’enseignement en réintroduisant le français applique sa réforme sous le contrôle vigilant d’une opinion ambivalente : elle veut bien la réussite par le français mais elle est enracinée dans une identité musulmane dont la langue arabe est le repère. Cette opinion est de toute façon réticente face à un pouvoir qui n’a jamais pu incarner une identité algérienne authentique, et doit donc continuer à s’appuyer sur ses deux substituts : l’islam et la lutte anticoloniale. De ce fait toute mesure touchant à la langue arabe s’avère délicate dans la mesure où elle concerne une référence mythique. La langue est ainsi une question éminemment politique.
Il n’est pas possible dans cette brève communication de traiter de l’ensemble de cette question. Je me contenterai de situer cette langue arabe dans le contexte algérien, depuis le mouvement réformiste des années 1930 jusqu’à ce jour pour en révéler la complexité.
1. Renaissance de l’arabe avec le mouvement des ‘ulamâ’
Par la confiscation des biens habous qui supportaient l’enseignement en arabe, la colonisation en a sapé les structures entre 1830 et 1844. Celui-ci ne subsistait plus que sous la forme d’écoles coraniques de villages, dans un climat de suspicion de l’administration coloniale. A un niveau supérieur les études devaient être poursuivies hors de l’Algérie, en Tunisie, au Maroc ou au Moyen-Orient. En Algérie même seules quelques medersas offraient un enseignement musulman de qualité médiocre .
Dans un contexte d’éveil du nationalisme le mouvement des ‘ulamâ’, sous la guidance de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, milita pour un réveil d’une nation algérienne opposée à l’idéologie assimilationiste. Chacun connaît sa fameuse phrase emblème : « L’Algérie est ma patrie, l’arabe est ma langue, l’islam est ma religion ». Dans le sillage de ce mouvement de nombreuses écoles (dites médersa) furent créées, qui enseignaient la langue arabe en dehors des heures scolaires. Cet enseignement était doublé de conférences aux adultes, conférences dont le thème principal était la rénovation de la religion musulmane, qu’il fallait détacher de ses déviations populaires mises en œuvre par les confréries. Ce mouvement, qui accompagnait en sous-main la revendication nationaliste, eut un immense succès dans tout le pays. J’en ai recueilli un écho dans mon enquête des années 60 dans la ville de Nédroma , dans l’ouest algérien. La population gardait le souvenir du prédicateur envoyé par Ben Badis, Abdelwahab Benmansour (qui fut plus tard directeur de la Bibliothèque royale à Rabat). Ses cours d’arabe étaient suivis par la majorité des élèves de l’école publique. Ses conférences faisaient salle comble : il était d’une éloquence enflammée et suscitait l’enthousiasme. Toutefois les mêmes témoins se souvenaient du grand trouble suscité par ses propos hostiles aux confréries, qui engendraient la zizanie au sein de la population et même des familles. Le début de la guerre de libération mit cette réforme en sourdine, mais l’élan avait été donné.
Que penser aujourd’hui de ce mouvement ? Ce retour de la langue arabe et de sa culture était le bienvenu et représentait une introduction culturelle à l’indépendance. S’il est vrai que celle-ci fut vécue par la population de base comme le retour de la terre aux musulmans et l’expulsion des infidèles, le message réformiste en fut l’expression théorique, par le lien qu’il a institué entre Algérie, islam et langue arabe, lien qui demeure profondément ancré aujourd’hui. Les leader du mouvement rejoindront le FLN et seront à nouveau présents dans l’Algérie indépendante, notamment Tawfîq al-Madani, mais la confusion des trois données considérées comme seules composantes de l’identité algérienne a mis entre parenthèses l’entrée de l’Algérie dans une aire de développement moderne : au lieu de tenter de la repenser, elle l’a enfermée dans une contradiction, rendant ainsi impossible la constitution d’une identité algérienne forte de ses multiples composantes.
Par ailleurs, la survalorisation de l’arabe classique par rapport aux langues parlées (langues de la rue, du sûq, disait Ben Badis) devait marquer la politique linguistique ultérieure : une hostilité irraisonnée aux langues parlées, arabes et encore plus berbères. Ce mépris du peuple se retrouve dans l’hostilité aux confréries, c’est-à-dire aux formes concrètes et populaires de religiosité qui constituèrent un socle important de la résistance identitaire algérienne, après que tous ses autres supports lui eussent été enlevés. Ce qui se voulait une renaissance de l’islam s’est en fait traduit par l’éradication de la culture populaire algérienne : une tendance qui se retrouvera plus tard dans les manuels d’histoire, où une place infime sera réservée à l’Algérie, au bénéfice des pays du Moyen-Orient .
Toutes les pratiques futures du FLN dans le domaine de l’arabisation sont donc en germe dans le mouvement des ‘ulamâ’ (pourtant célébré chaque année le 16 avril, anniversaire de la mort de Ben Badis, comme « Journée du Savoir, yaum al-‘ilm » ) : caractère religieux de la langue arabe (affichée comme langue nationale), mépris des langues parlées algériennes, méconnaissance de la réalité algérienne à laquelle est substitué un mythe arabo-islamique. Cette tendance sera renforcée durant la guerre de libération, en contrepartie du soutien apporté par les pays arabes à la lutte du FLN.
2. La politique d’arabisation de Ben Bella et Boumediène
Le salut de l’Algérie en ce domaine eut été la recherche d’un équilibre entre les deux impératifs majeurs : le développement du pays qui nécessitait une certaine ouverture vers l’Occident, et celle-ci passait par l’usage de la langue française, et la restauration d’une personnalité algérienne qui se traduisait pour une grande partie de la population par le lien à l’islam. Sur le plan linguistique, cela signifiait une option claire de bilinguisme : maintien du français et enseignement de l’arabe. La Tunisie et le Maroc, qui disposaient d’élites bilingues, firent ce choix. En Algérie au contraire ces deux tendances se constituèrent en clans opposés. Les « francophones » qui détenaient tous les atouts du pouvoir ne surent pas s’ouvrir à la demande d’arabisation, la redoutant comme une menace de théocratie. Mais ils y furent suffisamment sensibles pour entretenir une mauvaise conscience qui les empêcha de s’y opposer franchement et qui les conduisit, à travers des manœuvres opportunistes, à finalement perdre la partie. Les « arabophones » issus du mouvement réformiste ou fraîchement émoulus des universités du Moyen-Orient, généralement monolingues, n’eurent de cesse de chasser les agrégés d’arabe bilingues issus de l’université française. L’arabisation dont ils réclamaient la promotion ne pouvait dès lors être qu’une lutte contre la dominance de la langue française. Derrière cette revendication idéologique se cachait aussi la volonté d’accéder aux postes de l’administration et de l’enseignement. Dans une déclaration récente le président Bouteflika résumait à cet aspect la question de l’arabisation : « Il n’y a pas eu de problème linguistique en Algérie, juste une rivalité et des luttes pour prendre la place des cadres formés en français ! » Ce courant réformiste reçut l’appui des ba’thistes qui œuvraient à la construction de la « grande nation arabe » et dont l’un des représentants les plus en vue fut Abdelhamid Mehri.
Entre les deux camps la controverse fut violente, et on peut dire qu’elle le demeure aujourd’hui. Au début les positions était un choix d’arabisation radicale opposé à une option de bilinguisme arabe-français. L’arabisation comme telle prit figure de dogme national et ne pouvait être contestée que sous la forme d’une remise à plus tard. S’y ajoutèrent peu à peu les autres points de vue : le français était la langue du pain, l’arabe était défavorisé. D’où les mesures d’arabisation de la fonction publique, puis des divers degrés de l’enseignement.
Les étapes de la progression de l’arabisation, année par année dans le primaire, matière par matière dans le secondaire, sont connues . Globalement on peut dire que, jusqu’à la mort de Boumediène, c’est une option implicite – c’est-à-dire non assumée – de bilinguisme qui fut pratiquée. L’arabisation progressait dans l’enseignement primaire et secondaire, mais son extension à l’université était largement verrouillée. Pour lever ce verrou, Abdelhamid Mehri , secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et promoteur de l’arabisation, faisait en sorte de ne plus présenter à l’entrée de l’université que des bacheliers arabophones, tout en réduisant dans son secteur la formation des professeurs de français. La situation fut cependant assez grave pour que Boumediène envisage, en avril 1977, une « pause de l’arabisation » par la nomination de Mostefa Lacheraf à l’Education nationale et de Abdellatif Rahal à l’Enseignement supérieur. Son affaiblissement puis sa mort le 27 décembre1978 firent que cette pause fut de courte durée.
Cette période de bilinguisme de fait eut pu être l’occasion d’organiser une symbiose des deux langues. Or chaque secteur fonctionnait de façon compartimentée, tant était grand l’écart des formations et des cultures de référence.
Dans un premier stade, l’Algérie eut largement recours à la coopération. Les élèves suivaient successivement les cours d’enseignants français et moyen-orientaux dont les pédagogies étaient aux antipodes : rationalisation d’un côté, mémorisation de l’autre, sans parler des idéologies. Puis fut réalisée l’algérianisation du corps enseignant, mais le même fossé séparait les deux blocs, aggravé maintenant par une concurrence directe pour les places : la suppression de l’enseignement d’une matière en français ouvrait la place à un autre enseignant chargé de l’enseigner en arabe (si l’on excepte les cas, assez minoritaires, de passage du même enseignant à un enseignement en arabe). De ce fait la langue arabe restait enfermée dans l’équation des ‘ulamâ’ : arabe-islam-patrie. Certes Ben Bella avait bien déclaré que « l’arabisation n’était pas l’islamisation », et Boumediène que l’arabe était « la langue du béton et de l’acier ». Ces déclarations demeurèrent des vœux pieux face à un secteur politique et économique qui fonctionnait en français. Au lieu de promouvoir la langue arabe vers une pédagogie moderne ouvrant sur la richesse du patrimoine de la culture arabe, on la laissa prisonnière de sa référence religieuse et traditionnelle, et qui plus est, réduite à traduire la langue française qu’elle devait remplacer. On ne pouvait mieux faire pour produire un système schizoïde, conséquence d’autant plus grave qu’elle se greffait sur une ambivalence profonde vis-à-vis des deux systèmes incarnés par les langues arabe et française. Si on ajoute à cela que l’école comme le pouvoir affichaient un profond mépris pour les langues maternelles des élèves, on aura quelques clés pour comprendre la désorientation de cette génération et de celles qui ont suivi.
Autre aspect de la question : certes les parents ont toujours compris que le français était « la langue du pain » et agi en sorte que leurs enfants soient scolarisés dans les sections bilingues là où elles existaient, déjouant ainsi l’hypocrisie des élites qui prônaient l’arabisation… pour les autres. Mais on ne peut pas en conclure que l’enseignement de l’arabe ne fut pas bienvenu : au contraire, les parents, qui ignoraient généralement cette langue à son stade écrit, ( et qu’on persuadait que, pour cette raison, ils étaient de moins bons musulmans…), virent avec admiration leurs enfants en tracer les signes, les caractères sacrés du Coran. Ceci provoqua peu à peu un renversement des générations : le savoir religieux était désormais détenu par les enfants, gestionnaires du droit. La conséquence en apparaîtra plus tard, avec la naissance de l’islamisme, qui saura tirer profit de cette inversion de la légitimité au sein des familles.
3. Chadli Bendjedid et la montée de l’islamisme (1979-1992)
Lors de son passage au ministère de l’Education, M.Lacheraf avait limogé toute l’équipe de direction responsable de l’arabisation. Celle-ci trouva refuge au Comité central du FLN. Or dès la mort de Boumediène en décembre 1978 le parti, mis à l’écart depuis 1964 refit surface et exerça une influence sur le nouveau président Chadli Bendjedid. Son action, menée sous la houlette de l’ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi et de Abdelhamid Mehri, eut pour visée l’accentuation de l’arabisation. L’arabisation des sciences sociales à l’université fut décrétée le 14 septembre 1980 avec application immédiate. Son extension aux autres secteurs fut planifiée. Les questions de pédagogie, de matériel et même d’enseignants furent l’objet de réunions, séminaires, c’est-à-dire pratiquement laissées au hasard. Ce fut le début de l’éviction de l’université de ses meilleurs cadres, éviction complétée par les évènements de la guerre civile dans les années 90. Même accélération dans l’enseignement secondaire, qui vise à ne plus former que des bacheliers arabisés. A partir de ce moment l’arabisation pouvait être considérée comme achevée et M.Mehri partir comme ambassadeur à Paris en 1984. Quant à la situation difficile de l’enseignement elle fut encore aggravée par la crise économique de 1986 liée à la baisse des revenus du pétrole.
Pour parachever l’arabisation du milieu, une loi fut préparée par Mouloud Kassim Naït-Belkacem en 1989 (sur le modèle de la « loi Toubon » du 31-12-75) imposant sous peine de sanctions la généralisation de l’emploi de la langue arabe pour 1993, loi qui fut votée par les députés le 17 novembre 1990 et publiée au Journal Officiel le 16 janvier 1991.
L’arabisation s’accompagnait de l’islamisation du milieu. Le 22 mai 1984 fut voté le Code de la famille, directement inspiré de la chari’a et plaçant la femme dans un statut de mineure à vie. C’est en effet du côté de l’islam que le pouvoir, en perte de légitimité, se tourna pour tenter d’en retrouver. Les signes de son affaiblissement se multiplient avec Chadli Bendjedid. Le parti du FLN impose son influence en obligeant tous les cadres des organisations de masse à en faire partie à partir du 1er janvier 1981 (article 120 des statuts du parti). La corruption, latente depuis Boumediène dans une économie d’assistance généralisée et d’importation systématique, éclate au grand jour et fait l’objet de dénonciations publiques. C’est sur cette base que va se développer dans les années 80 le mouvement islamiste, prenant appui sur les mosquées, et s’emparant du monopole de la dénonciation d’un pouvoir de plus en plus honni. La période est marquée par de grandes émeutes urbaines à Constantine, Annaba, Oran et finalement Alger en octobre 1988. Celles-ci marquent le début d’une période de « libéralisation », de multipartisme, dont profitera surtout le Front Islamiste du Salut (FIS), animé par Madani et Belhadj. Le FIS remporte le premier tour des élections législatives en décembre 1991. Le président Bendjedid semble prêt à partager le pouvoir avec lui quand il est renversé en janvier 1992 par un coup d’Etat militaire aux apparences légales.
Durant cette période l’arabisation a gagné en extension sinon en qualité. Dans l’enseignement primaire et secondaire, elle est la langue de toutes les matières enseignées, sauf le français. Encore l’enseignement de celui-ci est-il souvent non assuré du fait du manque d’enseignants, principalement en dehors des grandes villes et dans les régions du Sud. Mais surtout elle a changé de coloration : il n’est plus question de réserve, elle est ouvertement liée à l’islamisation, comme en témoigne une déclaration d’un ministre des affaires religieuses de l’époque. Cette tendance est, comme dit précédemment, liée à la carence de légitimité du pouvoir. Mais elle est surtout contemporaine de la montée du FIS. Si ce dernier s’empare peu du thème de l’arabisation, il l’inclut dans l’imposition qu’il réalise par ses réseaux de nouvelles pratiques islamiques, allant des comportements aux habitudes vestimentaires et alimentaires. De nombreux enseignants d’arabe deviennent des zélateurs de ces pratiques au sein des établissements scolaires. Les élèves sont souvent utilisés pour contrôler l’ « orthodoxie » des parents. La position de ceux qui veulent échapper à cette pression dans les écoles ou les quartiers devient de plus en plus difficile : c’est le cas notamment des enseignants de français. Il faut ajouter que cette situation est souvent acceptée dans l’espoir de mettre à bas un régime militaire qui règne par le coup d’Etat depuis 1962. Quant à l’élite elle avait été privée de toute échappatoire en septembre 1988 par l’interdiction édictée par Chadli Bendjedid aux enfants algériens (même issus de couples mixtes) de fréquenter les établissements de la Mission culturelle française. Enfin vont apparaître de graves distorsions à l’intérieur des familles, analogues à celles qui les divisèrent à l’époque des ‘ulamâ’, notamment dans le cas des enfants devenus islamistes et s’opposant violemment à leurs parents au nom d’une nouvelle légitimité.
4. La guerre civile et la tentative d’une réforme
L’ « interruption du processus électoral », selon l’euphémisme consacré, mit un coup d’arrêt à la progression du FIS et porta au pouvoir un organisme provisoire présidé par Mohamed Boudiaf, assassiné en juin 1992. Des années d’incertitude, de violences délimitent une période qui va jusqu’à l’élection du président Liamine Zeroual en novembre 1995 puis à celle du président Abdelaziz Bouteflika en avril 1999.
Le président Boudiaf avait déclaré l’école algérienne « sinistrée ». Au-delà du démantèlement du système d’enseignement (corps enseignant et établissements), c’est l’école dans son ensemble qui était désignée et pas seulement dans ses années récentes. Ce diagnostic, pour sévère qu’il fut, ne pouvait guère être démenti, sauf peut-être par ceux qui avaient mis en place l’arabisation, qui demeurèrent à leurs postes et y sont encore influents aujourd’hui. Dans la réaction hostile à l’islamisme de l’époque, on incrimina l’arabisation. Mais la critique doit moins viser la réintégration de la langue arabe dans la société algérienne – qui fut et demeure légitime – que la façon dont elle fut réalisée, dans une optique de renfermement, au mépris de la pédagogie. Il faut bien admettre aujourd’hui que ceux qui s’emparèrent de la gestion du système d’enseignement étaient moins guidés par des soucis pédagogiques que par l’opportunisme politique.
Dans ces années la politique d’arabisation ne fut jamais désavouée. Certes le Comité Consultatif National (CCN) décida en août 1992 le report de l’application de la loi sur la généralisation de la langue arabe sans toutefois l’abolir. Cette loi fut votée à l’unanimité le 17 décembre 1996 par le Conseil National Transitoire (CNT), pour application à partir du 5 juillet 1998, sans toutefois que personne ne s’enquit par la suite de son application. Il en est de même du Code de la famille. Tout ce qui concerne l’arabe et l’islam est tabou, et nul politique n’ose les aborder sinon pour les révérer. Il s’agit là de constantes intouchables dans une société qui a traversé des étapes étonnantes, s’est confrontée à la mondialisation par les media, l’apparition de nouveaux objets, le bouleversement des générations et des mœurs. On peut y voir le signe d’une société qui, défiante de son régime politique, incertaine de son identité, inquiète de son avenir, persiste à voir dans l’islam et la langue arabe les seuls traits susceptibles de la définir, voire de lui conférer une relative stabilité.
Le comportement du président Bouteflika sur ce domaine est particulièrement instructif. Il est certes le premier président algérien à oser s’affranchir publiquement de la langue de bois imposée par les arabisants et leur organe représentatif, l’Association pour la Défense de la Langue Arabe (ADLA), quitte à faire l’objet des critiques d’un Abdelkader Hadjar . Malgré la loi il a osé utiliser en public la langue française, et proclamer la nécessité du multilinguisme en Algérie. Les controverses anciennes liées à la dénégation de la place des langues parlées, notamment le berbère, ont été soldées par la reconnaissance d’une place officielle à la langue berbère. Par ailleurs il a mis en place une Commission Nationale de Réforme du Système Educatif (CNRSE) dont les travaux ont duré l’année 2000. Bien que les débats en aient été tenus secrets, on sait qu’ils ont opposé les deux clans traditionnels qui constituent la trame de la vie politique algérienne : partisans d’un monolinguisme arabe adossé à un islam conservateur à ceux d’un plurilinguisme (appuyé sur le français) ouvert à la modernité. La place du français dans l’enseignement, mais aussi l’enseignement de l’histoire, de la morale, ont fait l’objet de vifs débats. Si le clan « moderniste » s’est révélé majoritaire, sa victoire n’a pu être affichée, le rapport a été tenu secret, pour ne pas raviver d’anciennes haines.
Si des éléments de réforme sont effectivement mis en place, concernant notamment l’utilisation du français, mais aussi la pédagogie, ces mesures ne peuvent être appliquées qu’avec précaution, et régulièrement contrebalancées par des démarches ostentatoires telles que l’ouverture d’une semaine du Coran, ou des rappels à l’ordre répétés à ceux qui seraient tentés (les écoles privées spécialement) de négliger l’enseignement de l’arabe et des programmes algériens au profit d’un enseignement en langues étrangères. Des organes de presse francophones s’empressent d’y dénoncer un rejet du français, alors qu’ils ne sont que les contrepoids nécessaires que le pouvoir juge inévitable de mettre à son action.
Ces évolutions posent la question majeure des tendances profondes de l’opinion algérienne sur cette question de l’éducation et de l’arabisation. Dans la phase actuelle, on assiste à un retour massif du français, dans les programmes, dans les formations de professeurs dont on fait cruellement défaut. Missions diplomatiques et instituts de francophonie veulent y voir le triomphe de la modernité et le rejet d’une langue arabe qu’ils ont toujours mal supportée. Ils auraient grand tort de s’en réjouir trop vite. Si la rénovation du système éducatif algérien passe par là, elle ne saurait s’y réduire. La restauration de la langue arabe avec ce qu’elle symbolise a été et reste une requête de la société algérienne. Elle s’est faite, dans le cadre de la politique d’arabisation, à rebours de la pédagogie, mais elle demeure un acquis auquel il serait risqué de renoncer. Au contraire la stabilisation des tendances divergentes internes passe par un intérêt particulier à accorder à la langue arabe, à son enseignement, à son contenu, à son ouverture. Si des signaux sont adressés par la société algérienne en direction de la modernité, il en est d’autres qui émanent des sources autrefois formalisées par les ‘ulamâ’. S’agit-il de tensions internes irréductibles, de comportements ambivalents, de marques toujours douloureuses de violences subies depuis des décennies ? Il n’est pas possible aujourd’hui de prévoir si la balance penchera d’un côté ou si un équilibre fragile sera longtemps maintenu. Il est non moins certain que, dans la construction d’une Algérie apaisée, le rôle des langues demeure capital.
|
| Sur la question des médersas et des écoles coraniques, voir Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), PUF, Paris, 1968, tome 1, p.324, 328-332.
Voir Mérad, Ali, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d’histoire religieuse et sociale, Paris - La Haye, Mouton & Cie, 1967.
Voir Grandguillaume, Gilbert ,« Une médina de l’ouest algérien : Nédroma », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, Aix-en- Provence, N°10, 1971, p.69-73.
Ghalem, Mohamed et Remaoun, Hassan,Comment on enseigne l’histoire en Algérie, CRASC, Oran, 1995.
El-Watan, 22-05-1999.
Mon article « Les enjeux de la question des langues en Algérie », in Les langues de la Méditerranée, dir. Bistolfi, Les Cahiers de Confluences, L’Harmattan, Paris, 2002, p.141-165. Pour une vue plus globale, voir mon ouvrage Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, et Taleb-Ibrahimi, Khaoula, Les Algériens et leur(s) langue(s), Alger, El-Hikma, 1995.
Lettre ouverte au président Bouteflika (El-Moudjahid du 17-10-1999)
|
|