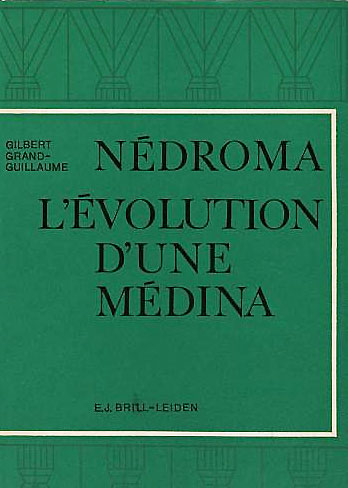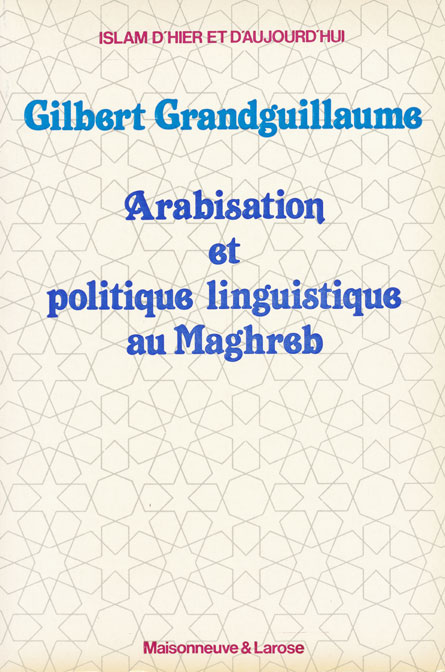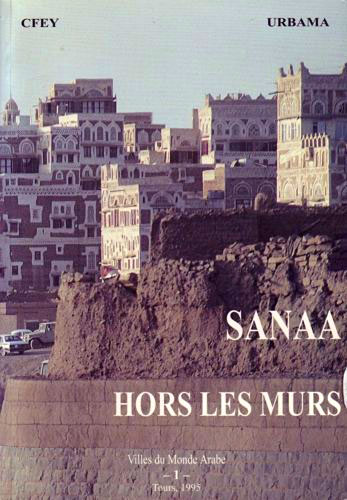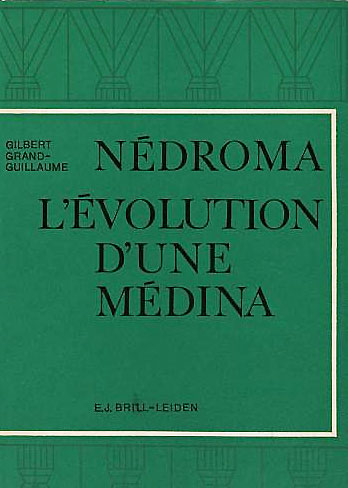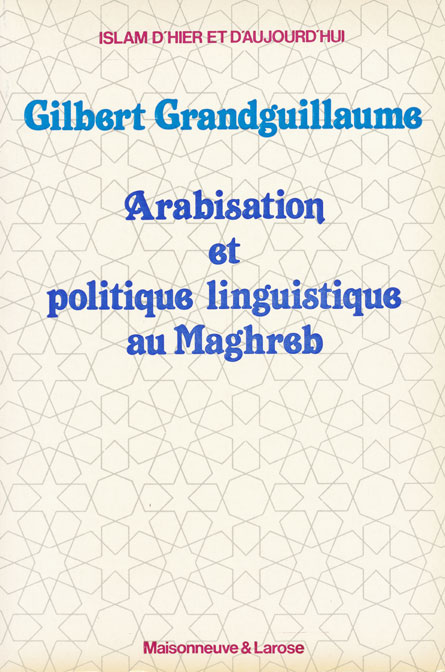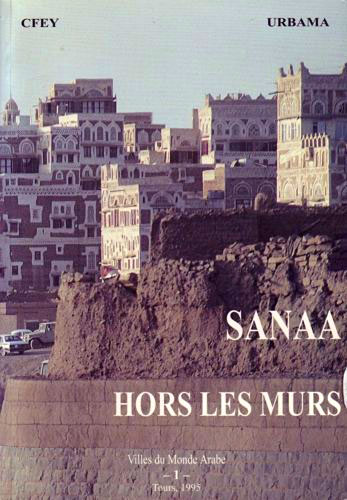|
Articles
| LES CULTURES OUBLIÉES DU CORAN |
. |
Diogène N° 226, avril 2009, Philosophie et islam dans les sociétés musulmanes, p.58-71
|
Les cultures peuvent-elles travailler les civilisations comme c’est le cas pour les individus, chez qui un élément refoulé de son parcours personnel ou généalogique peut imprimer une marque, voire causer un trouble dans le présent ? Peut-on poser dans les deux cas l’hypothèse que des conflits mal réglés dans le passé, des origines « oubliées », au sens de refoulées, peuvent ressurgir dans le présent sous la forme de malaises, de conflits, de passions qui, s’ils ne peuvent évidemment pas s’y réduire, sont cependant fortement compliqués par ces « oublis » ? Dans son ouvrage L’homme Moïse et le monothéisme, Freud (1986 : 189) dit que « l’oublié n’est pas effacé, mais seulement refoulé ». Vouloir poser ces questions à propos des origines de l’islam est certes présomptueux, c’est pourquoi ces pages se contentent de poser quelques questions comme des pistes de réflexion.
L’argument principal en est que les mots du Coran dans leur littéralité semblent parfois renvoyer à des langues ou à des cultures autres que celles que mentionne l’apologétique musulmane traditionnelle et faire ainsi appel à des origines que celle-ci a écartées de son discours. La question de base est en effet celle-ci : le prophète a-t-il vécu dans un contexte arabe relativement isolé, comme le suggère la traduction du terme أُمّيّ(« illettré ») (Coran, VII, 156) retenue par certains, ou bien a-t-il vécu dans un environnement de cultures différentes auxquelles il a eu accès (la traduction de أُمّيّ serait dans ce cas celle de « gentil » au sens paulinien de « païen »). Si Jacqueline Chabbi (1997) semble avoir opté pour la première hypothèse, et peut-être Blachère (1991 : 6-12), de nombreux auteurs admettent que le prophète, loin d’être un illettré, a été en contact avec d’autres langues et d’autres cultures que les apologistes ultérieurs, soucieux de préserver l’originalité de l’islam, n’auraient pas retenues.
C’est la lente fixation du texte du Coran, étalée sur deux siècles, qui a permis ce travail d’enfouissement comme s’il s’était agi de débarrasser le texte sacré de ses scories, de ces traces susceptibles de nuire à son originalité ou à son authenticité. Les études de ces dernières années ont mis en cause la version officielle de sa fixation par le troisième calife Othmân (644-656) qui fut assassiné et dont on dit que cette opération fut l’une des causes de son assassinat (puisqu’il aurait réuni les versions qui circulaient, en aurait fait une compilation et aurait fait détruire les autres versions). Par la suite, sous le règne de Abd-al-Malik (685-705), fils de Marwân, le gouverneur d’Irak aurait établi une version à partir de celle de Othmân et fait détruire les autres (cette destruction des autres codex est un thème récurrent). Al-Mahdi (775-785), troisième calife abbasside, fit parvenir à Médine un codex coranique qui fut substitué à celui de Hajjâj ibn Yusuf. Le travail et les débats sur le texte s’achevèrent dans la première moitié du Xe siècle au témoignage d’Alfred-Louis de Prémare (2004 : 12).
Le texte actuel, classé d’une façon arbitraire (des sourates les plus longues aux plus courtes, sans que cet ordre n’ait jamais été expliqué), même s’il contient sans doute beaucoup d’éléments surajoutés pour des raisons doctrinales ou politiques, fait cependant écho, et sans doute parfois rapporte textuellement, des paroles prononcées par le prophète Muhammad à partir de 610 et jusqu’à sa mort en 632. Dans une nouvelle traduction du Coran, Youssef Seddik (2002) a tenté, en s’affranchissant pour la première fois de cet ordre traditionnel, de retrouver le souffle premier de cette prédication.
Dans le long travail d’élaboration qui a duré près de deux siècles, les exégètes musulmans ont voulu produire un texte (le Coran) qui apparaisse comme la parole d’Allah révélée à son messager et donc présenter la nouvelle religion comme une entité nouvelle, indépendante et supérieure aux pratiques religieuses des sociétés où était né l’islam : la culture préislamique en vigueur chez les Arabes nomades, les religions juive et chrétienne répandues dans son environnement et la culture hellénique. Ajoutons que cette structure religieuse devait cautionner et légitimer un pouvoir politique. C’est pourquoi les commentateurs se sont évertués à en gommer les traces étrangères ou à les minimiser quand ce n’était pas possible. Mais Youssef Seddik (2004 :59) cite à ce propos cette remarque de Freud : « Il en va de la déformation d’un texte comme d’un meurtre. Le difficile n’est pas d’exécuter l’acte, mais d’en éliminer les traces ».
Sur la trace de ce refoulement établi sur des influences contextuelles externes, je suivrai trois pistes : la culture anté-islamique des nomades arabes, la culture judéo-chrétienne et la culture
hellénique.
La culture préislamique des nomades arabes
Cette culture d’une époque appelée الجاهليّة (ignorance, fureur, violence) est l’objet d’une détestation universelle des commentateurs musulmans et à leur suite de l’opinion musulmane. C’est l’époque du paganisme, du désordre, à laquelle le prophète est venu mettre fin dans une histoire qui est connue (1).
D’une thèse soutenue en 1989 par Manaf Sami sous le titre Économie et politique du nomadisme arabe, il ressort que la culture des nomades arabes représentait un idéal directement opposé à celui que proposait l’islam et que l’apologétique l’a combattu en le déformant et en le faisant oublier. Le point central est une pratique, le maysir آلْمَيْسِر, prohibée dans le Coran en association avec le vin et traduite par l’expression « jeu de hasard ». L’interdiction est formulée en ces termes dans le Coran (V, 90, trad. Masson : 156) :
"Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du Démon. Évitez-les… Satan veut susciter parmi vous l’hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard… "
Un autre passage reconnaît quelque utilité à cette pratique, mais la rejette globalement :
"Ils t’interrogent au sujet du vin et du jeu de hasard ; dis : « Ils comportent tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché qui s’y trouve est plus grand que leur utilité ». (Coran, II, 219, trad. Masson : 44.)"
La gravité de l’interdit conduit à s’interroger sur la nature de cette pratique. Si l’exégèse a obscurci la question, c’est qu’il y avait là un enjeu important. Elle l’a fait en réduisant le maysir au jeu de hasard, voire au trictrac, et en confondant deux pratiques différentes utilisant des fléchettes : un ensemble de trois fléchettes dites zalam زَلَم (pluriel : azlâm أَزْلآم ) utilisées dans les sanctuaires pour la divination, et un ensemble de dix fléchettes dites qidh قِدْح (pluriel : qidâhقِداح ), dont sept portaient le nom d’un titulaire et le nombre de parts de viande et utilisées pour le maysir. Les auteurs arabes contemporains connaissaient la réalité des faits, Ibn Qutayba a écrit une épître sur le sujet intitulée كتاب الميسرو القداح, d’où Manaf Sami extrait son analyse.
À sa suite, il faut expliquer le contexte réel de la période où le prophète a exercé sa mission. La société arabe de La Mecque et de ses environs était formée de trois éléments. Une société citadine qui s’adonnait au commerce, avait ses cultes et ses rythmes saisonniers : des phases d’expéditions commerciales durant des mois sacrés assurant la sécurité par des trêves, des périodes de pèlerinages الحجّ et العُمْرة, d’ailleurs repris par l’islam et des foires à but commercial. Une société sédentaire également, mais s’adonnant aux activités d’agriculture et d’élevage, partageait le même panthéon polythéiste que les citadins. Une troisième fraction était constituée des nomades vivant dans le désert avec leurs troupeaux de chameaux dans le cadre d’une culture tribale spécifique : c’est à ce
milieu seul que s’applique le maysir. À la différence des sédentaires, les nomades n’avaient pas de dieux : à la religion ils substituaient l’éthique que véhiculait leur poésie. Ils vivaient dans leur désert une vie rude, alternant dispersion et rassemblement au rythme des saisons et des ressources disponibles, dans un contexte où la violence était exaltée selon un sens de l’honneur exacerbé. L’organisation socio-économique annuelle comportait trois phases :
– une phase de « génération », au printemps, alors que les pâturages sont abondants et que les chamelles mettent bas : le mois sacré de rajab رَجَب prohibe les violences.
– une période de « distribution » durant l’été : c’est l’époque de la razziaالغَزْو qui consiste à prendre des chamelles à d’autres groupes. Ce n’est ni le vol, ni la guerre : la razzia se fait sans mort d’homme, mais l’honneur d’un groupe – et d’un homme – est de manifester sa force et son prestige en s’emparant des chameaux d’autrui.
– une période de « destruction » où intervient le maysir. C’est la période de l’hiver, les groupes se sont rassemblés, les ressources en pâturages sont réduites, la nourriture antérieure (lait et dattes) n’est plus disponible et est remplacée par la viande des chameaux qu’on égorge. Loin de vouloir accumuler les têtes de bétail, le nomade va mettre son honneur à le détruire par jactance, manifestant par là qu’il sera capable d’en acquérir à l’avenir par la razzia. Mais il y a un stade préliminaire qui est le partage de la nourriture disponible et considéré sous cet aspect comme une bonne action. On égorge un chameau, la viande est partagée en dix parts qui seront attribuées par tirage au sort : on place dans un sac de cuir dix flèches (dites قِداح). Chaque flèche comporte un nombre de parts et un propriétaire. Le tirage au sort est fait en agitant le sac de cuir. Le bénéficiaire d’un lot s’en va avec sa part, puis d’autres flèches sont tirées jusqu’à épuisement de la viande, et ce sont les non-bénéficiaires qui supportent le coût de l’opération. Sous cet aspect le maysir permettait une consommation de viande associée au jeu, mais aussi une distribution au profit de nécessiteux. L’avantage que gagne l’organisateur du maysir est le prestige qu’il retire d’un acte de générosité. La taille du maysir peut varier selon le nombre de chameaux mis en jeu et de participants dans un climat de compétition pour le prestige. Une exubérance (‘ifâdaالإفاضة ) s’installe avec la surenchère, s’amplifie avec la consommation de vin et on passe à un autre stade avec la mo‘âqara المُعاقَرَة, qui est l’égorgement gratuit de chameaux par défi lancé à un rival : l’affrontement se produit entre groupes plus importants personnifiés par leur chef (sayyed السَيَّد ). Le défi est lancé par l’égorgement de cent chameaux par exemple, défiant le rival de faire mieux, d’en égorger un nombre supérieur. Le défi peut entraîner dans une course folle qui peut conduire à la ruine, mais celui qui ne peut relever le défi a perdu son honneur et celui de son groupe. Cette pratique n’est pas sans évoquer le potlach bien connu des ethnologues. L’histoire rapporte que de tels défis (المُعاقَرات) se prolongèrent même après l’établissement de l’islam au temps du khalife ‘Ali. Des destructions importantes de cheptel s’opéraient dans une ambiance d’ivresse et de folie exubérante, et ce sont de tels excès que condamnent les versets coraniques en englobant l’ensemble (pratique raisonnée et excessive) sous le terme de maysir et en y associant l’interdiction du vin.
Replacés dans son contexte éthique, le maysir et surtout la mo‘âqara qui le prolonge correspondent à un modèle radicalement contradictoire avec l’islam, et avant tout avec le modèle sédentaire. Pour le sédentaire le nomade est un danger, pour le nomade le sédentaire est une « corruption du monde ». L’éthique du nomade est fondée sur un rejet du travail comme moyen de subsistance, le travail
rabaisse l’homme et en fait un esclave. Un nomade n’avait-il pas interpellé le prophète en lui demandant : « Qui sont ces esclaves autour de toi ? ». Le seul geste noble est de prendre sa subsistance à autrui par la razzia, en affirmant sa force et son mépris du danger. Ce bien acquis par la violence n’est pas destiné à l’accumulation : l’honneur consiste au contraire à augmenter son capital de prestige, en le partageant certes, mais aussi en le détruisant, montrant par là sa foi en sa capacité d’en conquérir par la razzia. La poésie nomade soutient ce modèle et le glorifie. Elle fait le panégyrique de ses meilleurs représentants. En elle aucune trace de religion : seul compte l’homme violent et fier au sein d’un groupe prestigieux.
Face à cet idéal le sédentaire, commerçant ou agriculteur, crée sa richesse par son travail et accumule les biens qui lui confèrent son prestige. Il rend un culte à ses dieux et s’en fait le
serviteur. Les nomades qui fréquentaient les grands rassemblements sédentaires ne s’y rendaient ni pour le commerce ni pour les sacrifices, leur seul souci était leur gloriole (المُفاخَرة ) et leur intérêt dans certaines négociations.
De ce modèle sédentaire l’islam fera son lit en le faisant évoluer. Le monde du nomade en était la contradiction. Mais il ne pouvait être heurté de front, car c’est sur lui que l’islam construira son expansion. Le modèle sera donc d’abord déformé : en confondant l’utilisation des flèches en des circonstances différentes (qidah et azlâm), en réduisant le maysir (à savoir toute la structure socio-économique nomade) à des jeux de hasard, tandis que les valeurs sous-jacentes (fierté, jactance, violence, mépris du faible) ne seront pas attaquées de front. Ceux qui le déformaient dans ces deux premiers siècles de l’islam agissaient en toute connaissance de cause. Des traités décrivaient le modèle nomade : nous avons cité Ibn Qutayba. La déformation commence avec des commentateurs du Coran qui, comme Tabari, réduisent le maysir au قِمار (jeu de hasard). Le grand dictionnaire Lisân al-‘Arab le décrit comme « un jeu avec des flèches – قِداح ».
Après la déformation vint le stade de l’enfouissement. Le maysir réduit au jeu de tric-trac et sa pratique englobée dans les survivances païennes envahit toute la tradition exégétique pour longtemps, y compris la respectable Encyclopédie de l’islam. Dans sa récente traduction du Coran assortie de commentaires, Cheikh Hamza Boubakeur (1994 : I, 226) écrit :
"Le jeu de hasard, maysir, jeu en vogue chez les anciens Arabes, auquel Ibn Qutayba [il est donc bien informé…] a consacré tout un ouvrage. Mais il ne s’agit point d’une interdiction, frappant uniquement cette sorte de jeu. Ici, selon l’opinion de tous les commentateurs, le particulier a une valeur générale : tous les jeux de hasard sont interdits aux musulmans et en général tout ce qui relève du hasard."
Il n’est pas question ici de tenter une réhabilitation du modèle nomade, mais de constater que son existence a été refoulée. Il était certes antinomique du modèle sédentaire et musulman par la suite. Mais il faut bien réaliser que, dans une première vague, l’expansion de l’islam s’est appuyée sur les tribus nomades dont les valeurs furent progressivement recouvertes du voile de l’islam sous la forme du jihâd الجِهاد, le « combat pour la foi ». Comme le dit Hamadi Redissi (2004 : 86),
"s’il est vrai qu’on est préformé par le monde de la langue, on est en droit de se demander si « la conscience insérée dans le devenir historique » comme dit Hans-Georg Gadamer, n’a pas porté dès le berceau la menace que proférait à chaque sortie Khaled ibn al-Walid, l’intrépide guerrier, lors de la guerre contre les apostats ayant renié l’islam juste après la mort du Prophète (632-634). À l’adresse des chrétiens d’Orient et d’autres communautés disparates et paisibles, il lançait : « Par Allah, j’arrive vers vous avec des gens plus avides de la mort que vous ne l’êtes de la vie », ou encore des gens « aimant la mort aussi violemment que vous aimez le vin. » Le porte-parole de la Qaïda, Suleiman Abu al-Gaith, s’en fait l’écho, lors de son passage à la Jazira, le 10 octobre 2001 : « Des milliers de jeunes de notre Umma veulent autant mourir que les Américains veulent vivre » ! "
On ne saurait mieux qualifier le modèle nomade. Quant au jihâd, la tradition musulmane s’interroge jusqu’à ce jour sur sa nature : une lutte guerrière pour la foi, ou une lutte interne à l’individu pour l’acquisition de la vertu ?
Les cultures juive et chrétienne contemporaines du Prophète
Les sources bibliques communes aux Juifs et aux Chrétiens sont abondamment citées dans le texte du Coran. La prédication de Mohammed s’inscrivait en partie dans le sillage de ces religions pour les achever, voire les redresser. L’importance des échanges est attestée dans la tradition par des noms qui, même s’ils sont mythiques, n’en témoignent pas moins de la réalité des contacts. Waraqa b. Nawfal, chrétien, peut-être prêtre, faisait partie de la famille de Khadidja, première épouse du prophète : il connaissait la Torah et l’Évangile et pouvait en traduire en arabe ce qui lui était de-mandé. Le moine syrien Bahîrâ avait reconnu sur Mohammed les traces de la prophétie. Il y avait aussi le rabbin juif de Yathrib, converti à l’islam, Salmân le Persan, venu du zoroastrisme et arrivé à l’islam en passant par le judaïsme et le christianisme. Après avoir cité ces noms, l’orientaliste de Prémare (2002 : 329) conclut :
"Derrière toutes ces figures recomposées se profile emblématiquement, dans le milieu diversifié d’une période postérieure, un ensemble de personnes porteuses de leurs schémas culturels originels et des textes de leurs traditions antérieures. Elles connaissaient ces textes et ces traditions, et elles les faisaient passer dans leur nouveau cadre d’appartenance en leur faisant subir les aménagements appropriés, notamment dans une perspective apologétique et polémique."
Avec l’époque abbasside apparut chez les commentateurs musulmans le souci de dégager l’originalité de l’islam en tant que religion nouvelle. Certes une large appropriation des sources judaïque et chrétienne s’était faite par la transcription en arabe de « Traditions israélites » (الإسراءيليّات), notamment par Wahb ibn Munabbih (mort vers 732). Ces traditions étaient reprises par les commentateurs du Coran, dont Tabari et des auteurs de récits des prophètes (قِصَص الأَنْبياء). Par la suite, une attitude critique face à cette littérature tendit dans le même sens à souligner la place centrale de l’islam.
C’est dans ce contexte que des personnages centraux de la Bible se trouvèrent interprétés comme des figures de Mohammed. C’est notamment le cas de Joseph, dont l’histoire est longuement rapportée dans le Coran dans une sorte d’identification au prophète. On pourra se reporter pour ceci à la belle analyse qu’en a faite Alfred-Louis de Prémare (1989) et, de façon plus globale, à l’étude de
Jacqueline Chabbi (2008) relative aux figures bibliques en Arabie.
L’écriture syriaque
Il y a quelques années un universitaire allemand, excellent connaisseur de l’arabe et du syriaque, écrivant sous le pseudonyme de Christoph Luxenberg (2000), a proposé une approche philologique qui, après tous les préréquisits d’usage, tendrait à interpréter certains passages linguistiquement controversés du texte coranique à la lumière de la langue syriaque dont l’écriture coexistait avec celle de l’arabe. Par les hypothèses qu’il a soulevées l’auteur a suscité une curiosité dont Rémi Brague (2003) a bien défini les contours.
Dans la recension qu’il a fait de l’ouvrage, Claude Gilliot (2003 : 387-388) examine la possibilité de cette hypothèse.
"Christoph Luxenberg prend pour point de départ la situation linguistique qui a dû régner dans l’Arabie de Mahomet durant les premières décennies du VIIe siècle. Les signes équivoques de l’alphabet arabe en usage à cette époque pouvaient, en effet, comme nous l’avons vu, donner lieu à différentes lectures. Mais, d’autre part, le syro-araméen était alors la langue de culture dominante dans toute l’Asie occidentale, et il considère qu’elle a dû exercer une influence sur les autres langues de la région qui n’étaient pas encore des langues d’écriture. Nous ajouterons que La Mecque avait des contacts avec la ville de Hîra, nom araméen, qui était située dans le sud de l’Irak actuel, et qui était un siège épiscopal dès 410. De plus, selon certaines sources musulmanes (2) , les habitants de Tâ‘if et les Qoreïchites ont appris « l’art d’écrire » des chrétiens de cette ville, et le premier Qoreïchite à l’apprendre aurait été Sufyân b. Umayya."
Les confusions possibles entre langue arabe et syriaque sont attribuées à l’imprécision de la notation des deux langues, les points diacritiques qui permettaient d’identifier les consonnes et les voyelles n’étant pas notés à l’époque du prophète et des premiers khalifes. Pour confirmer son propos, Claude Gilliot (2003 : 390) poursuit :
"À ce stade, le lecteur se demandera comment Mahomet et certains de ses Compagnons auraient pu avoir accès à une écriture syriaque. Les rapports que La Mecque entretenait avec Hîra et la ville d’Anbar auraient leur place ici, ainsi que les relations de La Mecque avec la Syrie araméenne. De plus, une tradition attribuée à Mahomet donne à penser ; Luxenberg en cite une des versions, mais de seconde main ; nous en donnons une autre d’après une source. En effet, selon l’un des scribes des révélations échues à Mahomet, Zayd Ibn Thâbit : « L’Envoyé de Dieu dit : “Il me vient des écrits (كُتُب), et je ne veux pas que tout un chacun les lise, peux-tu apprendre l’écriture de l’hébreu, ou bien il dit du syriaque ?”. Je dis : “Oui”, et je l’appris en dix-sept-jours ! ». Pourquoi ne pas penser que celui qui contribua aussi à l’édition du Coran sous ’Uthmân, et, dit-on, aussi dès le califat de Abu Bakr, savait déjà le syriaque."
Ces quelques notations bien incomplètes tendent à rappeler l’intensité des échanges qui eurent lieu entre musulmans, juifs et chrétiens dans les premiers siècles, ainsi que le refoulement dont ils firent l’objet par la suite, au point que les musulmans des siècles ultérieurs en perdirent peu à peu la trace, comme cela apparaît dans l’exégèse contemporaine. Oubliés ? Refoulés ? Sans travail sur l’histoire ? Tout au long de celle-ci et jusqu’à aujourd’hui, l’odyssée des frères ennemis est marquée de jalons : conquêtes, croisades, persécutions diverses et conflits politiques, une trop grande proximité ne fait qu’exacerber les différences sinon les haines.
Une présence hellénique oubliée
Dans une thèse soutenue en 1995, l’anthropologue Youssef Seddik, excellent connaisseur des langues arabe et grecque, s’est intéressé à la présence de celle-ci dans le texte coranique. Dans les publications qui ont suivi ce travail, l’auteur a pu élucider nombre de passages du texte sacré qui étaient jusque-là demeurés hermétiques aux commentateurs. Ses recherches ont révélé une présence forte de l’hellénisme dans l’environnement du prophète, une présence qui, par oubli ou dénégation, était peu apparue jusqu’à présent. Les notations qui suivent visent seulement à donner une idée de l’importance du sujet.
i. Des termes grecs dans le Coran
L’existence de termes grecs dans le Coran est attestée, même si elle ne fut pas toujours admise par les exégètes. Ali Merad en fournit une liste avec ce commentaire : « Les emprunts de vocabulaire n’ont pas manqué d’embarrasser les auteurs classiques, imprégnés qu’ils étaient de la certitude quant à la pure arabicité du discours coranique » (Merad 1998 : 29-30). Dans cette liste, on peut remarquer le terme logos, qui a donné لغة (langue, verbe) qui a fini par supplanter le terme arabe لسان.
L’inventaire total est loin d’en être fait. Youssef Seddik en a détecté de nouveaux, apportant de ce fait la solution à des termes incompris des commentateurs et traduits (ou commentés) de façon
fantaisiste :
– la sourate CVIII (سورة الكوثر, l’Abondance), considérée comme « la croix des traducteurs » comporte un terme آلْكَوْثَر, dont la langue arabe ne peut rendre compte. Seddik (2002 : 62) le rapproche du grec catharsis, de même qu’un autre terme du même verset, آلأَبْتَر (stérile) dérivé du grec apteros (aptère, sans aile, sans descendant mâle). Le verset se présente dès lors sous cette forme :
إِنَّآ أَعْطَيْنآك آلْكَوْثَرَ 1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآنْحَرْ (2 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ آلأَبْتَرُ (3
"Nous t’avons accordé la Katharsis
Adresse donc à ton Seigneur une prière puis offre un sacrifice
Ton diffamateur, c’est plutôt lui qui est l’aptère"
Il prend alors son sens d’une consolation apportée par Allah à son prophète en butte aux attaques de ses ennemis concernant le fait qu’il n’avait pas de descendant mâle.
– Dans la sourate VIII, 1 سورة الأَنْفال, le Butin : du grec nêfalios, libation (qui n’a rien à voir avec le butin) (Seddik 2002 : 70).
– Dans la sourate CV سورة الفيل, l’Élephant) (Seddik 2002 : 153) le terme أَبابيل : pour Berque, des « oiseaux par vagues » évoquant Babel ! du grec ballô, « lancer » : « oiseaux bombardiers ».
– Dans la sourate de l’Étoile سورة النجم (LIII, 19-20) : après le verset 20 figuraient les fameux « versets sataniques » (3) , où les trois déesses sont appelées « grues » غَرانيق : un terme jamais bien expliqué. Ce terme transcrit le grec gueranos : géranium, grue et renverrait à des danses sacrées (dites des grues) pratiquées à Délos, et sans doute aussi à La Mecque (Seddik 2004 : 236-237).
ii. Des personnages, des pratiques, des mythes
Le personnage d’Alexandre (Sourate de la Caverne سورة الكهف , XVIII, 83ss) (Seddik 2002 : 185-187). Le fait qu’Alexandre le Grand (qui eut Aristote pour précepteur) soit chargé de mission par Allah dans le Coran (v. 86) a suscité l’étonnement de certains commentateurs qui refusaient d’identifier le personnage nommé ذو القرنَيْن avec Alexandre le Grand. Le nom signifie « Homme aux deux cornes ». Youssef Seddik y voit une référence directe au Roman d’Alexandre (attribué à Callisthène), qui a dû servir de source à l’ensemble du passage coranique.
Le Poème de Parménide. La sourate CXII (سورة التَوْحيد) serait identique au début du Fragment VIII du Poème de Parménide (Seddik 2002 : 87).
Référence à des cultes (danse des grues). Outre ce qui a été dit à propos de غَرانيق, la sourate VIII, 35 (سورة الأَنْفال, le Butin) dit à propos de non-croyants : « Leur prière auprès de la Demeure n’était rien que mugissement et percussion » (Seddik 2002 : 138). À partir des mots du Coran, Seddik (2004 : 230-240) a explicité la présence forte dans l’environnement proche du prophète à La Mecque de cultes païens bien identifiés à Délos et dont l’un des éléments, à travers « mugissements et percussions » était constitué par la « danse des grues » mentionnée dans les « versets sataniques ».
iii. L’oubli de la langue grecque
Les indications qui précèdent attestent de la présence de la langue grecque dans le Coran et dans son environnement socio-culturel et religieux. Elles révèlent ainsi la présence d’une culture
méditerranéenne au berceau de l’islam. Il est tout aussi évident que les commentateurs du Coran n’y ont pas eu recours. Il s’établit certes progressivement cette tendance à bannir toute influence étrangère de l’émergence de la révélation comme le signale Ali Mérad. La langue grecque fut cependant pendant quelques décennies la langue d’administration des provinces conquises et l’utilisation de la langue arabe ne fut introduite dans l’administration (ديوان) que sous le règne de Abd-al-Malik (685-705) ou de son fils Hisham (724-743) comme l’indique Dimitri Gutas (2005 : 53). Cet auteur distingue deux périodes dans le rapport des musulmans à la culture grecque. À l’époque omeyyade, parlant de la bureaucratie byzantine de Damas employée par les califes, il écrit :
"Cette haute culture byzantine montrait une indifférence hostile à la science grecque païenne… L’hellénisme était l’ennemi vaincu qu’on se devait de traiter avec une indifférence méprisante, parce qu’il n’était plus pertinent… Cette attitude de dénigrement envers l’hellénisme aurait été partagée, parmi les chrétiens de langue grecque soumis à l’autorité omeyyade, même par des groupes… qui étaient monophysites avant l’islam." (Gutas 2005 : 47.)
Avec l’avènement de la dynastie abbasside et le transfert de la capitale de Damas à Bagdad, l’animosité à l’égard de la science grecque disparut :
"Ainsi, le transfert du califat de Damas au centre de l’Irak – c’est-à-dire d’une région de langue grecque à une région où l’on ne parlait pas le grec – eut paradoxalement pour conséquence de permettre la préservation de l’héritage grec classique que les Byzantins avaient presque extirpé." (Gutas 2005 : 49.)
Que cet héritage ait été transmis à l’Europe par les traductions arabes ne concerne pas directement notre propos, mais plutôt la question des rapports entre les cultures arabe et occidentale. Le fait que dans cette transmission les Arabes aient été plus que de simples traducteurs est attesté par la liste prestigieuse de leurs philosophes et est reconnu par de nombreux auteurs dont Dimitri Gutas.
Cette participation a été récemment mise en cause par un ouvrage de Gouguenheim (2008), lui-même contredit par un livre collectif (Büttgen et al. 2009) : il s’agit d’une polémique passionnelle à laquelle un article de Rémi Brague (2008-2009) me semble avoir apporté une conclusion rationnelle.
Pour revenir à notre réflexion, on peut se demander pourquoi des générations qui pratiquaient bien la langue grecque et en avaient assimilé le fond culturel n’ont pas « entendu » sa présence dans le Coran, à travers les mots et les allusions dont nous avons relevé une partie. La cause en est que les milieux qui étaient imprégnés de l’hellénisme et ceux qui commentaient le Coran étaient différents, voire opposés. Le premier aspect en était le paganisme et l’impiété que les religieux percevaient chez les Grecs et leurs adeptes. Le second est l’opposition radicale que ces religieux ont opposée à la philosophie (فَلْسَفة), à la pensée rationnelle (qui ne fit qu’une brève apparition avec le courant mu‘tazilite et la querelle sur le Coran créé ou incréé) et finalement à la liberté de commenter le message prophétique. Cette attitude est symbolisée dans l’œuvre de al-Ghazâlî, célèbre théologien et bon connaisseur de la falsafa, dont il dénonça les thèses dans son ouvrage L’incohérence des philosophes (تَهافُت آلفلاسفة) paru vers 1091.
C’est donc tout naturellement, par l’indifférence byzantine puis par le rejet de la falsafa, que la langue grecque fut écartée du berceau de l’islam au point que les commentateurs du Coran ne songèrent même plus à y avoir recours. L’heureuse initiative de Youssef Seddik a réouvert le champ, mais semble rencontrer de fortes résistances auprès des apologètes traditionnels.
Conclusion
Alors que l’exégèse traditionnelle a généralement tendu à réduire le Coran à la seule langue arabe comme garantie par elle-même de son authenticité, les mots du Coran manifestent une multiplicité
linguistique et culturelle qui montre la richesse de ses racines. Ces langues qu’on ne veut pas reconnaître, ces pratiques qu’on fait mine d’oublier s’avèrent au contraire d’un grand secours quand il s’agit de comprendre le sens de certains versets. Loin de nuire à l’originalité de l’édifice coraniq
ue, elles font apparaître la profondeur de son insertion. À leur sujet on peut dire ce qu’écrivait l’orientaliste Jacques Berque (1970 : 35-36) :
"Toute culture n’est-elle pas, comme la mosquée de Kairouan, faite de pièces et de morceaux empruntés loin alentour, selon les strates chronologiques ou les distances géographiques ou sociales les plus diverses ?… Ainsi la mosquée de Kairouan érige en matériaux hétéroclites son message à elle. Mais ces matériaux, elle ne se borne pas à les organiser, elle ne les réduit pas à une figure. Que serait-elle sans l’histoire furieuse de l’établissement arabe et la propagation d’une foi dans le Maghreb ?"
Comment évaluer la portée de ce refoulement dans ce torrent culturel emporté par le texte coranique ? La langue arabe nous apporte des éléments de réponse. L’oubli d’une chose, ce n’est pas son effacement, c’est le report à plus tard de son action. Il existe en arabe une racine نَسَأَ qui a le sens général de « retarder, différer ». Appliquée à la femme, elle signifie le retard des
règles, qui conduit la femme à se croire enceinte (Kazimirski II : 1244). Proche de celle-ci, une autre racine نَسِيَ a le sens général d’oubli ; un sens dérivé mentionne, parmi les choses qu’on oublie à dessein « le linge sali du sang des règles et jeté ». De cette racine sont dérivés les termes نِسْوَة et نِساء qui désignent collectivement les femmes (Kazimirski II : 1254). L’oubli est ainsi associé au retard, au report, à la femme par le relais du retard des règles. L’oubli, ce sont ces règles qui ne viennent pas, mais qui par leur absence font espérer une nouvelle vie. L’oubli, mise en attente d’une chose, est associé à la femme, au féminin, tandis que la mémoire, mention répétée, rappel, est associée à l’homme, au masculin : la racine ذَكَرَ évoque en effet la mémoire, la citation, le
masculin, le sexe mâle. Ces évocations de la langue arabe nous rappellent qu’un torrent qui s’écoule ne laisse apparaître qu’une partie de ce qu’il emporte, et qu’un texte est porteur d’autre chose que ce qui apparaît.
REFERENCES
Al-Balâdhuri (1987)فتوح البلدان Beyrouth :مؤسّسة المعارف
Berque, J. (1970) L’Orient second. Paris : Gallimard.
Blachère, R. (1991) Introduction au Coran. Paris : Maisonneuve & Larose.
Brague, R. (2003) « Le Coran : sortir du cercle ? », Critique, 671 : 232-251.
Brague, R. (2008-2009) « Arabe, grec, européen. À propos d’une polémique récente », Commentaire, 31, 124 : 1181-1190.
Büttgen, P., de Libera, A., Rashed, M., Rosier-Catach, I., dir. (2009) Les Grecs, les Arabes et nous : enquête sur l’islamophobie savante. Paris : Fayard.
Chabbi, J. (1997) Le Seigneur des tribus. L’islam de Mahomet. Paris : Noêsis.
Chabbi, J. (2008) Le Coran décrypté : figures bibliques en Arabie. Paris : Fayard.
Le Coran (1994) éd. Cheikh Si-Hamza Boubakeur. Alger : ENAG éd.
Le Coran (1967) introd., trad. et notes par D. Masson ; préf. par J. Grosjean. Paris : Gallimard.
Gilliot, C. (2003) « Langue et Coran : une lecture syro-araméenne du Coran », Arabica, L, 3 : 386-391.
Gouguenheim, S. (2008) Aristote au Mont Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne. Paris : Seuil.
Grandguillaume, G. (1991) « Ces mots qui permettent l’oubli », Peuples méditerranéens. Mythes et récits d’origine, 56-57 : 93-110,www.ggrandguillaume.fr
Gutas, D. (2005) Pensée grecque, culture arabe. Le mouvement de traduction gréco-arabe à Bagdad et la société abbasside primitive (IIe-IVe/VIIIe-Xe siècles). Paris : Aubier.
Kazimirski Biberstein, A. de (1960) Dictionnaire arabe-français. Paris : Maisonneuve.
Luxenberg, C. (2000) Die syro-aramäische Lesart des Ko-ran. Ein Beitrag sur Entschlüsselung der Koransprache. Berlin : Das Arabische Buch.
Merad, A. (1998) L’exégèse coranique. Paris : PUF.
Prémare, A.-L. de (1989) Joseph et Muhammad, le chapitre 12 du Coran. Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence.
Prémare, A.-L. de (2002) Les fondations de l’islam. Entre écriture et histoire. Paris : Seuil.
Prémare, A.-L. de (2004) Aux origines du Coran. Paris : Tétraèdre.
Ibn Qutayba (1965-1966)كتاب الميْسر و القداح Le Caire.
Redissi, H. (2004) L’exception islamique. Paris : Seuil.
Sami, M. (1989) Économie et politique du nomadisme arabe. Paris : thèse de doctorat de l’EHESS.
Seddik, Y. (1995) Le travail du coranique. Paris : thèse de doctorat de l’EHESS.
Seddik, Y. (2002) Le Coran. Autre lecture, autre traduction. Alger/La Tour d’Aigues : Barzakh/Éditions de l’Aube.
Seddik, Y. (2004) Nous n’avons jamais lu le Coran. Al-ger/La Tour d’Aigues : Barzakh/Éditions de l’Aube.
|
| (1) Ce sont des thèmes récurrents du discours wahhabite depuis son origine en Arabie Saoudite que cette dénonciation de la Jâhiliyya. Il est vrai que le royaume se fondait, comme l'islam à ses origines, dans un contexte de tribus nomades jalouses de leur autonomie,identifiée à leur honneur.
(2) Il s'agit d'al-Balâdhuri (1987: 659-661), traduit par de Prémare (2002: 442-443).
(3)Il s'agit des versets révélés puis annulés reconnaissant les trois déesses de la Mecque (Sourate l'Etoile, LIII,19-20). Pour cette question, voir Grandguillaume (1991).
|
|