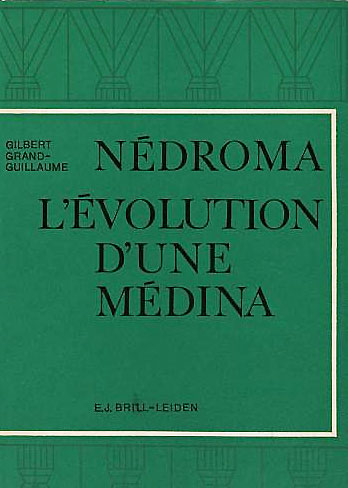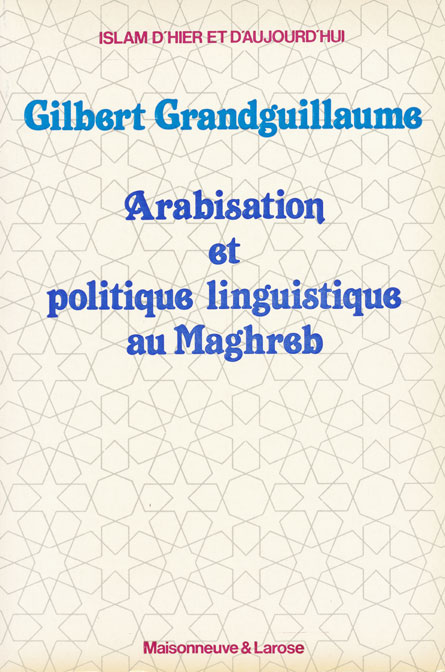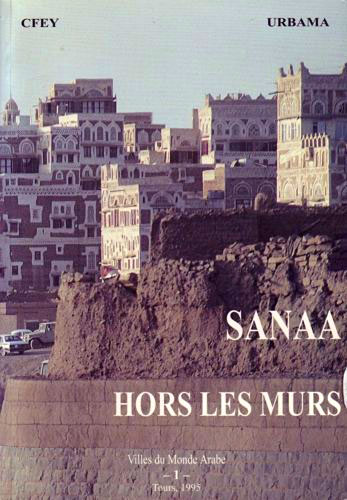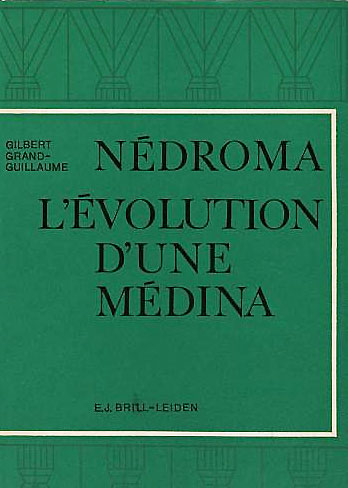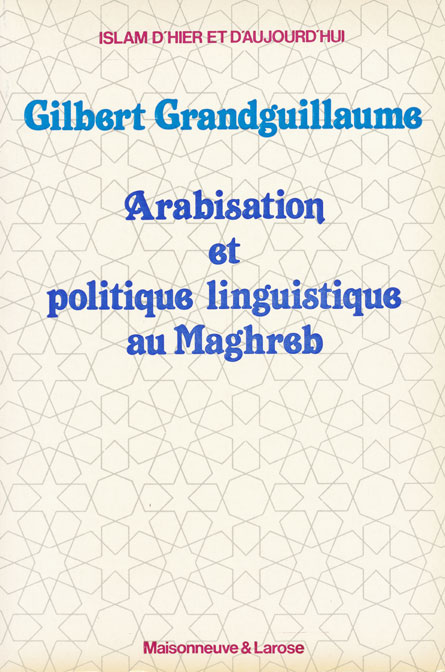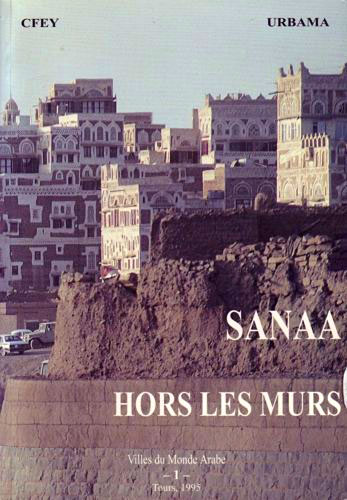|
Articles
| LA LANGUE ENTRE LE POUVOIR ET LA VIE |
Gdg[1].1995c.doc |
Référence : Correspondances, IRMC, Tunis, N°34-35, p.3-8
|
Les problèmes de langues occupent depuis longtemps une place centrale en Algérie. Face à une situation à la fois complexe et délicate, les intellectuels qui s’en sont préoccupés ont souvent fait le choix de traiter la question soit d’un point de vue technique (linguistique), soit d’un point de vue politique ou idéologique. Dans le livre qu’elle publie cette année, Khaoula TALEB IBRAHIMI fait le choix courageux d’affronter la réalité de la situation. Le titre le suggère déjà : les Algériens et leur(s) langue(s). Certains diront sans doute qu’il aurait fallu d’emblée supprimer le contenu des parenthèses. Le singulier fait référence à la situation de l’Algérie : une nation nouvelle, qui se sent appelée à avoir une langue, une comme la nation. Ainsi sont satisfaits les idéologues de l’arabisation, pour qui la seule langue de l’Algérie est sa langue nationale, sa langue officielle, l’arabe classique. Mais ce singulier peut aussi renvoyer à la réalité la plus prosaïque: chaque Algérien, en quelque point du territoire qu’il naisse, entend, puis se met à parler une langue : langue maternelle, qualifiée de dialecte, elle est un parler arabe ou berbère. Le choix de passer au pluriel, laissé en option par le titre, nous renvoie à la complexité de la situation linguistique algérienne : le niveau des langues maternelles, arabes ou berbères, celui des langues étrangères, français (et secondairement, anglais, espagnol, italien), enfin et surtout, celui de la langue arabe de référence, langue classique du Coran, et langue arabe moderne, “langue tierce” issue du compromis entre la langue antique et son ouverture au monde moderne.
Aux origines du livre
L’ouvrage présenté au public est extrait d’une thèse de doctorat d’Etat que Khaoula TALEB IBRAHIMI a préparée sous la direction de Louise DABENE à l’Université de Grenoble et qu’elle a soutenue en octobre 1991. L’auteur est professeur à l’Institut de langue et littérature arabes de l’Université d’Alger. Elle s’est investie dans cette question non seulement dans la pratique de son enseignement, mais dans de multiples actions d’arabisation, dans et hors de l’université. L’ouvrage est donc situé au carrefour d’une réflexion et d’une pratique.
Dans un sujet qui est souvent devenu le domaine d’élection de la langue de bois, le livre de Khaoula TALEB IBRAHIMI apporte de l’air frais. Je le préciserai en détail plus loin, mais d’emblée, il faut lui reconnaître le mérite d’oser adopter un recul critique sur ce qui fut longtemps le champ de l’intouchable. Elle a su assumer ce que sans doute beaucoup ont perçu avant elle, mais ont généralement mis à l’écart : le fait de l’importance centrale de cette question de la langue dans l’édifice national Algérie, qu’il s’agisse de la pédagogie, de la culture, de l’identité, de la légitimité : c’est dire à quel point l’actualité la plus récente n’a pu que confirmer le caractère radical des questions que soulève le livre.
Comme je l’ai souligné dans la préface (1) que j’ai rédigée pour ce livre, ce travail comporte deux parties : l’une a pour titre “La situation sociolinguistique de l’Algérie”, la seconde, “L’arabisation : charpente de la politique linguistique de l’Algérie”.
Dans la réflexion que je conduis à propos de cet ouvrage, je n’essaierai pas d’être exhaustif. De la première partie, je reprendrai ce qui est dit à propos de la notion de continuum, et de la langue arabe dans le système éducatif ; de la seconde, je soulignerai ce qui est touché du politique dans la politique d’arabisation, et de la marginalisation des langues populaires. Ces questions de la pédagogie et des langues populaires nécessiteront une réflexion plus synthétique en conclusion de ces lignes. Enfin, il faut signaler la qualité de la bibliographie qui clôt le livre : il me sera impossible de la reprendre dans son extension, mais elle représente un instrument de travail précieux pour quiconque s’intéressera à cette question.
La notion de continuum.
A la notion de systèmes structuraux, souvent utilisés pour décrire les situations linguistiques (il s’agirait ici de l’arabe, du berbère et du français, ou de l’arabe écrit et de l’arabe parlé, ou bien de l’arabe, du français, et des langues maternelles), l’auteur préfère la notion de continuum, qui évoque l’idée d’un “espace continu non interrompu” (p.80). Si la description structurale présente l’avantage de bien mettre en valeur l’identité propre d’une langue et son sens, elle a pour effet, comme toute description structurale, de mieux rendre compte de l’intelligibilité d’une réalité que de son existence concrète. Nul n’est obligé de considérer qu’une option exclut l’autre. Khaoula TALEB IBRAHIMI opte énergiquement pour le continuum, et elle a raison dans la mesure où elle entend rendre compte d’une situation linguistique multiple, mais non compartimentée. Sur les pas d’autres linguistes, dont le premier sur le Maghreb fut certainement le Tunisien Mohamed MAAMOURI (2) : il présenta les aspects linguistiques des interférences de langues dans le contexte tunisien, son compatriote Salah GARMADI (3) en développa les aspects culturels. Les références affichées dans le travail sont , pour l’Algérie, A.HADJ SALAH (4), et pour l’école américaine, J.FISHMAN, C.FERGUSON et J.J. GUMPERZ, pour ne parler que des plus célèbres.
De cette notion de continuum, l’auteur fait un bon usage : elle lui permet en effet d’apprécier la dynamique des langues en Algérie, leur interpénétration, et les évolutions qu’elles suivent au contact les unes des autres. Je reviendrai sur les conséquences de ce fait sur la pédagogie de l’enseignement de l’arabe. Mais il faut considérer ici que cette perspective a en premier lieu le mérite de reconnaître l’existence de cette diversité, de marquer la présence du multiple. Il est en effet bien connu que l’idéologie étatique s’est, dans la politique d’arabisation, fixée dans une double dénégation, associée à un double combat : nier la place de la langue française, comme langue coloniale, et nier la place des langues populaires, comme antinomiques d’une vision jacobine de l’unité nationale. Khaoula TALEB IBRAHIMI a le courage de rétablir la réalité dans ces deux domaines, mais le poids de la langue de bois est tellement lourd qu’il n’est pas certain qu’elle y ait totalement échappé. J’en prendrai deux exemples. L’auteur signale (p.194, et note) qu’en 1964 une licence de lettres arabes est créée à l’Université d’Alger, pour ajouter (note) que “avant l’indépendance, cette licence se délivrait en langue française dans la tradition des Orientalistes et de l’Ecole des langues orientales de Paris”. Une observation apparemment anodine qui appelle deux remarques : la première est que cette licence n’était pas “en langue française”, mais en un contexte bilingue, comportant notamment des éléments de traduction: il n’est pas certain que la licence monolingue qui prit sa place ait marqué un progrès. La seconde remarque concerne l’orientalisme : quels que soient les défauts, largement dénoncés, de ce dernier, il a au moins apporté une connaissance des oeuvres et une méthode d’analyse critique, dont on souhaiterait qu’elles fûssent relayées par l’intelligentsia arabophone. Mon second exemple concerne l’intérêt porté aux dialectes, dont on sait qu’il fut dénoncé comme “colonialiste”. L’auteur écrit (p.68, note) : “La position de certains intellectuels francophones en Algérie et leur revendication en faveur de cultures et dialectes populaires peut paraître suspecte pour les tenants de l’arabisation. Il est en fait à noter que la quasi-totalité des études sur les dialectes et la culture populaires (ou tradition orale) est le fait de cette catégorie d’intellectuels.” Bien que ce ne soit probablement pas l’opinion de l’auteur, le texte semble confirmer le caractère colonial de l’intérêt pour les dialectes. Mais cette remarque ne devrait-elle pas aboutir à considérer comme scandaleux que l’intérêt pour les langues du pays soit absent des préoccupations des intellectuels nationaux, et qu’il ne soit pris en charge que par “cette catégorie d’intellectuels” ?
La langue arabe dans le système éducatif
Cette remarque nous conduit à un autre problème, que l’auteur a le grand mérite de poser dans son livre. Ce problème avait été soulevé il y a quelques années par une remarquable publication de Malika BOUDALIA-GREFFOU (5), qui avait mis l’accent sur la carence pédagogique de l’enseignement de l’arabe. Khaoula TALEB IBRAHIMI a des pages très instructives sur les pratiques didactiques : des pratiques qui sont “marquées du sceau de la tradition scolastique arabe” (p.211), dans le choix des textes, dans l’accentuation de l’écart avec la langue maternelle : le résultat en est “un appauvrissement linguistique et culturel de l’univers des enfants” et “la réduction de leurs acquis pré-scolaires” (p.214) : une question particulièrement urgente qui, comme l’affirme à juste titre l’auteur, nécessiterait la mise en place d’équipes pluridisciplinaires, réunissant des linguistes, des sociologues, des psychologues et des pédagogues (p.214). Cette question devrait être éclairée par les travaux de Cherifa GHETTAS(6), révélant une perte de créativité chez les enfants qui passent de l’utilisation de leur langue maternelle à celle de l’arabe classique.
En ce domaine comme ailleurs, le problème vient d’un déni de réalité sous l’effet du politique : on a voulu considérer que l’arabe de l’école était une langue maternelle, alors que ce n’est le cas dans aucun pays arabe. Le travail de K.TALEB IBRAHIMI et son abord des problèmes amène à prendre en compte ces réalités : la pédagogie de la langue arabe doit prendre en charge ce passage progressif d’une langue à l’autre.
Son analyse de la situation sociolinguistique la conduit au même constat dans un autre domaine : la présence de la langue étrangère dans le paysage social. La comparaison de deux tableaux, dans les pages 48 et 49, vaut une longue démonstration. Dans la presse quotidienne, aux 367.000 exemplaires de El Moudjahid (de langue française), font face les 75.000 exemplaires de Ech Chaab (de langue arabe). A cette expression naturelle s’oppose la politique d’édition, pour la même année (1986): 87 titres édités en langue française, pour 190 édités en langue arabe.
L’arabisation : charpente de la politique linguistique de l’Algérie.
L’auteur, dans un précieux chapitre, analyse la chronologie de l’arabisation, les textes réglementaires, les dates charnières, les principaux événements qui l’ont marquée. Du bilan qu’elle en fait, je retiens deux traits : cette politique a toujours été volontariste, dirigée du sommet vers la base, sans analyse réelle de ses effets. Le second trait est qu’elle fut essentiellement conflictuelle.Il faut citer l’auteur : “Qu’il nous soit permis, aujourd’hui, de douter que la politique menée, au vu de son bilan, ait été véritablement pensée comme réflexion scientifique rationnelle sur la réalité linguistique du pays...Bien que marquée par une constante têtue - la nécessité du recouvrement par la langue de sa place dans la société algérienne-, cette politique a toujours été le lieu d’un débat passionné, trop passionné pour accéder à une vision sereine de la réalité. De plus, il est presque simpliste de constater que cette politique s’est presque exclusivement confondue avec une de ses composantes, l’arabisation.” (p.241).
Dans un tableau (p.314), l’auteur met en place les acteurs de cette longue lutte pour le pouvoir qui se poursuit jusqu’aujourd’hui, et dans laquelle l’arabisation est un enjeu de premier plan. Cette lutte oppose les élites arabophones et francophones, les arabisants traditionalistes et les arabisants éclairés (p.290), les sociétés arabophones et berbérophones, les intellectuels et les cadres formés dans les écoles à ceux qui sont montés par le rang, ceux qui reçurent leur formation de l’Occident à ceux qui l’obtinrent de l’Orient. Dans ces longs déchirements dont on ne lira jamais assez les péripéties, dans cet ouvrage et dans d’autres, apparaissent surtout les places en creux des éléments oubliés : la pédagogie, l’éducation, l’efficacité, le développement,et finalement: l’Algérie elle-même comme nation.
La marginalisation des langues populaires
Dans l’un des titres de la seconde partie, l’auteur affirme : “L’arabisation a contribué à la marginalisation de plus en plus forte des dialectes populaires” (p.306). La chronologie avait signalé la principale de ses cibles : les parlers berbères, et la réaction de celle-ci, à l’occasion de ce qui est appelé “le printemps berbère” (p.280) et les émeutes qui l’ont marqué en 1980. La situation des parlers arabes, effectivement divers comme le signale l’auteur (p.30, note), n’est guère meilleure, mais elle n’a pas de base ethnique suffisamment homogène pour susciter des réactions analogues à celles des Kabyles dans le domaine berbère.
C’est l’un des grands mérites de cet ouvrage que de montrer dans le détail les méfaits techniques (je reviendrai sur les nuisances politiques) de cette marginalisation des langues parlées. Si la langue arabe moderne est internationale, sa référence nationale ne peut lui venir que de ses parlers. Cette question est résolue sans grandes difficultés par des pays tels que l’Egypte, la Syrie ou le Yemen : la langue parlée n’y a pas de statut honteux, bien au contraire. A un degré moindre, ces problèmes sont moins aigus en Tunisie et au Maroc. Le drame de l’Algérie est que, la langue arabe classique ayant été gommée par de longues années de colonisation, elle n’a pu fournir aux dialectes arabes parlers le socle qui auraient maintenu avec elle une continuité, non seulement dans la langue, mais aussi dans les esprits. Le problème n’a pas été examiné comme tel en Algérie. C’est évidemment dans le domaine de la pédagogie et de l’enseignement que le tort est le plus grand. Mais il ne l’est pas moins dans le monde de la communication : une information guindée, accentuant l’effet de pouvoir, et finalement manquant son objectif : “Combien de fois le téléspectateur s’est-il retrouvé face au petit écran, quémandant une phrase,une expression ou une explication compréhensible, claire et simple car dite dans une langue que son ouïe rencontre sur tous les chemins de son quotidien. Combien sont-ils à regarder, impuissants, défiler les images d’une production nationale sans saisir le fond d’un message censé leur être adressé ? “ (p.335).
Il est à peine nécessaire de relever combien, sur ce point, l’écart s’est creusé entre le pouvoir et ceux qu’il administre. A côté d’une culture officielle figée exprimée dans cet arabe classique, s’est développée une culture populaire vivace qui fleurit dans le théâtre, dans la chanson : une culture où s’exprime la marginalité de la majorité de la population.
Les enjeux d’un livre
De cette trop rapide revue d’un livre remarquable, l’importance capitale de la langue dans l’Algérie ressortira du moins. Du courrier des lecteurs d’Algérie Actualité, Khaoula TALEB IBRAHIMI reproduit cet extrait : “Resterait le problème crucial de la langue unique qui nous fait cruellement défaut. Quand donc pourrons-nous exprimer dans une seule et même langue, à la maison comme à l’école, au café comme au bureau...une langue à la fois écrite et parlée, qui nous permettrait d’avancer tous dans la connaissance et le progrès...” (7).
Avancer dans le progrès, sans doute, mais d’abord constituer une communauté de communication, une nation. Il existe certes des nations multilingues, elles vivent, même si elles ne sont pas sans problèmes, en s’appuyant sur une histoire, un passé, et une volonté de vivre ensemble. Le problème pour l’Algérie est que le modèle, plus ou moins conscient, est jacobin. La nation, qui s’est constituée sans figure charismatique, aurait besoin d’un lieu culturel de sa légitimité, qu’elle aurait voulu trouver dans la langue. L’arabe international n’y correspondait pas, ni la multiplicité des parlers. Le souhait qu’exprimait ce lecteur, c’est celui d’une Algérie qui jouirait déjà de cette unité qu’elle tente chaque jour d’inscrire dans les faits.
Deux facteurs auraient pu y contribuer puissamment. Le premier est l’école, lieu par excellence où s’inculque l’amour de la patrie, à travers son histoire, sa culture et ses langues. On a vu ce que la politique linguistique en a fait. L’autre facteur aurait pu être la reconnaissance que le pouvoir aurait pu officiellement témoigner aux langues parlées, véritables gardiennes de l’identité algérienne durant des siècles, des langues par lesquelles aurait pu passer un lien solide de compréhension et d’adhésion entre la société et le pouvoir. Cette chance n’a pas été saisie. Mais sur ces deux points, ce qui n’a pas été fait reste à faire. Le livre de Khaoula TALEB IBRAHIMI, par ses analyses et ses propositions, en montre la voie. Dès maintenant, des voix, telles que celle de Mohamed BENRABAH (8), s’élèvent en faveur des langues populaires. D’autres suivront et renforceront peu à peu la conscience de l’identité algérienne.
Ce qui ne veut pas dire que les problèmes seront simples à résoudre. Dans cette nouaison étroite de la langue, de l’identité, de la légitimité, quelle autonomie réelle peut être reconnue au linguistique, au pédagogique ? Quel pouvoir acceptera de renoncer à utiliser ces atouts puissants pour servir ses propres desseins ? Mais par delà ce problème, il y a encore plus important : les problèmes qui sont posés dans la langue, ce sont ceux-là mêmes qui constituent le type de société. Or l’Algérie, comme société, cherche sa voie : sera-t-elle moderniste, traditionaliste ? Quel compromis pourra-t-elle trouver entre un jacobinisme de naissance, et un multiculturalisme de souches ? Enracinée dans une langue à résonance sacrale, quelle place pourra-t-elle laisser au religieux dans sa construction culturelle et sociale ? Si tous ces problèmes étaient résolus, il n’y aurait plus de problème linguistique en Algérie. Mais la vie est faite précisément de tous ces problèmes, leur émergence est le signe que la vie est en travail. Dans la langue comme dans la société, la réalité n’est faite que du dosage de la stabilité et du mouvement, et la crise n’est grave que lorsque l’un de ces deux termes a été écarté ou oublié.
|
| (1) Je saisis cette occasion pour rétablir quelques erreurs qui se sont glissées dans cette préface :
p.7, (première de la préface), ligne 23 : lire : (Elle est le lieu de la fidélité, comme elle peut devenir celui du) dévoiement.
p.8, ligne 18 : lire : (concernent la situation sociolinguistique ) de l’Algérie et la politique linguistique suivie en Algérie, et axée sur l’arabisation.
p.10, ligne 16 : lire : (appréciés différemment) selon les points de vue. Pour une partie de l’opinion, conservatrice, ce sont des maux (auxquels il faudrait remédier)
p.13, ligne 18 : lire : (en leur apportant une marque propre), comme si, d’une certaine façon, ils étaient restés étrangers sur leur propre (sol),
p.13, ligne 31, lire : (faire croire aux Algériens qu’ils) n’auraient pas le droit d’utiliser cette langue, s’ils en ont besoin : auraient-ils du, (dans la même perspective)
(2) MAAMOURI, Mohamed , “The linguistic Situation in Independent Tunisia”, American Journal of Arabic Studies, 1, 1973, p.50-65.
(3) GARMADI, Salah, “Les problèmes du plurilinguisme en Tunisie”, in Renaissance du monde arabe, SNED, Alger, Duculot, 1972, p.309-322.
(4)HADJ SALAH, A., Linguistique arabe et linguistique générale. Essai de méthodologie du ‘ilm al arabiyya. Thèse de doctorat, Sorbonne, slnd.
(5) Malika BOUDALIA-GREFFOU, L’école algérienne d’Ibn Badis à Pavlov. Alger, Laphomic, 1989
(6) GHETTAS Cherifa, thèse de doctorat d’Etat en préparation sur le premier cycle de l’école fondamentale (Université de Grenoble)
(7) Algérie Actualité N° 1036, août 1985, cité par K.Taleb Ibrahimi, p.389, note 129.
(8) BENRABAH, Mohamed , “La langue perdue”, in ESPRIT, Avec l’Algérie, N°1, janvier 1995, p.35-47.
|
|