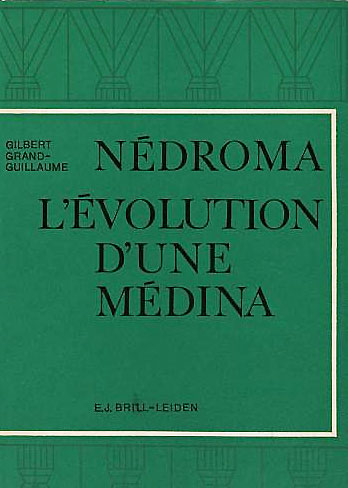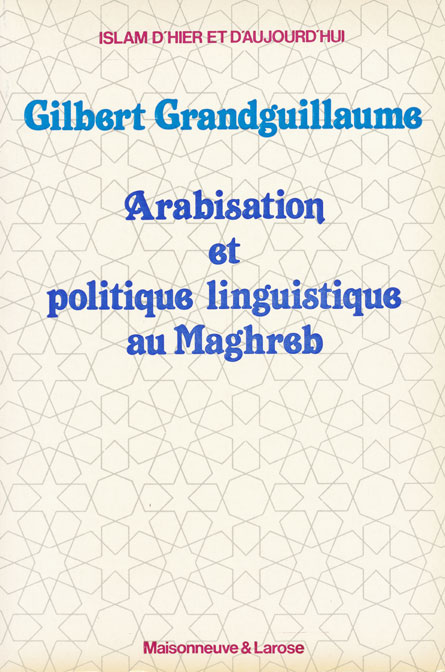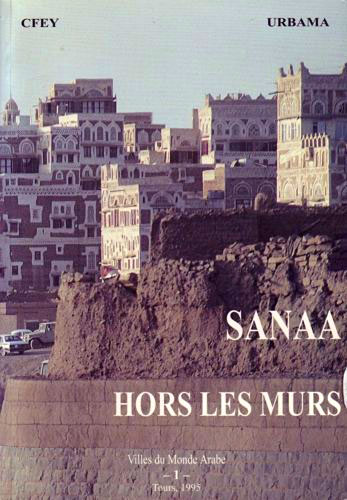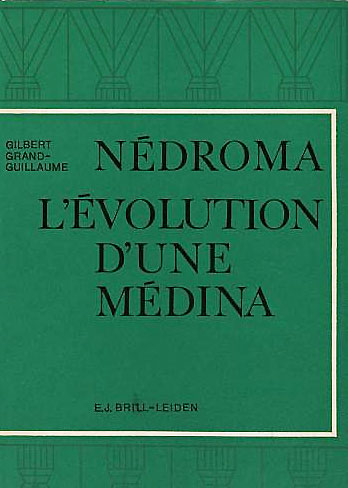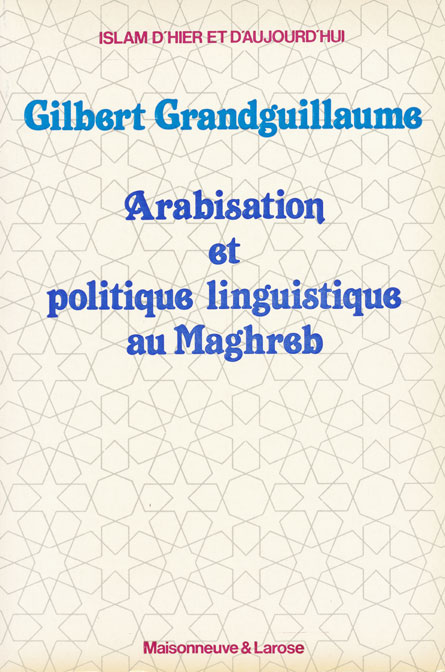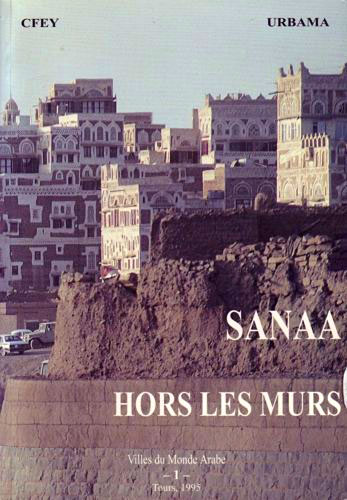|
Articles
| ÊTRE ALGÉRIEN CHEZ SOI ET HORS DE SOI |
. |
Référence : Intersignes N°10, Penser l’Algérie, printemps 1995, p.79-88
|
Aujourd’hui en Algérie, la violence éclate partout. Une violence dont les politiques analysent les causes : rejet d’un pouvoir corrompu, refus d’une morale imposée, situation économique dégradée, mépris des droits élémentaires des citoyens : toutes les études sur l’Algérie le montrent à l’évidence.
Mais il y a une violence plus sourde, plus profonde : celle qui naît de la dépossession de soi , de la non-reconnaissance de ce que l’on est...C’est de cette violence-là que je voudrais parler, parce qu’elle me paraît être à la base de tout le reste.
En quête de l’algérianité: l’arabisation ?
Quand je suis revenu à Alger en 1992, l’une des impressions qui se sont imposées fortement à moi était celle-ci : les Algériens vivent dans leur pays comme s’il n’était pas à eux, on ne sent nulle part la prise de possession joyeuse de ses espaces, de ses lois, de sa langue. Un peu comme si l’on était resté figé sur une situation antérieure. Certes, beaucoup de transformations avaient eu lieu : création d’usines, développement d’écoles, d’instituts, mais le tout un peu comme le prolongement de quelque chose d’antérieur. Certes une rupture était apparue, qui pourrait s’exprimer autour du mot “arabisation”: enseignes en arabe, media en arabe, enseignement en arabe: mais l’opération ne se présentait pas comme une “prise en main algérienne” d’une situation. Elle semblait plutôt être le résultat d’une lutte de pouvoir entre clans différents, tentant de jouer sur deux modèles : soit la traduction en arabe de ce qui était en français, mais en gardant le même cadre, soit en tentant d’importer un autre modèle, venu du Moyen-Orient. Dans ce dernier cas, le modèle proposé portait la marque d’une pédagogie traditionnelle dans les pays arabes : celle de la transmission du savoir par sa mémorisation, modèle adapté à des sociétés où le savoir est avant tout une vérité acquise à transmettre comme un dépôt (hafdh) qu’une nouveauté à acquérir par l’exercice d’une raison ouverte au changement, à de nouveaux objets, en exerçant à leur égard une faculté de choix. De la sorte l’arabisation n’apportait pas réellement une alternative, elle pouvait se couler dans le modèle français, ou introduire un modèle moyen-oriental. Mais où était l’Algérie en tout cela ? Certes, les attributs officiels étaient toujours là : le pays, le drapeau, le discours patriotique, l’Etat, la reconnaissance internationale. Mais quel récit d’origine pouvait fonder cette algérianité, et qui se préoccupait de faire en sorte que les Algériens, les enfants spécialement, se reconnaissent dans leur pays, au point de l’aimer et d’en être fiers ? Quelles sont les sources d’une algérianité spécifique à substituer à la situation - certes ancienne, mais toujours présente tant que ses traces n’ont pas été réécrites ailleurs - de colonisation ?
Une nouvelle référence : l’islamisme
Depuis dix ou quinze ans, une nouvelle référence s’est affirmée : l’islamisme. Certes pas nouvelle comme référence, puisque le fait d’être musulman est depuis des siècles une composante essentielle de l’identité maghrébine. En Algérie, en l’absence de toute référence symbolique autonome d’une identité algérienne, - à la différence de ce qui prévalait en Tunisie et au Maroc - , il est probable que l’islam, en tant que croyance, mais aussi que culture globale, a fourni le point d’ancrage autour duquel le fait d’être algérien pouvait conserver un sens. Mais, à la différence de ce qui avait été le cas pour Ben Badis dans les années 30 - la devise de son mouvement était : “L’Algérie est notre pays, l’arabe est notre langue, l’Islam est notre religion”, cet islamisme nouveau n’affirme pas une dimension nationale. Les pratiques et les usages qu’il introduit ne sont pas ceux de la tradition algérienne. Le mouvement trouve son inspiration dans la protestation contre l’injustice profonde du pouvoir établi, sa faillite dans sa mission de restaurer une Algérie digne, libre et accueillante pour ses enfants. Ayant perçu que ce pouvoir, en ses pratiques et en ses abus, en son idéologie (le développement) et son fonctionnement (la bureaucratie jacobine), ne faisait que prolonger une marque étrangère de pouvoir, l’islamisme propose un modèle antithétique (l’islam) en lequel tout Algérien ne peut que se reconnaître, sauf à être victime d’un profond malentendu sur son contenu : un retour aux origines, certes, mais lesquelles ? celles de l’islam historique, ou celles de l’Algérie ? Un tel retour ne peut être salvateur que s’il prend la forme d’un mythe, qui engage le passé dans une relecture du présent, dans une fidélité qui permet de vivre le présent réel et d’aller plus loin. Si ce retour aux sources est au contraire mouvement de retrait face à une nouveauté inquiétante faute de pouvoir être assumée (et la vie ne peut être que changement), il ne peut que pétrifier une société, l’enfermer dans ses problèmes, la condamner à les voir ressurgir périodiquement.
Une situation spécifique
Ceci pour exprimer mon questionnement par rapport à une situation qui me paraissait spécifique. Car ce manque d’affirmation d’une personnalité algérienne dans ces divers domaines me semblait aller de pair avec une relation de dépendance excessive entre cette société, et celle qui l’avait façonnée durant cette longue période de colonisation. Les affrontements multiples qui avaient marqué la période de l’indépendance n’avaient pas suffi à rendre les deux parties suffisamment autonomes l’une vis à vis de l’autre, comme si d’une part l’Algérie ne pouvait se poser que dans son opposition à la France, et d’autre part, comme si la France ne pouvait s’empêcher de penser et d’agir comme si elle avait quelque chose à dire dans les affaires de l’Algérie. Ceci naturellement en dépit de dénégations répétées et massives. J’avais le sentiment que le problème n’était pas, comme on le soulignait souvent, de “renforcer les relations” entre les deux pays, mais bien plutôt de les concevoir autrement : en quelque sorte, le sentiment que le dialogue devenait difficile faute de distance, comme si les deux partenaires avaient besoin de se démarquer chacun l’un de l’autre, afin de pouvoir dialoguer, échanger.
Je parlais de ceci avec une psychanalyste de passage à Alger : “Ce que vous décrivez, dit-elle, désigne typiquement les relations de l’adolescent avec ses parents. Il ne cesse de s’opposer à eux, de s’en démarquer, mais en même temps, il ne peut les quitter, il demeure dans leur dépendance malgré lui. “ J’ajoutai : “ Comment cette situation se résout-elle, pour le mieux, pour ces adolescents ? “Le problème se règle quand l’adolescent devient amoureux. Cet acte le constitue en adulte, il peut se détacher de ses parents en s’attachant à celle qu’il aime. Il quitte alors son statut d’enfant dépendant, et peut commencer avec ses parents une relation d’adulte à adulte, d’égal à égal : une réelle situation de dialogue et d’échange.”
Même si les choses ne se passent pas toujours selon cette voie, chacun sait du moins qu’elle existe. Il arrive que les parents ne veulent pas lâcher, que les enfants s’enferment dans la relation, mais toutes sortes de compromis sont possibles face à une orientation tracée.
Mais alors, quand il s’agit non d’individus, mais de sociétés , qu’en est-il ? Quand une société s’émancipe d’une autre, qu’en est-il ? Peut-on concevoir ce type de relations? S’agit-il ici d’une analogie dépourvue de tout sens ?
On voit bien ici tous les obstacles idéologiques qui interdiraient de penser la situation d’une telle façon. Assimiler la situation coloniale à celle d’une “tutelle”, qui aurait pour mission de faire passer la société colonisée de l’état d’”enfant” à celui d’”adulte”? Des générations de sociologues, d’idéologues, de militants vont se dresser pour crier : “Quelle honte ! Oser dire que les sociétés, parce qu’elles ont été dominées, victimes de l’impérialisme mercantile, n’étaient pas adultes ! Les prendre pour des primitifs, pour des enfants ! Il s’agit simplement de sociétés adultes, qui ont été brimées, et qui n’ont à recouvrer que leur liberté !” Et c’est ainsi que, depuis des années, il est interdit de penser l’essentiel.
La question que je pose ici est complexe, et je ne prétends pas en avoir la solution : peut-on envisager qu’il y ait, entre des sociétés différentes, une filiation, une transmission ? La question ici n’est pas d’amnistier l’injustice des conquêtes coloniales, elle est de comprendre quelle sorte de phénomène s’est passé dans ces rapports. En particulier, à l’instar de ce qui se passe dans les familles, pourrait-on imaginer des rapports de ce type entre des sociétés ? En ce qui concerne la France et l’Algérie, l’ambivalence des rapports a été souvent remarquée, au point d’être presque devenue aujourd’hui un lieu commun.
Si on considère que le but des rapports parents-enfant est de permettre à celui-ci de devenir un adulte, on pourrait supposer que celui des rapports de deux sociétés permette à l’une de devenir ce qu’est l’autre : en clair, on supposerait que, voulue ou non, souhaitée ou non, la période de colonisation avait pour terme de faire que l’Algérie devienne une nation comme la France. Là encore, s’élèvent les cris des idéologues et des nationalistes : l’Algérie était une nation bien avant 1830...Je laisse la question en suspens. On peut alors voir la question autrement : dans un face à face avec une nation colonisatrice comme la France, quel effet de miroir pouvait se produire sur la société algérienne ? Pouvait-elle, consciemment ou non, souhaiter devenir comme elle ? Bien des indices - et c’est là tout le substrat de l’idéologie de l’indépendance - nous disent que non : en premier lieu, la société algérienne se percevait comme une société musulmane, radicalement différente de cette société chrétienne sous la domination de laquelle elle était provisoirement tombée. Donc, du refus, oui, évidemment. Mais n’y avait-il pas autre chose ? La société coloniale a exercé une attraction sur la société colonisée. C’est en effet par elle qu’elle a été mise au contact de la technique, de l’ouverture à d’autres horizons, voire de la libéralisation des habitudes et des mœurs. Que cette influence se soit exercée sur l’élite cultivée, cela semble évident. Mais il faut certainement aller plus loin, et affirmer que, dans son ensemble, et malgré tous les facteurs manifestes de résistance, un profond attachement s’était créé entre les deux pays.
La proclamation de l’indépendance, à la suite de l’affrontement de la guerre, est supposée avoir tranché le lien, dénoué cette situation : et si ce n’était pas le cas ? C’est sur cette question que je voudrais susciter la réflexion par quelques notations.
En janvier 1991, à la suite de l’interruption du processus électoral, le président Mitterrand avait dit, à la télévision, que la “reprise du processus électoral” était souhaitable. Ce propos, qui pourrait à la rigueur relever du simple bon sens, et n’est d’ailleurs refusé par personne, avait pris en Algérie une dimension considérable. Pour beaucoup d’Algériens, c’était là une intrusion inadmissible dans les affaires de l’Algérie. Ce propos était considéré comme celui de quelqu’un qui aurait eu une légitimité quelconque à parler de l’Algérie (alors qu’il aurait pu être considéré comme le propos d’un quelconque chef d’Etat étranger). A la suite de cela, ou plutôt dans le même ordre d’idées, j’ai constamment constaté que, en Algérie, la France était tenue responsable des principaux malheurs du pays : la France avait créé le FIS avec sa télévision (mais pourquoi celle-ci y a -t-elle un tel impact ?), elle était soupçonnée d’avoir monté des attentats (ex. celui de l’aéroport d’Alger, en août 1992), d’intervenir dans les affaires. Même si on admet que des interventions aient pu être réelles, on ne peut s’empêcher de voir en ces accusations perpétuelles le déploiement de représentations imaginaires.
L’imaginaire français connaît des débordements analogues. A la suite de l’attentat qui a coûté la vie à cinq ressortissants français, sur le champ, deux ministres français se sont permis de débarquer à Alger le jour même : c’est-à-dire sans les consultations habituelles qui marquent ce genre de visites. Le caractère étrange de cette démarche a échappé à la plupart des observateurs, au contraire cela a presque paru naturel : seul le journal espagnol El Pais eut, quelque temps après, un article pour s’en étonner : ces ministres s’y étaient rendus comme s’il se fut agi des DOM-TOM.
D’une façon plus générale, la politique de coopération, dont l’analyse précise nécessiterait une longue étude, s’est toujours présentée en soutien du régime existant. Elle a toujours conçu la relation de coopération comme devant être faite avec un autre elle-même : parlant français, adhérent à la culture française, donnant des gages d’acculturation à la modernité. Mais elle n’a jamais envisagé la relation avec un autre, et encore moins avec une société ayant besoin de trouver en elle-même ses propres repères d’identification. Cette coopération prenait de ce fait la coloration de défense d’une “zone d’influence” : la question de la langue en est à la fois l’emblème et la manifestation la plus caractéristique. A l’appareil de francophonie mis en place comme institution, l’Algérie a toujours opposé un refus énergique, tout en demeurant en même temps le pays comptant le plus de francophones.
Une Algérie double
Cette question de la francophonie fait apparaître une Algérie double : l’une dont les attaches à la France sont de tous ordres : linguistiques, culturelles, économiques : c’est généralement, mais pas toujours, la fraction la mieux insérée dans ce qu’il est convenu d’appeler le “processus de développement”. Certains ont tendance à trouver refuge en France, désespérant de voir leur société s’assumer comme telle. L’autre partie de la société restera en Algérie, mais y sera-t-elle chez elle? Comment trouvera-t-elle les ouvertures sur autre que soi, qui constituent l’humain, individu ou société ? Surtout, comment trouvera-t-elle le moyen de s’aimer elle-même, comme société, assumant son passé aux origines multiples, s’engageant dans la modernité sans éprouver le sentiment de s’y perdre ?
Au delà des individus qui, d’un côté ou de l’autre, tentent d’échapper à la mort, se pose le problème d’une société comme telle. Une société ne peut se retrouver elle-même dans la seule dénégation de l’autre, dans le seul retour à un passé imaginé comme l’est tout passé. Pour émerger comme société “adulte”, partenaire des autres à égalité, elle doit d’abord s’octroyer la première reconnaissance, celle qui vient d’elle-même.
Se reconnaître dans sa langue
En ce domaine, le champ est immense, mais le départ devrait être donné par la décision initiatrice, fondatrice. Ce qu’une société a de plus profond, ce en quoi elle pense et réalise sa transmission, c’est sa langue. C’est la langue parlée effectivement par les Algériens qui devrait bénéficier en premier lieu de cette reconnaissance. Le problème ici n’est pas de se mettre à confondre les langues parlées et les langues écrites, la question est de donner à tout Algérien le droit de parler dans la langue de ses parents, le droit d’en être fier, le droit de recevoir par elle la reconnaissance de la légitimité de son origine, de son patrimoine, le droit d’avoir, à travers elle, le sentiment que l’Algérie est son pays, qu’il y a sa place, que ce n’est pas qu’une affaire de politiques habitant à Alger. L’objectif serait de lever en ce lieu la conscience de mépris qui a été attachée à l’Algérien, comme citoyen, à travers sa langue. Il n’y a pas d’autre moyen de créer, à partir de là, une conscience d’attachement des citoyens à leur pays.
Certes, une autre référence est là, présente dans l’histoire et dans les esprits : c’est la politique de la France, écrasant et méprisant ses dialectes régionaux pour souder l’unité nationale. Mais la France républicaine avait mobilisé, dans cette opération, l’attrait des populations rurales pour la modernité et la promotion sociale qu’elle entraînait, et sans doute aussi le désir d’affranchissement de traditions affrontées à un autre monde. Il n’est pas sûr que le résultat ait été bien acquis, ni qu’il se soit fait sans dégâts : le sentiment d’une perte subsiste dans l’attirance de ces citoyens pour leurs régions et langues d’origine. Une politique plus éclairée aurait sans doute pu concilier l’enracinement dans le terroir et l’ouverture à une dimension plus large.
L’absence en Algérie d’une langue commune entre la population et le pouvoir pèse lourdement . Au journal télévisé, j’ai souvent constaté combien les représentants du pouvoir étaient handicapés dans leur expression : visiblement aisée en français, difficile en langue nationale, c’est-à-dire en arabe international. En 1992, à Alger, lors d’une grève d’Air-Algérie, la présentatrice journal télévisé avait invité sur son plateau le PDG d’Air - Algérie, un jeune homme dynamique et décidé. Elle lui demande des explications sur cette grève. Il répond en quelques phrases : il y a eu des accords avec les syndicats quelques mois auparavant, rendez-vous a été pris pour discuter des salaires en février suivant, il n’est donc pas question d’en discuter avant. La télévision montre quelques plans d’usagers entassés dans les aéroports à attendre des avions qui ne viennent pas : quelle décision prendra-t-il ? quand cette grève va-t-elle cesser ? et ces pauvres gens ? Chaque séquence d’images est suivie d’un retour sur le PDG mis en question. Étonnamment, il répète à chaque fois les mêmes phrases. Finalement, devant quelques images encore plus pitoyables qui semblent l’accuser, lui responsable, il craque : c’est-à-dire, il se met à parler en français. Exceptionnellement, on ne lui coupe pas le son, il peut donc exposer longuement et clairement les raisons qui font qu’il serait déraisonnable d’augmenter les salaires dans cette conjoncture. En arabe, il ne pouvait que répéter une partie infime de cette argumentation.
Le fait de bien posséder l’arabe “classique” - il s’agit toujours de l’arabe écrit - ne garantit pas une meilleure communication même entre gens instruits (Ne parlons pas ici du peuple...). En 1993, le ministre des Affaires religieuses s’était institué imam de l’Algérie, et prêchait le prône (khutba) du vendredi à la mosquée, retransmis en direct à la télévision. Appelant les musulmans à l’unité, il déplore le malheur des temps. “Pourquoi tue-t-on des policiers, alors qu’ils ne sont même pas communistes ni athées?”... Poursuivant son raisonnement, il déclare : “Inna-l-ahzâb saratân al-chu’ûb” : la phrase est entendue par certains comme signifiant : “les partis sont le cancer des peuples” : triste proposition pour un ministre d’un gouvernement qui garantit la démocratie... En réalité, le prédicateur, se référant au Coran (sourate XXXIII) et à la littérature religieuse, a voulu dire que “les factions sont le cancer des sociétés”, reprenant un thème courant de la littérature religieuse qui dénonce les “factions”.
Cet écart par le langage existe aussi entre couches cultivées et populaires. Un universitaire se plaignait d’être souvent agressé verbalement en passant dans son quartier. Un jour sa voiture lui fut volée. Par un circuit dont l’Algérie a le secret, il finit par être en contact avec les voleurs. Ceux-ci lui rendent sa voiture, mais lui adressent ce reproche : “Mais tu vis parmi nous, et tu ne nous parles jamais !” : il avait simplement été volé comme une sorte d’étranger... Quelque temps plus tard, je raconte ce fait à un autre universitaire qui en est surpris, mais me raconte aussitôt une histoire identique qui lui est arrivée à lui. Il habite dans un autre quartier. A l’occasion d’une collecte de quartier, un jeune homme vient s’adresser à lui ; les autres jeunes gens sont surpris, il explique alors à ses camarades : “Monsieur X habite dans notre rue depuis vingt ans, mais il ne connaît pas nos noms, mais nous, nous le connaissons.” Il est bien évident que des différences sociales sont inévitables en tout milieu, mais il est non moins évident que la pratique de la langue locale permet non seulement la communication, mais aussi la conscience d’une communauté de vie.
Que conclure de tout ceci, sinon qu’un véritable dialogue ne peut se faire qu’entre partenaires distincts, ayant chacun leurs repères propres. Qu’un pays, pour exister, doit pouvoir être fier de soi, c’est-à-dire assumer son passé, son histoire, sa langue. Est-ce à travers ces conditions qu’un adolescent peut quitter sa mère pour mieux la retrouver ? Avant de parler de relations, de dialogue, de coopération, n’est-il pas important de s’assurer que la rupture des anciennes dépendances s’est bien effectuée, que des entraves ignorées ou méconnues ne viennent pas à chaque instant remettre en cause les bonnes intentions dont l’enfer est, dit-on, pavé ?
|
|
|