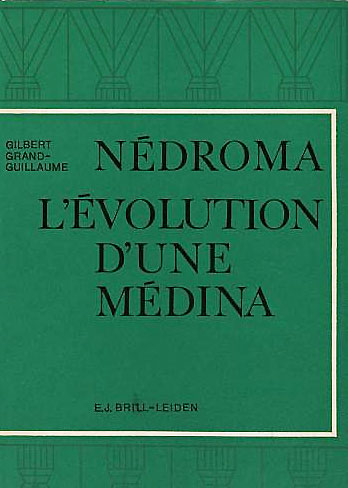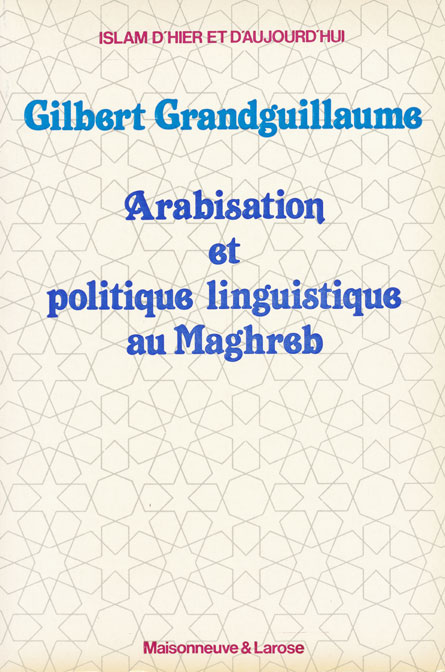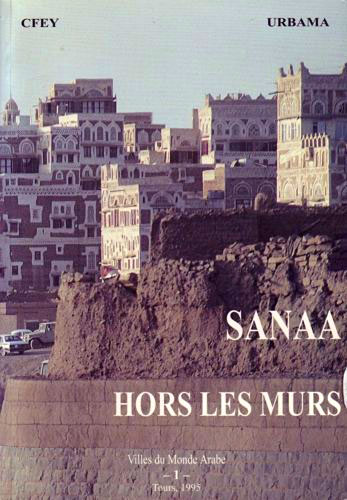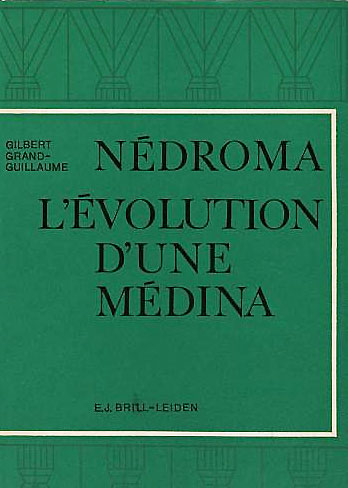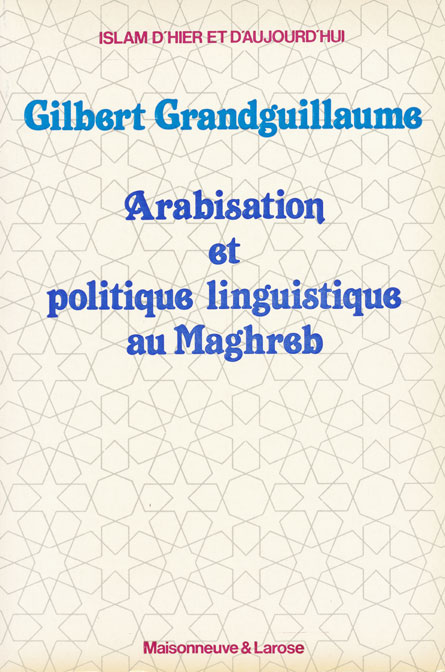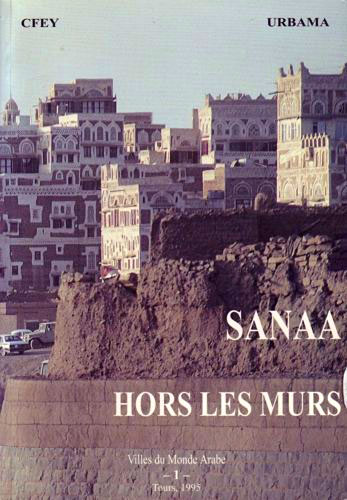|
Compte-rendus
| IBN KHALDÛN AUJOURD’HUI : ANCÊTRE OU GUIDE ? |
. |
La Quinzaine littéraire, N°935, 1-15 déc. 2006, p.19-20
|
Abdesselam Cheddadi, Ibn Khaldûn. L’homme et le théoricien de la civilisation, Gallimard, octobre 2006, 523 p., 30 €
Krzysztof Pomian, Ibn Khaldûn au prisme de l’Occident, Gallimard, octobre 2006,234 p., 13,50 €
Claude Horrut, Ibn Khaldûn, un islam des « Lumières » ?, Editions Complexe, septembre 2006, 259 p., 16,90 €
En cette année du quatrième centenaire de la mort d’Ibn Khaldûn, on s’interroge à juste titre sur la portée de l’héritage qu’il a laissé. Quelles leçons tirer aujourd’hui des analyses qu’il fit autrefois des sociétés musulmanes ? Fut-il un penseur libre ou un traditionaliste élitiste ? En quoi ses intuitions peuvent-elles nous éclairer aujourd’hui ?
Les écrits novateurs d’Ibn Khaldûn trouvèrent peu d’écho en leur temps : ce n’était plus l’époque de la vitalité andalouse, des échanges de pensée entre centres intellectuels. Le monde musulman se trouvait sous la menace mongole d’un côté, la pression de la Reconquista de l’autre, et d’une désintégration interne des centres de pouvoir. Il se refermait sur lui-même, et dans ces occasions, les formes religieuses les plus traditionnelles prennent le dessus. Oublié donc Ibn Khaldûn pour quelques siècles, jusqu’à sa découverte par les orientalistes au XIXème siècle. On va ainsi passer d’un extrême à l’autre : de l’historien oublié on va faire l’inventeur des sciences sociales, le précurseur du marxisme, le fondateur de l’anthropologie, voire le penseur dont l’Occident veut s’approprier l’héritage. Abdesselam Cheddadi pense que vouloir en faire trop ne peut qu’obscurcir son message, voire le priver de son originalité. La question est plutôt de comprendre sa pensée sans l’extraire de son contexte culturel et politique, et de tenter de l’expliciter en dehors des moules forgés par la suite par la pensée occidentale. A terme Cheddadi souhaiterait montrer à partir de son œuvre comment une pensée rationnelle a pu naître au cœur d’un islam isolé de son contexte médiéval, et comment elle pourrait s’épanouir dans des catégories de pensée qui ne seraient pas celles de l’Occident. C’est sans doute une noble ambition que de vouloir tordre le cou au narcissisme occidental, à condition de ne pas tomber dans une démagogie dont n’a que faire l’opinion musulmane.
En fait Abdesselam Cheddadi, à qui l’on doit une remarquable traduction assortie d’une solide introduction dont il a été parlé ici entreprend un long commentaire que d’aucuns pourront trouver fastidieux dans la mesure où il glose un texte dont la lecture directe satisfait davantage. Reprenant des exposés désormais bien connus, il n’apporte pas d’élément nouveau qui permette d’avancer dans la compréhension du personnage. Une telle prolixité ne met pas suffisamment en valeur l’importance des problèmes posés, en particulier celui, central, de ce que pensait réellement Ibn Khaldûn du rôle de la raison, de la marge de liberté dont celle-ci pouvait disposer, bref de son rapport à la philosophie. Plutôt que de consacrer des pages à réfuter l’opinion de Muhsin Mahdi selon laquelle il serait un « crypto-philosophe » il serait plus important de se demander pourquoi un penseur si imprégné de la raison dans ses conceptions et sa pratique s’est cru obligé de la renier : était-il sous la menace d’une intolérance à ce mode de pensée et s’estimait-il tenu à une grande prudence : position qui semblerait naturelle pour un homme dont une grande partie de la vie a consisté à tenter d’échapper aux complots et aux cabales, et qui savait que le moindre faux pas de sa part serait exploité par ses ennemis. L’autre hypothèse est qu’Ibn Khaldûn expose dans ses écrits une position personnelle : en tant que croyant traditionaliste, il estimerait sincèrement que la philosophie est dangereuse pour la religion et qu’il faut donc l’éviter. Ce point de vue est celui qui paraît ressortir des commentaires de Cheddadi :
« Ce qui se dégage clairement de l’Autobiographie, ce sont les hésitations et les contradictions d’Ibn Khaldûn, le souci permanent qu’il avait de servir sa propre ambition mais sans trop se compromettre, attitude s’expliquant amplement par l’ambivalence de sa personnalité, partagée entre l’amour des grandeurs et l’attirance des valeurs intellectuelles et spirituelles. Et, s’il faut caractériser son idéal politique, il serait plus conforme à la vérité de parler de conservatisme que d’esprit de réforme. » (p. 206)
Claude Horrut qui, d’une manière plus pédagogique et condensée, analyse bien les thèmes d’Ibn Khaldûn et les opinions de ses commentateurs, adopte une position analogue : « La révolution intellectuelle khaldûnienne, si elle introduit une exigence de rationalité pour l’histoire religieuse comme pour l’histoire profane, n’en avance pas pour autant que la raison peut maîtriser un champ que seule la Prophétie permet de connaître. Répétons-le contre toutes les lectures ethnocentriques occidentales : on se situe en deçà de la pensée d’Ibn Rushd (Averroès), dont les docteurs de la Loi et les sultans d’alors brûlèrent les livres. » (p.178)
De ces deux auteurs ressort la vision d’un homme bien de son temps, pour qui la religion est un horizon indispensable, mais qui pense malgré tout que la raison peut exercer une activité autonome, ce qui lui permet d’écrire cette œuvre pour laquelle il est universellement encensé aujourd’hui.
Krzysztof Pomian est allé au-delà. Au lieu de s’en tenir au discours courant il s’est interrogé sur le rapport réel de Ibn Khaldûn à la philosophie. Il remarque d’abord que, quoi qu’en dise Cheddadi, il est aristotélicien dans sa démarche de pensée : « Pour caractériser sa science, Ibn Khaldûn a recours à des catégories propres à la philosophie : » essence », « accident », « voie démonstrative qui ne laisse point de place au doute ». Il introduit aussi dans la définition même de sa science la notion du temps, en insistant sur la succession des états qui affectent dans son essence la société humaine. Nous avons ici affaire à une science au sens aristotélicien de ce terme, même si Ibn Khaldûn prétend être redevable de ce qu’il sait de l’Etat et du pouvoir « à Dieu seul… et non à l’enseignement d’Aristote ou aux leçons du Môbedh ».Il le prétend, parce qu’il ne voulait certainement pas être qualifié de philosophe. » (p.91). Sa science est ainsi proche de la pensée politique du nord de la Méditerranée, mais celle-ci se référait principalement à deux œuvres d’Aristote : la Politique et l’Ethique à Nicomaque. Ce n’est pas le cas d’Ibn Khaldûn : « Comme beaucoup de novateurs, Ibn Khaldûn ne signale pas tous les travaux qu’il a utilisés et dont, pour certains, il a assimilé la substance au point de la faire sienne. Tout porte à croire que, parmi ceux-ci, figurait De la génération et la corruption d’Aristote, bien qu’il ne soit cité nulle part, ou alors qu’Ibn Khaldûn en connaissait le contenu d’une manière ou d’une autre. Or, faut-il le dire, ce n’est pas un ouvrage qui traite de la politique ou de la société. Le coup de génie d’Ibn Khaldûn consistait à en reprendre le cadre catégoriel et l’appliquer aux données fournies par son expérience des cours, des villes et des tribus du Maghreb, de l’Ifrîqiya et de l’Andalus, par la lecture des documents, des historiens et des chroniqueurs, par l’écoute des récits des évènements auxquels il n’a pas pu assister lui-même…Ibn Khaldûn est donc aristotélicien non pas parce qu’il commente Aristote, ce qu’il ne fait guère, ni parce qu’il en reconnaît l’ autorité, il en est loin. Il l’est parce qu’il pense avec des catégories d’Aristote à un objet auquel ce dernier n’a pas pensé. » (p.95-96)
A partir de ces constations Pomian revient sur la question de l’Etat et la profonde différence dans la conception qu’en ont ses contemporains d’Occident (qu’il ignore de toute façon, mais Pomian a dit par ailleurs que les questions qui se posent sont les mêmes sur les deux rives de la Méditerranée). Alors que l’Etat d’Ibn Khaldûn est soumis à la génération et à la corruption ( du fait qu’il s’est coupé de la pureté de ses origines incarnée dans la période des premiers califes…), l’Occident latin est en train, à travers maints soubresauts, de concevoir un Etat immortel, non par référence à la religion, mais en opposition à elle, sur la base de la distinction spirituel temporel totalement étrangère à Ibn Khaldûn. La constitution de pouvoirs temporels, à l’époque d’Ibn Khaldûn, sous la forme de monarchies, mais aussi de républiques et d’assemblées communales, est l’aboutissement d’une revivification du droit romain, d’abord par l’Eglise puis contre elle, telle que celle qui est concrétisée par le vieil adage : « Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet (Ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde). » (p.38) Il se dégage ainsi en Occident une conception d’un pouvoir temporel stable édifié sur la base de la société des hommes, secrétant sa propre loi, concrétisé sous la forme de nations, de régions ou de villes et ouvrant la voie à une modernité vouée à s’affranchir de la tutelle religieuse sur les comportements ou les esprits. Partant de préoccupations identiques sur le pouvoir politique chez Ibn Khaldûn et ses contemporains européens, la réflexion s’oriente en des voies opposées. Pour les sociétés modernes, la légitimité du pouvoir politique sera tirée d’une constitution issue d’un contrat, pour Ibn Khaldûn, le lieu symbolique du pouvoir demeure l’islam garant d’une permanence, tandis que génération et corruption rythment la succession des tenants d’un pouvoir qui n’a pas su conserver la pureté originelle des premiers khalifes.
Ces conceptions construites à partir de l’observation des sociétés musulmanes qui l’entouraient ont-elles été considérées par Ibn Khaldûn comme satisfaisantes ? A-t-il entrevu des alternatives que l’intolérance ambiante l’a empêché de formuler ? Ce problème de la légitimité du pouvoir et son fondement demeure un problème-clé des sociétés d’aujourd’hui. Le penseur courageux que fut Ibn Khaldûn, pessimiste sur le devenir des sociétés qu'il observait, pouvait-il ouvrir une autre voie ? Sa réflexion en fournit-elle les éléments ? La réponse à cette question serait certes d’une plus grande portée pour nos contemporains que de savoir s’il fut l’ancêtre de la sociologie, de l’anthropologie, de l’histoire ou de toutes les sciences sociales.
|
| 1 La Quinzaine littéraire N° 847 du 1-15 février 2003
2 Muhsin Mahdi, Ibn Khaldûn’s Philosophy of History : A Study in the Philosophic Fopundation of the Science of Culture, Londres, 1957.
|
|