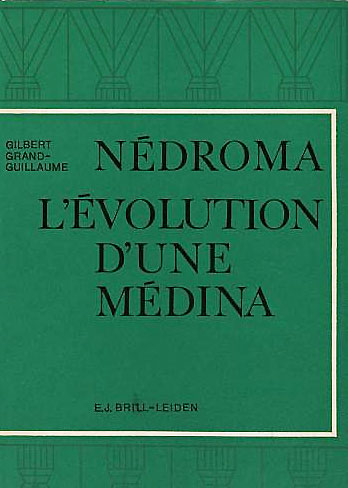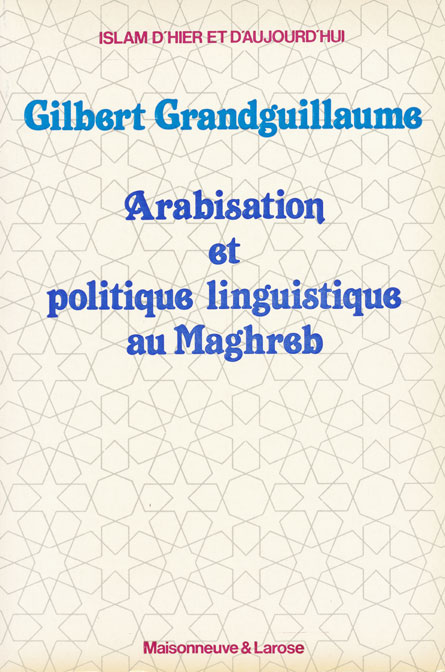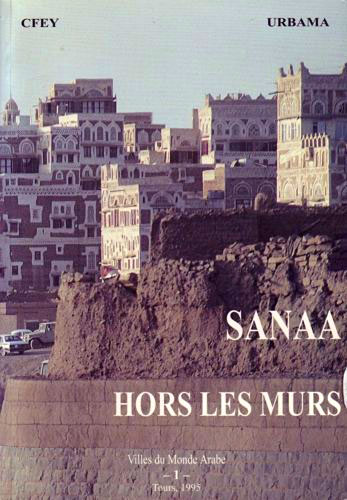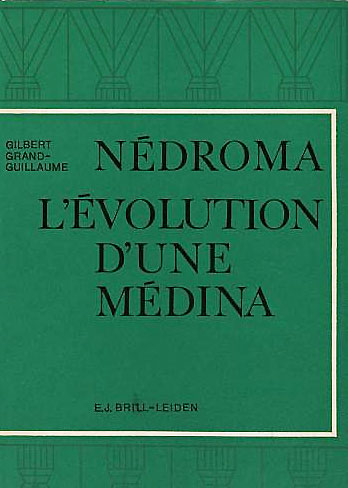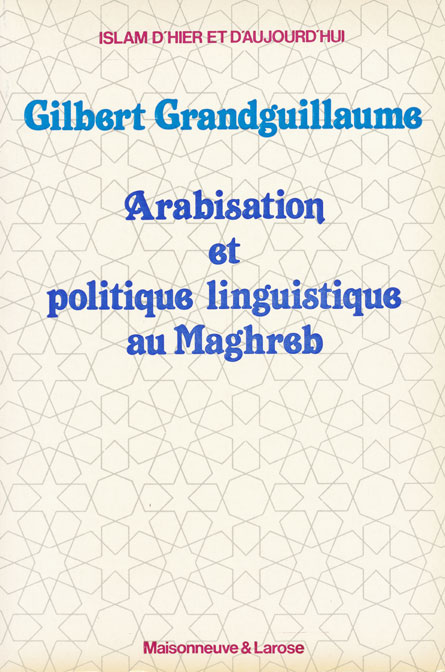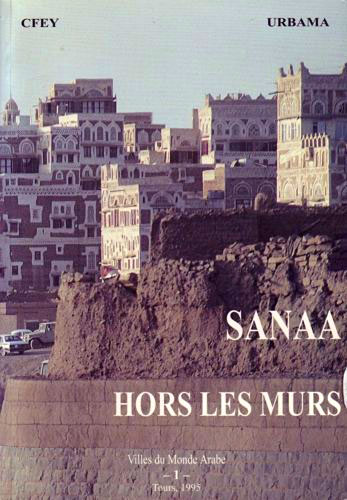|
Compte-rendus
| LA GUERRE CIVILE EN ALGERIE |
. |
Maghreb-Machrek, N°161, juillet-sept.1998, p.183-185.
|
Luis Martinez, La guerre civile en Algérie.
Paris, Karthala, coll. Recherches internationales, 1998, 429 p.
Dans l’abondante littérature à laquelle la situation en Algérie a donné lieu, l’ouvrage de Luis Martinez apporte un renouvellement de la réflexion. Une perspective historique prolonge le vécu quotidien dans une longue série : les islamistes violents d’aujourd’hui s’inscrivent dans la lignée des entrepreneurs militaires issus de la guerre de libération, des caïds gestionnaires du système colonial, et des corsaires pirates de la Méditerranée. L’accent idéologique est déplacé : de l’islamisme religieux fanatique qui bouche l’horizon de maints observateurs, il passe à l’économie comme prédation : le djihad étant la couverture du racket, de l’extorsion, de la fraude et de la course. L’interprétation sociologique voit dans la prédation, acquisition de richesses par la violence, comme un mécanisme général d’ascension sociale pour ceux qui la pratiquent. L’ensemble de la réflexion se fonde sur une observation fine du terrain, l’étude de profils particuliers de différentes catégories sociales : le notable, le maquisard, l’émir, l’entrepreneur, le terroriste ... qui présentent une image réaliste de la situation.
Cette étude met en avant les liens troubles que beaucoup soupçonnaient entre les acteurs de la violence terroriste, associés au pouvoir et aux milieux de la délinquance. Le modèle en est l’entrepreneur militaire, ces anciens officiers de l’ALN que le pouvoir militaire mit à l’écart de la gestion du pouvoir en échange d’avantages économiques et de passe-droits. Les liens qu’ils gardaient avec l’institution leur permettaient des enrichissements rapides que couronnait une respectabilité de notable. Ce modèle, l’émir, le chef de groupe terroriste, “islamiste” ou non, l’a en tête et va tenter de le reproduire pour son compte. La “virilité” affichée par le défi de la loi, le déploiement de force par la violence, la généralisation de l’attaque de banques, puis du racket lui procurent non seulement les moyens de la guerre, mais aussi la constitution d’un capital qu’il va investir par exemple dans des sociétés d’import-export. La privatisation de l’économie, la réduction des barrières douanières, la désorganisation des anciens circuits commerciaux constituent un climat favorable à cette éclosion, au sein de l’”islam-paravent”, d’une économie mafieuse. A terme, l’émir peut prendre quelque distance avec le risque de la violence, et se comporter en notable chef de clan. Ce modèle d’ascension sociale est à l’oeuvre au coeur de la guerre civile et grâce à elle. Il se fonde sur ce que l’auteur nomme un “imaginaire de la guerre”. Cette acquisition de biens, puis de statut, par la violence a été maintes fois incarnée dans l’Algérie de la course autrefois, puis dans l’exploitation de la guerre de libération par les militaires. Les émirs, dit-il, “s’inscrivent dans la continuité des figurentes historiques de la réussite sociale en Algérie, que nous avons qualifiées de “bandits politiques”, pour souligner leur trajectoire de hors-la-loi jusqu’à ce qu’ils deviennent des représentants de l’Etat.”(p.373). L’auteur frise ici une interprétation culturaliste de la société algérienne. Si l’existence de ce modèle ne fait pas de doute dans la situation actuelle, il ne semble pas être un trait typique de la “maghrébinité”, puisque il se retrouve en Amérique du Sud, dans la Russie post-socialiste et dans d’autres pays du Tiers-Monde, où les mêmes caractéristiques socio-économiques sont conjuguées.
Dans son analyse, Luis Martinez recourt à juste titre à la notion d’”ennemis complémentaires”, autrefois initiée par Germaine Tillion. Il y a, à la base, les entrepreneurs militaires et les émirs accumulateurs, concurrents dans le contrôle illégal de l’activité économique, les premiers en fraudant la loi, les seconds en la défiant. Ils sont ennemis pour le contrôle du terrain, et la manipulation de valeurs opposées, le nationalisme des uns s’opposant à la “légitimité” islamique des autres. Ils sont complémentaires, leur activité s’exerçant au détriment des sociétés nationalisées qu’ils pillent ou détruisent, et du secteur privé normal qui n’est plus protégé par la loi, mais seulement victime d’une réglementation arbitraire ou simplement sujet au racket. Plus curieusement, ils se trouvent tous deux en synchronie avec le FMI, pour “libéraliser” la société en cassant les sociétés nationales, source principale de l’emploi. “La destruction systématique du secteur public (par le GIA), outre qu’elle a mis au chômage des milliers d’ouvriers, a facilité la politique gouvernementale, recommandée par le FMI, de suppression des subventions aux entreprises déficitaires. Cet arrêt des subventions épargne au régime des conflits sociaux et détourne la colère des ouvriers vers la politique désastreuse des groupes islamistes.” (p.330). L’Etat peut ainsi privatiser sans risque de conflits sociaux. L’insécurité lui donne prétexte à exercer un pouvoir absolu, récemment institutionnalisé par une réforme constitutionnelle sur mesure. Enfin, le combat qu’il mène contre les “islamistes” lui permet de se présenter à l’opinion internationale avec la légitimité du bon droit en butte à la barbarie et à la sauvagerie, dont une information soigneusement contrôlée présente régulièrement des morceaux choisis. Et l’auteur de conclure : “En somme, groupes islamistes et militaires ne sont-ils pas en train de devenir des “ennemis complémentaires” qui trouveraient dans la violence de la guerre les moyens de réaliser leurs aspirations ? (p.259) “
Au vu d’un bilan aussi pessimiste, la question surgit : que reste-t-il de l’Algérie et quelles perspectives se dessinent ?
La conclusion qui s’impose, c’est que la société algérienne, les Algériens du quotidien avec leurs problèmes : niveau de vie, logement, eau, emploi, éducation, sont loin d’être pris en compte par qui que ce soit dans cette vaste mécanique, si l’on excepte les quelques aides que les autorités parsèment par opportunisme politique, pour empêcher la population de glisser vers la révolte. Aucune stratégie d’ensemble n’est pensée pour sortir le pays de la crise qui touche tous les secteurs. Ce qu’une information contrôlée fait monter à la surface épisodiquement ( massacres, pouvoir d’achat, arabisation, identité) est tout à fait secondaire pour le monde des affaires : non seulement ces questions ne sont pas prises en compte pour elles-mêmes, mais elles sont réduites à une utilisation démagogique, populiste ou nationaliste : elles servent à meubler la façade. Ces questions sont de plus masquées par l’insécurité : “Lorsque les populations ne sont plus protégées, ni par les forces de sécurité, ni par des “émirs” qui se réclament du GIA, les délinquants apparaissent comme les acteurs principaux. Lorsqu’ils sont soumis à un “émir”, ils peuvent continuer à “racketter” au profit du GIA. Si la bande est démantelée, ils poursuivent la même activité mais à leur profit, à l’abri, selon les sympathisants de l’ex-FIS, des forces de sécurité agissant pour leur propre compte, ou bien celles-ci les utilisent comme instrument de terreur afin de susciter l’adhésion de la population à la politique menée par le régime...Les délinquants apparaissent dans cette guerre civile parmi les principaux bénéficiaires : que ce soit l’armée ou les bandes armées du GIA qui contrôlent la situation, ils mettent leur “savoir-faire” au service du plus fort. (p.124-125)”
La seule issue envisagée par Luis Martinez est une fusion à long terme des élites guerrières : une intégration des “émirs” dans la structure du pouvoir, de même que celui-ci a absorbé les officiers excédentaires de l’ALN en les intéressant à l’économie de prédation. Il s’agit là d’un processus qui peut être long. Le pouvoir militaire ne peut être renversé par la guérilla, mais il ne peut éradiquer celle-ci. Il s’est acquis l’appui international, non seulement par sa propagande, mais, plus solidement, par les liens créés par les emprunts et les investissements encouragés : “Les investisseurs étrangers (pétrole et gaz) lient un peu plus leurs intérêts à la survie du régime : la défense des bénéfices qu’ils réalisent passe par la protection de ceux qui les permettent. La multiplicité des demandes de crédits et autres prêts participe de la même logique : elle resserre les liens entre les intérêts de la communauté internationale et le sort de l’équipe dirigeante. L’endettement devient alors une garantie pour le régime de bénéficier du soutien des créanciers. (p.278)”
Seul un Etat de droit pourrait apporter à cette crise le seul remède possible : la démocratie. Celle-ci rencontrerait de toutes façons des obstacles internes, depuis le tribalisme clientèliste jusqu’au structures mafieuses maintenant bien implantées, sans oublier la décapitation régulière des élites, durant la guerre de libération, puis dans ces dernières années. Ces obstacles ne seraient pas insurmontables, mais qui veut réellement la démocratie en ce pays ? Ce n’est - ce livre le montre bien-, ni l’armée, ni la guérilla, ni les Etats nationaux (tout à leurs intérêts). Seule une société civile internationale qui ne se laisserait plus bercer par le discours schématique des media (reproduisant trop souvent celui du pouvoir d’Alger), qui déciderait de peser de tout son poids moral, d’abord sur ses propres Etats, et par là sur la situation algérienne, serait capable de mettre en question un régime qui, aux portes de l’Union européenne, et en dépit de ses rodomontades, n’a guère d’autre issue à terme que de s’y associer et d’en accepter les conventions, et en premier lieu le respect de la loi et du droit.
|
|
|