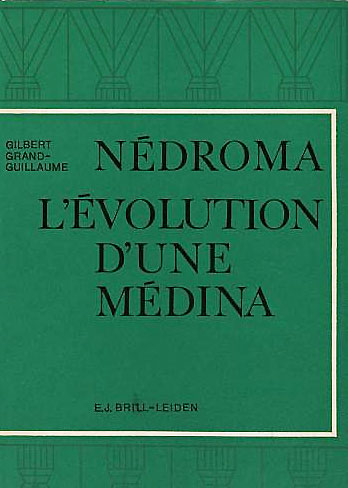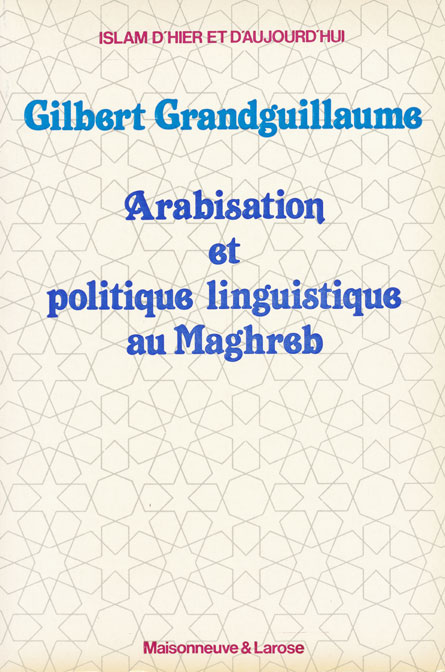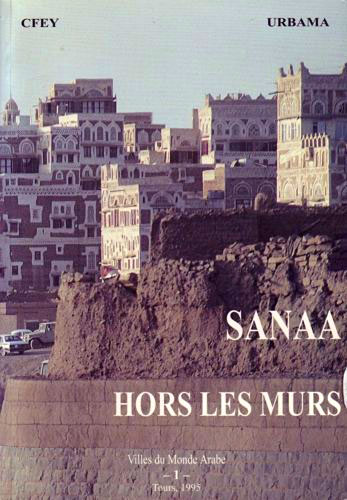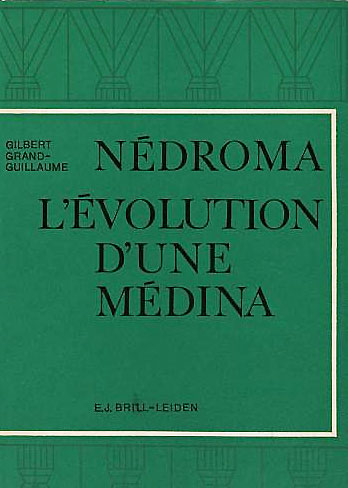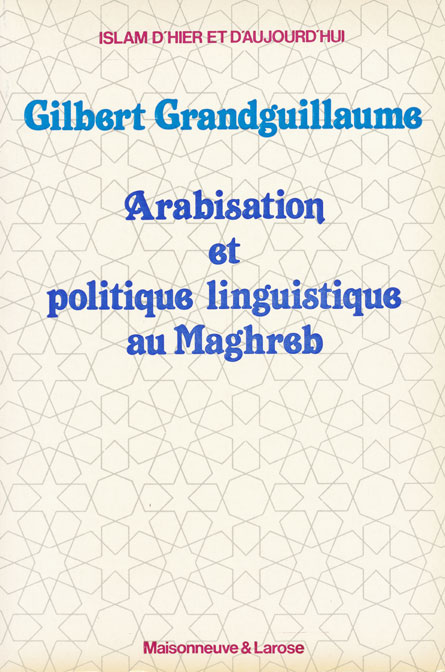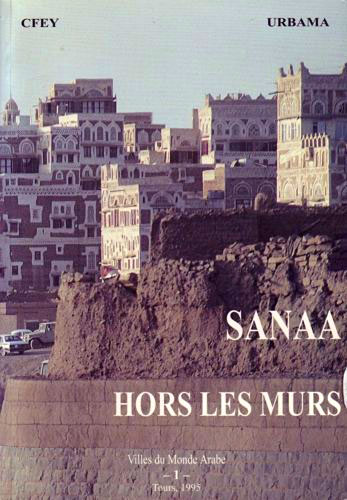|
Articles
| LES ENJEUX DE LA QUESTION DES LANGUES EN ALGERIE |
. |
LES LANGUES DE LA MEDITERRANEE, Editions L’Harmattan, Les Cahiers de Confluences, Paris, 2002, pages 141-165
|
Pour bien comprendre la question des langues telle qu’elle se présente spécifiquement en Algérie, il est important de bien expliciter les enjeux symboliques, culturels, sociaux, et politiques qui lui sont liés. Ces enjeux débordent largement ce qui est généralement entendu par les termes de « question » ou de « politique » linguistique, et ceux qui traitent de ce sujet en en retenant qu’un aspect, fût-il technique ou purement linguistique, génèrent la confusion plus que l’intelligence de la question. Ce sont ces enjeux que nous allons largement expliciter, avant de situer les événements qui ont concerné les langues dans l’histoire récente de l’Algérie.
L’Algérie et la langue arabe
L’Algérie entretient avec la langue arabe un lien particulier qui tient à ses rapports anciens avec l’Islam, mais aussi à la façon spécifique par laquelle elle est entrée dans le monde moderne, par le biais d’une colonisation qui fut d’abord annexion, c’est-à-dire négation de son identité propre.
Islam et langue arabe
Le point de départ concerne la place de l’Islam en Algérie. Les historiens sont unanimes à souligner l’importance de l’Islam structurel dans l’Algérie d’avant 1830 : importance des confréries comme encadrement socio-religieux, nombre importants de lieux de prière et d’enseignement du Coran, souvent pris en charge matériellement par des fondations pieuses (dites waqf ou habous), monopole de la langue arabe pour ce qui concerne l’écrit, l’enseignement, les actes juridiques, les contrats. La conquête coloniale s’est réalisée dans la situation de violence que l’on sait, mais l’une des premières décisions prises par les autorités coloniales a été la confiscation des biens habous entre 1830 et 1844, qui a entraîné l’effondrement progressif des structures d’enseignement de l’islam et de la langue arabe et généré un analphabétisme en arabe. L’État français s’engageait à prendre en charge les activités soutenues par ces biens habous, mais naturellement ces engagements ne furent pas tenus. D’autres spoliations ultérieures ont agi dans le même sens, notamment la confiscation de grandes mosquées (dont celle d’Alger) et leur transformation en églises. Que visait le colonisateur à travers cela ? La confiscation de biens ? Certainement : les grands séquestres de terres opérés à l’occasion de la conquête ou des révoltes ultérieures (comme celle de Kabylie ) ont manifesté cette soif de terres où installer une colonisation européenne. Mais il y avait davantage : la perception que le cœur de la résistance à la France, à son influence, à la légitimation de son pouvoir, se trouvait là, dans l’Islam . Ce faisant, la France qui, de l’autre côté de la Méditerranée, ne tarda pas à s’affirmer comme un État laïc, s’affichait comme une France chrétienne, ressuscitant le passé chrétien de la colonie, construisant ses églises, évoquant une nouvelle croisade à travers son clergé. Cette action où elle apparaissait comme puissance chrétienne a conduit les populations à identifier dans l’Islam le point fort de leur identité, et d’une identité objet de menaces puissantes et graves, notamment par le biais de la scolarisation et de l’extension de la langue française. Ceci permet de réaliser à quel point l’Islam et la langue arabe, langue du Coran (indissolublement liés dans la tradition) sont devenus le cœur de l’identité algérienne, durant toute la colonisation, et aujourd’hui encore pour une grande majorité de la population, sinon pour l’ensemble.
Cette perception a été accentuée par le fait que le régime d’annexion à la France du territoire algérien (de Dunkerque à Tamanrasset) n’a laissé à l’Algérie aucun repère symbolique autre que l’Islam. Ce n’était pas le cas en Tunisie ni au Maroc, où le régime de Protectorat maintenait à la tête de la communauté la personne du bey à Tunis et du sultan à Rabat. Même dépourvus de pouvoir réel, ils permettaient du moins aux populations, par rapport à ce lieu symbolique de pouvoir, de se dire tunisiennes ou marocaines. En Algérie, le nom même d’Algériens était usurpé par la population coloniale, ne laissant aux natifs que la dénomination de musulmans ou d’indigènes. De ce fait la référence identitaire de l’Islam en Algérie est connotée d’une conscience d’identité non reconnue, voire de dignité bafouée.
Cette hostilité de la France à l’Islam et à la langue arabe a été, sauf exceptions rarissimes, une donnée constante de la politique coloniale . Elle a profondément marqué la conscience identitaire de l’Algérie, au point de devenir une composante de base de l’idéologie nationaliste, quand celle-ci commencera à se formuler à partir de 1930, après la célébration arrogante du centenaire de la conquête . C’est pour cette raison qu’aucun pouvoir politique ne peut être reconnu comme légitime en Algérie s’il ne reconnaît pas à l’Islam et à la langue arabe une place de choix. Mais ceci n’entraîne aucune détermination précise de leur place dans la société : l’essentiel porte sur leur reconnaissance en soi.
Société algérienne et colonisation
Une autre ligne de réflexion est à développer à partir de la façon dont la société algérienne a réagi à l’influence de la colonisation. Les études des penseurs algériens et des apologistes inconditionnels de l’Algérie indépendante ont été discrets sur ce point, tant l’unité de l’Algérie, essentielle à affirmer face à l’action déstabilisatrice de la France, devait être érigée en dogme infrangible. Le silence sur cette question a même pris la forme d’un tabou, que peu d’auteurs ont osé briser jusqu’à présent : Mohammed Harbi est le premier à l’avoir fait . De quoi s’agit-il ? Tout simplement de la conception mythique d’une société algérienne homogène : utile à l’idéologie politique, elle s’est trouvée depuis longtemps démentie par les faits. Pour simplifier, disons que la réaction à la colonisation a été de deux types et a déterminé une couche bourgeoise et une couche plébéienne . Une partie de la population est sortie de l’opposition absolue des débuts et s’est appropriée la culture française par le biais de la scolarisation. Elle y était souvent aidée par un statut de « grande famille » caïdale ou confrérique, qui y trouvait un moyen de confirmer sa supériorité sociale. Cela s’accompagnait parfois d’un abandon de la culture arabe, mais souvent d’un apprentissage d’une double culture, arabe et française . Même soumise à la discrimination raciale, cette catégorie sociale a bénéficié d’une promotion sociale en tirant avantage du système colonial, et cela dans des statuts différents : parfois dans le cadre d’une collaboration avec l’administration coloniale ou dans son sein, parfois d’une façon extérieure et indépendante, comme dans le cas des professions libérales. Cette catégorie bénéficiait d’un statut économique et social supérieur à celui de l’autre couche restée en marge des bénéfices de la colonisation. La marginalisation de cette dernière tenait à des causes multiples : elle restait en marge de la scolarisation française pour des raisons économiques (pauvreté), géographiques (zones sans écoles « indigènes »), idéologiques (refus de la culture « chrétienne »). Cette catégorie décrit typiquement une population déshéritée économiquement et culturellement, sans perspective d’ascension sociale, sans ouverture à la modernité. Pour cette couche plébéienne, la seule forme souhaitable que pût prendre la revendication d’indépendance était à la fois de purification (voir partir d’Algérie les incroyants français) et de prédation (récupérer les biens matériels que ceux-ci s’étaient appropriés et qui étaient supposés à l’origine de leur pauvreté) : ce qui incluait spontanément une restauration d’une société musulmane et l’usage prédominant de la langue arabe. La couche bourgeoise francophone (même si elle était aussi éduquée en arabe, mais avec le temps elle le fut de moins en moins) n’avait pas la même vision de l’avenir. Ayant éprouvé les avantages de la culture française, elle ne pouvait envisager son rejet pur et simple : sa requête était globalement réformiste, et visait surtout à se voir reconnu un statut d’égalité de droits et de traitement avec la population européenne. Cette partition sociale est fondamentale et subsiste encore aujourd’hui : on la retrouve souvent dans les oppositions entre « arabisants » et « francisants ». Toutefois elle a fait l’objet – et elle fait encore – l’objet d’une occultation, spontanée ou volontaire, voire d’un tabou, du fait qu’elle est susceptible de manifester une division de la société algérienne, tenue de rester unie face à la France autrefois, aux dangers qui menacent l’Algérie aujourd’hui . En 2002, on pourrait penser que 40 ans d’indépendance ont progressivement réduit le fossé séparant les deux catégories sociales : notre avis est qu’au contraire, ce fossé s’est élargi, par adjonction d’autres critères.
Méconnaissance et dénégation
L’abord de la question des langues en Algérie aurait du, et devrait toujours, prendre en compte ces différentes composantes symboliques et pratiques : une grande sensibilité à la langue arabe du fait de son lien à la conscience identitaire arabo-musulmane en tant qu’alternative à l’identité française, la masse déshéritée pour qui l’accession à la promotion sociale et au savoir passe par la langue arabe (au lieu de la langue utilisée par les francophones dits « parti de la France » ), la nécessité de faire dépasser à la culture arabe le stade archaïque dans lequel elle se trouvait en Algérie, l’obligation de faire de l’Algérie une nation moderne (l’un des enjeux essentiels de la revendication d’indépendance). On aurait pu imaginer un pouvoir national légitimé et responsable prenant en compte ces différents facteurs, et cherchant à programmer la construction d’une identité proprement algérienne, en arbitrant et en composant les deux courants bourgeois et plébéiens dans une synthèse eût assuré la prise en compte des intérêts de tous les Algériens. Dans cette ligne, une programmation linguistique aurait visé à restaurer la place de la langue arabe dans l’originalité de son apport réel, historique et culturel (et non comme simple démarque traductrice de la langue française), à permettre aux Algériens qui le souhaitent l’accès à la langue française pour leur promotion sociale et leur ouverture à la modernité, à prendre en compte le rôle des langues parlées (arabes et berbères) en tant que références identitaires fondamentales (et non de les mépriser et les bannir ). De cette politique linguistique aurait émergé peu à peu, à l’échelle nationale, la conscience d’une identité algérienne respectée dans sa diversité et en tirant profit : une identité algérienne nationale se démarquant à la fois du modèle occidental et du modèle moyen-oriental par son histoire propre, ses traditions, ses langues, ses aspirations.
A l’optimisme de ce rêve s’est substitué une triste réalité. Les politiques suivies en Algérie n’ont pas été le résultat d’options nationales responsables, mais l’enjeu d’affrontements politiques. Des valeurs et des symboles qui pouvaient assurer l’unanimité nationale ont été détournés au profit de luttes claniques. Ce qui aurait pu permettre de construire une personnalité algérienne nouvelle est devenu ainsi l’enjeu de divisions et de haines qui caractérisent la situation actuelle.
Avant de faire mention des principales actions dans le domaine linguistique, il est utile de situer les contextes politiques dans lequel elles vont s’inscrire.
Régimes politiques et contextes de langues
Durant la guerre de libération, la consigne est d’afficher l’unité sans faille de la lutte. Mais ce n’est plus un secret que de dire que se déroulent des luttes violentes pour le pouvoir. Les courants réformistes ont été dépassés par les plébéiens qui ont déclenché la lutte armée en 1954 : des chefs de guerre qui s’appuyaient sur les wilaya, le pouvoir passe aux colonels qui contrôlent l’armée des frontières. Mais la représentativité internationale les oblige à mettre au premier plan les réformistes (Ferhat Abbas, Benkhedda), quitte à ne leur laisser qu’une façade de pouvoir. Les accords de Tripoli en 1962 consacrent cette ambiguïté qui éclate dans la crise politique de l’été 1962, qui voit arriver Ben Bella à la tête de l’État. Lors de sa première déclaration à Tunis après sa libération en 1962, celui-ci avait affirmé : « Nous sommes Arabes, Arabes, Arabes… ».
Le gouvernement Ben Bella doit affronter cette contradiction : affirmer l’arabité de l’Algérie ou assurer un développement rapide du pays. Depuis le retour de de Gaulle au pouvoir en France, l’algérianisation de l’administration a été accentuée. La crise de l’OAS a fait partir la plupart des Français qui géraient l’administration, de telle sorte que Ben Bella se retrouve avec une administration algérienne certes, mais totalement francisée, bien plus, pour laquelle l’arabe est une langue inconnue et étrangère. C’est le cas aussi pour l’enseignement, et pour la vie économique. Ben Bella se trouve en face d’une demande d’arabisation, qu’il tente de dissocier d’une demande d’islamisation : mais c’est un même courant qui les porte.
Avec le gouvernement de Boumediene, le courant plébéien, même embourgeoisé, tient les rennes du pouvoir. L’arabisation va donc être engagée vigoureusement. Toutefois comme il est impossible de se passer du français, cette langue va demeurer langue de réussite sociale. Les francisants dominants partout sont cependant constamment culpabilisés, soupçonnés d’être hizb fransa, parti de la France, domestiqués par leur culpabilité à laquelle ils ne savent pas échapper : ils doivent accepter de ce fait les mesures d’arabisation. La couche « arabisante » profite de l’arabisation pour prendre le contrôle de certains leviers de la société, notamment l’enseignement et une partie de l’administration. Mais le secteur économique lui échappe dans sa quasi-totalité.
La présidence de Chadli Bendjedid voit l’affaiblissement de l’autorité de l’État par le regain d’influence du FLN (où les partisans de l’arabisation sont majoritaires) et par le développement de la corruption (qui mine sa légitimité et favorise le développement de l’islamisme ). L’arabisation se développe sans frein, suscitant le printemps berbère, et servant de base au mouvement islamiste. Elle culmine dans la loi d’arabisation du 16 janvier 1991 qui sera plusieurs fois reportée, mais jamais abrogée.
Le régime qui suit le coup d’État de janvier 1992 va consacrer l’errance du pouvoir, la gestion désorientée du pays. Pour faire passer leur lutte contre les mouvements armés islamistes, les pouvoirs successifs manifestent une grande complaisance aux islamistes modérés qu’ils associent au pouvoir, et dont les revendications principales, outre le pouvoir sont l’arabisation et l’islamisation. De ce fait les dispositions islamiques anciennes sont maintenues (Code de la Famille de 1984), la loi sur l’arabisation est relancée le 17 décembre 1996. L’arrivée au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika marque une ouverture verbale sur la question des langues. Le président lui-même utilise le français dans ses déclarations, mais l’hostilité des deux camps ouverte par la tentative de réforme de l’enseignement en 2000-2001 l’empêche de concrétiser ses volontés de réforme s’il en eut réellement. La situation des langues est de ce fait toujours dans l’impasse en Algérie.
Principaux axes de l’histoire des langues
L’évolution de la situation linguistique est profondément imbriquée dans la vie de l’Algérie depuis l’indépendance. La colonne vertébrale en est la politique suivie dans l’enseignement, mais elle concerne tout aussi bien l’administration, l’environnement et le contexte politique. Après une première phase d’effervescence sous Ben Bella (1962-1965), l’arabisation va connaître trois rythmes sous Boumediene, marqués par les noms de Taleb Ibrahimi (1965-1970), d’Abdelhamid Mehri (1970-1977) et de Lacheraf (1977-1979). Sous la présidence Chadli, une phase sera marquée par le retour des « barbe-FLN » (1979-1984), puis par la vague islamiste (1985-1998). L’élection à la présidence de Abdelaziz Bouteflika en 1999 va susciter quelques espoirs sans répondre à des attentes contradictoires.
Ben Bella, ou l’arabisation effervescente (1962-1965)
Pour marquer sa place politique, Ben Bella avait, dès sa libération en 1962, choisi la référence arabe, en opposition aux négociateurs des accords d’Evian. Dès octobre 1962, il annonce l’enseignement de l’arabe dans les écoles : ce qui sera fait à la rentrée 1963 (10 heures d’arabe sur 30 heures par semaine), puis en 1964, l’arabisation totale de la première année primaire. Cette même rentrée voit arriver 1 000 instituteurs et institutrices égyptiens : car l’Algérie n’a pratiquement, en dehors des élèves issus des écoles coraniques, pas d’enseignants susceptibles d’enseigner cette langue. Cette arabisation improvisée se fait sans formation pédagogique, celle des enseignants orientaux étant souvent plus que problématique (certains étaient des artisans dans leur pays ), et leur parler (notamment l’égyptien) leur rend la communication difficile, voire impossible, avec leurs élèves arabes et surtout berbères. Dans le contexte algérien, leur fonction en fait des maîtres en religion, ce qui ne fait qu’aggraver la situation. A l’Université d’Alger, un Institut islamique est créé et l’ancienne licence d’arabe transformée en licence monolingue sur le modèle oriental.
Parallèlement, une forte pression est exercée par les successeurs des réformistes des années trente, menés par Tewfik el Madani, ministre des Affaires religieuses, appelant le peuple algérien à l’Islam et à la langue arabe . Ils créent dans le pays, avec l’appui du pouvoir, des Instituts islamiques, pour former des propagateurs de leur idéologie, qui seront les futurs encadreurs de l’enseignement arabisé. Leur pression est telle que Ben Bella, dans le climat des controverses suscitées par la question, est amené à dire que « l’arabisation n’est pas l’islamisation » . Si l’Assemblée intègre l’arabe dans ses travaux , une résistance importante à fondement libéral et laïque, se fait entendre par la voix des étudiants , des Kabyles , des écrivains (dont Kateb Yacine) et de la presse francophone. Une arabisation radicale représente une pure utopie pour l’élite francophone. Cette période prend fin avec le coup d’État du 19 juin 1965, qui place Boumediene au pouvoir.
Taleb Ibrahimi, et l’arabisation idéologique (1965-1970)
Sous l’impulsion du ministre de l’Éducation nationale Ahmed Taleb Ibrahimi, descendant d’un réformiste connu , l’arabisation est utilisée pour légitimer un régime impopulaire, en étant présentée comme la face culturelle de l’indépendance. Le ministre fixe les impératifs de l’enseignement : démocratisation, arabisation, orientation scientifique. La mise en place continue : arabisation de la seconde année primaire à la rentrée 1967 , création d’une section arabe à la faculté de droit en 1968 et d’une licence d’histoire en arabe . Le 5 décembre 1969, est créée une Commission nationale de réforme, chargée de préparer un projet de réforme du système éducatif : elle comporte une sous-commission de l’arabisation, présidée par Abdelhamid Mehri.
Le 26 avril 1968, une ordonnance rend obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale, à partir du 1er janvier 1971. Les fonctionnaires en place doivent acquérir pour cette date la connaissance de cette langue, et les nouveaux recrutements à cette date se feront sur cette base. Par ailleurs, les actualités dans les cinémas sont arabisées (en arabe moderne) en octobre 1967 .
Des réserves sur cette politique sont exprimées en divers lieux : chez les magistrats , dans la presse . Selon une enquête menée à cette époque par l’Université de Berkeley , 80 % des jeunes gens interrogés sont hostiles à l’arabisation de l’enseignement universitaire. En 1969, un groupe d’enseignants algériens demande, dans une lettre publiée dans un hebdomadaire, l’utilisation de la langue dialectale dans l’enseignement . En 1970, un article de Mohamed Seddik Benyahia, ministre de l’Information, va jusqu’à évoquer, à propos de cette question, « la trahison des clercs » .
Mehri et l’arabisation systématique (1970-1977)
Le remaniement ministériel du 21 juillet 1970 substitue au domaine de Taleb Ibrahimi trois ministères : l’Enseignement primaire et secondaire (Abdelkrim Benmahmoud), l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique (Mohamed Seddik Benyahia), et l’Enseignement originel et les Affaires religieuses (Mouloud Qasim). L’agent actif de l’arabisation sera Abdelhamid Mehri, secrétaire général de l’Enseignement primaire et secondaire. Il se heurtera toutefois à la barrière établie au niveau de l’Enseignement supérieur par le ministre Benyahia. Avec l’appui des arabisants réformistes ou baathistes du FLN, il manifestera une grande obstination à contourner les résistances pour mettre les Algériens en face du fait accompli d’un enseignement primaire et secondaire entièrement arabisé, et pesant de ce fait sur l’enseignement supérieur .
L’année 1971, année d’application de la réforme administrative décrétée en 1968 avait été déclarée en janvier « année de l’arabisation » . Mais plusieurs faits allaient en détourner l’attention. En janvier l’agitation des étudiants conduit à la dissolution de leur syndicat, l’UNEA, et à l’arrestation d’un grand nombre d’entre eux . Le 24 février, un nouveau front est ouvert avec la nationalisation des compagnies pétrolières et la tension internationale qui la suit. Enfin le 8 novembre est publiée l’Ordonnance « portant révolution agraire » pour la réalisation de laquelle le pouvoir allait devoir s’appuyer sur les éléments progressistes de la société, hostiles aux arabisants .
En attendant, l’arabisation continue. En avril 1971, un colloque des cadres de l’Éducation aboutit aux décisions suivantes : arabisation totale des 3° et 4° années primaires, arabisation d’un tiers de l’enseignement moyen et d’un tiers du secondaire. Mais un décret du même ministère dispensera les hauts fonctionnaires de la connaissance de la langue arabe . Au ministère de la Justice, un décret du 27 juin 1971 impose l’arabisation. A la rentrée universitaire de 1973, est supprimée la chaire de berbère tenue à l’Université d’Alger par Mouloud Mammeri.
A.Mehri expose son programme dans un article du Monde diplomatique de janvier 1972, sous le titre « La langue arabe reprend sa place ». Le 6 novembre 1973, une Commission Nationale d’Arabisation est instituée au sein du parti du FLN et présidée par Abdelkader Hadjar. Cette commission présentera en décembre 1974 un rapport sur l’état de l’arabisation. A.Mehri y traitera du bilinguisme, du rapport classique-dialecte et du caractère non-naturel du fait linguistique en Algérie…
Toutefois, la tension créée dans le pays par la mise en œuvre de la révolution agraire s’ajoute aux controverses suscitées par l’arabisation. Celles-ci aboutissent à des heurts entre étudiants, parfois violents comme en mai 1975, à Alger et à Constantine. Ces tensions sont aggravées par la tenue, du 14 au 17 mai, d’une Conférence nationale sur l’Arabisation , inaugurée par un discours important du président Boumediene . Elle est suivie d’une Conférence nationale sur la Jeunesse (19-22 mai). La pression arabisante, s’exerçant dans un sens hostile à la révolution agraire, entraînera le 16 avril 1976 une Ordonnance décidant la suppression de l’enseignement religieux et privé : dirigée en apparence contre les établissements étrangers, cette mesure vise en réalité les foyers d’endoctrinement islamique que regroupait l’Enseignement originel.
Cette année 1976 est animée par les discussions publiques proposées sur le projet de Charte nationale . Mais l’arabisation de l’environnement est poursuivie : arabisation de l’état civil , des noms de rues, des plaques d’immatriculation. Le vendredi est déclaré jour de repos hebdomadaire, à la place du dimanche . Le 10 décembre Houari Boumediene candidat unique à la présidence, est élu avec 99 % des voix : le pouvoir est apparemment à son zénith.
Lacheraf et la pause de l’arabisation
En avril 1977, à l’occasion d’un remaniement ministériel, Mostefa Lacheraf est nommé ministre de l’Éducation, et Abdellatif Rahal ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces nominations marquent une véritable pause de l’arabisation. Les raisons qui poussèrent Boumediene à ce revirement ne furent pas explicitées. Il fut sans doute sensible aux tensions provoquées à propos de la révolution agraire et de l’arabisation, et désireux de faire prévaloir l’aspect progressiste de son action. Il semble par ailleurs que des rapports inquiétants sur la situation de l’enseignement lui soient parvenus. Il est sans doute informé de la gravité de la maladie qui l’emportera fin 1978, et désireux de consolider son œuvre.
A peine installé au ministère, M. Lacheraf limoge Mehri et toute son équipe de hauts fonctionnaires. Ils iront se réfugier au parti du FLN où ils constitueront un groupe de pression redoutable. Il se défait des professeurs irakiens que Mehri tenait en réserve pour arabiser l’enseignement supérieur. Il reprend la formation d’enseignants bilingues et rétablit une section « lettres bilingues » alors que toutes les séries littéraires avaient été arabisées. De son côté, A. Rahal insistera à plusieurs reprises sur les inconvénients que présente une arabisation de l’enseignement supérieur, dans un pays où l’emploi est fortement lié à la langue française, et anglaise éventuellement.
Cette pause sera de courte durée. M.Lacheraf se livre à des polémiques dans la presse , il se heurte aux intrigues du clan arabisant fort puissant dans l’Éducation nationale et représenté au Conseil des ministres par Taleb Ibrahimi. Celui-ci se verra rappeler par Lacheraf que, étant à sa place, il avait, dans l’un des conseils des ministres des années soixante, dit à propos de l’arabisation : « Cela ne marchera pas, mais il faut la faire ! »
Malade, Boumediene n’aura plus l’énergie de soutenir son ministre, et sa mort, intervenant le 27 décembre 1978, met un terme à cette pause de l’arabisation.
Le retour des « barbe-FLN » (1979-1984)
Les Algériens nomment « barbe-FLN » les officiels du FLN de la tendance arabisante, réticente vis-à-vis de la révolution agraire, qui se rapprochèrent du courant islamiste montant, en espérant bénéficier de son dynamisme tout en conservant les avantages de leur position au sein du parti. C’est parmi eux que se comptaient les partisans les plus acharnés de l’arabisation et de l’instauration d’une société islamique.
Le colonel Chadli Bendjedid, mis en place par ses pairs à la tête de l’État, pratiqua une politique habile pour consolider son pouvoir personnel. La corruption qui éclata sous son régime, la montée de l’islamisme et, à partir de 1986, la chute des prix du pétrole, affaiblirent sa position et le conduisirent à pactiser avec les islamistes et à les utiliser pour conserver son pouvoir face à la hiérarchie militaire : ces manœuvres sont probablement à l’origine de sa démission forcée en janvier 1992. L’interruption du processus électoral en janvier 1992 amènera la présidence de Mohamed Boudiaf : son assassinat en juin de la même année en fera un bref intermède dans la politique du pays et n’en changera pas fondamentalement l’évolution
Les conditions difficiles de l’accession de Chadli Bendjedid à la présidence redonnèrent du pouvoir au Comité Central du FLN. Dans le gouvernement constitué en mars 1979, le ministre de l’Éducation est Mohamed Kharroubi, celui de l’Enseignement supérieur Abdelhaq Bererhi : le premier est un adepte forcené de l’arabisation, le second n’est plus à même d’en protéger l’enseignement supérieur. Au FLN, la présidence de la Commission de l’Éducation, de la Formation et de la Culture, d’abord assurée par Benhamouda, revient en janvier 1980 à Taleb Ibrahimi : dès février, celui-ci annoncera un plan national d’arabisation de l’administration, du secteur économique et de la recherche scientifique .
La pression sur l’arabisation avait été relancée dès novembre 1979 par la grève des étudiants arabisants : ceux-ci, ne trouvant pas d’emploi au terme de leurs études, exigeaient l’application immédiate de l’arabisation de l’administration . La grève se termine en 1980, avec la notification des décisions du Comité Central préparant une relance de l’arabisation . Cette grève coïncide avec des émeutes en Kabylie, provoquées par l’interdiction d’une conférence de Mouloud Mammeri à Tizi-Ouzou sur la poésie kabyle : d’importantes manifestations, suivies de répression, ont lieu en faveur de la langue et de la culture berbères.
Le 14 septembre 1980 est pris un arrêté « portant arabisation de la première année des sciences sociales, politiques, juridiques et économiques » applicable dès cette année. Une assemblée générale des enseignants francisants demande un report de la rentrée universitaire. Durant l’été, le FLN a poursuivi sa réorganisation en 5 commissions permanentes : l’une s’intitule « Information, culture et formation » : le président en est Abdelhamid Mehri. En décembre le Comité central fait obligation aux cadres des organisations de masse et des assemblées élues d’adhérer au FLN à partir du 1er janvier 1981 (c’est le fameux article 120, qui consacre la mainmise du parti sur la société). Le même mois est installé un Haut Conseil de la Langue Nationale, chargé du suivi et du contrôle de l’arabisation . Cette agitation du parti autour de cette question se poursuit durant toute l’année 1982, sur fond d’affrontements dans les universités, provoqués par des étudiants islamistes ou berbéristes.
Cette campagne d’arabisation est couronnée le 22 mai 1984 par l’adoption par l’Assemblée nationale d’un Code de la famille , sous la pression des « barbe-FLN » qui y voient l’application de la loi musulmane – appliquée principalement au détriment des femmes – et une occasion de s’attirer les faveurs des islamistes
Durant ce même mois de mai, l’action d’Abdelhamid Mehri trouve son couronnement : il est nommé ambassadeur à Paris. Cette nomination l’éloigne d’un terrain où il ne reste plus guère de secteurs ouvrables à l’arabisation.
La vague islamiste (1985-1998)
L’opposition violente d’islamistes conduits par Mustafa Bouyali se manifeste entre 1982 et 1987, mais un mouvement islamiste plus légaliste se constitue peu à peu et aboutira au Front Islamique du Salut (FIS) reconnu en 1989. Ce mouvement saura récupérer la révolte étudiante d’octobre 1988. Il emportera les élections communales de 1990, et les législatives de décembre 1991, dont le second tour sera annulé.
L’arabisation de l’enseignement se poursuit. En septembre 1988, le président Chadli interdit aux élèves algériens la fréquentation des établissements de la mission culturelle française : il prive ainsi l’élite algérienne de la seule possibilité qu’il lui restait de faire échapper ses enfants à l’arabisation. Par ailleurs une tentative est faite par le lobby de l’arabisation de diminuer la place de la langue française en lui substituant la langue anglaise en option à la quatrième année primaire .
Dans ce climat de déliquescence du pouvoir central, ce n’est plus l’arabisation qui prime, mais l’islamisation, la première n’étant plus qu’un adjuvant de la seconde. L’imprégnation religieuse l’avait déjà largement emporté dans l’enseignement. Celui-ci entre dans une phase de dégradation importante à partir de 1986, avec la diminution des ressources de l’État : manque de moyens de documentation et arabisation contribuent à l’effondrement de l’enseignement supérieur arabisé. Les émeutes d’octobre 1988 conduisent à une libéralisation du régime, la constitution de février 1989 instaure le multipartisme, l’abandon des références au socialisme (abolition de la révolution agraire le 5 novembre 1990).
L’Assemblée Nationale Populaire, à majorité « barbe-FLN » a voté en décembre 1990 une loi de généralisation de l’utilisation de l’arabe, rendant obligatoire l’emploi de cette langue à partir du 5 juillet 1992. Cette mesure sera reportée suite à l’épisode Boudiaf (janvier-juin 1992), pour être relancée en décembre 1996 , pour une application le 5 juillet 1998, qui s’est faite dans l’indifférence générale. Sous la pression islamiste, le noyau « barbe-FLN » s’est replié, mais il est toujours là, oriente la politique du président Liamine Zeroual qui, dans l’espoir de rallier les populations attirées par les islamistes, met en œuvre les mesures qu’ils auraient prises s’ils étaient parvenus au pouvoir : l’arabisation-islamisation en est un élément capital.
La présidence d’Abdelaziz Bouteflika : la réforme impossible
Abdelaziz Bouteflika est élu président le 15 avril 1999, au terme d’une élection contestée, puisque tous les autres candidats se sont retirés à la veille du scrutin en signe de protestation. Il tentera de remédier à cette carence de légitimité en organisant le 16 septembre un référendum sur la concorde civile. Les nombreuses déclarations faites par le nouveau président durant la campagne qui le précède suscite de grands espoirs, mais il ne semble pas avoir eu par la suite la volonté ou les moyens de conduire les réformes attendues . Fait nouveau pour un président algérien, il s’exprime en français dans certaines de ses déclarations publiques, en Algérie comme à l’étranger. Il affiche une grande liberté par rapport aux problèmes de langues, affirmant par exemple : « Il est impensable… d’étudier des sciences exactes pendant dix ans en arabe alors qu’elles peuvent l’être en un an en anglais ». Il va encore plus loin en affirmant : « Il n’y a jamais eu de problème linguistique en Algérie, juste une rivalité et des luttes pour prendre la place des cadres formés en français ! ». Si ces propos suscitent l’approbation enthousiaste d’une partie de l’opinion, exprimée dans la presse francophone, ils provoquent des réticences, puis une franche opposition de la part des milieux arabophones et islamistes, notamment le parti islamiste « modéré » Nahda de M.Nahnah. Elle est le sujet d’une lettre ouverte au président de Abdelkader Hadjar, promoteur de la politique d’arabisation au sein du FLN. L’attitude du président face à la langue berbère est bien en retrait et provoque une grande réserve à son égard en Kabylie : il propose en effet de faire trancher la reconnaissance du berbère comme langue nationale par un référendum national, ce qui lui enlèverait toutes ses chances.
L’un des projets du président est de créer une commission spécialisée pour préparer une réforme de l’enseignement, du primaire au supérieur. Une Commission Nationale de Réforme du Système Éducatif (CNRSE) est constituée en février 2000 et installée par le président le 13 mai. Elle est composée d’une centaine d’universitaires et de personnalités concernées. Elle est présidée par le professeur Hadj Salah, puis, à la suite de tensions, par le professeur Benzaghou. Les membres de la commission sont en effet divisés en deux camps, divisés principalement sur la question de la langue (places respectives de l’arabe et du français), mais aussi sur des questions annexes, comme celle de l’instruction civique ou de l’enseignement religieux. Les premières conclusions provisoires, énoncées en janvier 2001, recommandent l’enseignement du français dès la seconde année fondamentale, l’enseignement des sciences en français, la refonte des programmes d’histoire. Le courant moderniste (et francisant) est majoritaire, et reçoit l’appui ouvert du président Bouteflika, qui déclare le 26 février à Blida qu’il faut « casser les tabous » et « assurer une plus grande ouverture aux langues étrangères » tant à l’école primaire qu’à l’Université. Le 15 mars 2001, le rapport de la CNRSE est adopté à l’unanimité, mais il reste secret. Les grandes lignes en sont publiées dans la presse . Le rapport préconise notamment trois types d’école (publique, semi-publique, privée), ainsi que l’enseignement en français des mathématiques et des sciences dans le secondaire. Le 28 mars le rapport est remis officiellement au président Bouteflika, dans un climat de vive polémique. Un journal de langue arabe titre que « la commission a évité la réforme pour se noyer dans les langues ». L’opposition aux propositions de la CNRSE est conduite par Ali Ben Mohamed, ancien ministre de l’éducation. En mai, il fonde une Coordination nationale de soutien à l’école authentique et ouverte, soutenue par les leaders des partis islamistes, certains syndicats de l’Éducation nationale et des Parents d’Élèves, des associations religieuses et certains politiques, dont Abdelhamid Mehri. Le 29 juillet, dans une circulaire aux imams, le ministre des Affaires religieuses, B. Ghalamallah, s’en prend aux « partisans de la laïcité et de l’occidentalisation, formés loin de l’environnement musulman » et attribue les difficultés dans les secteurs de l’éducation, de l’administration, de la législation et de la diplomatie à l’« attachement à la langue française et à la marginalisation de la langue arabe » . Le 3 septembre, un communiqué du ministère de l’Intérieur annonce l’ajournement de la réforme du système éducatif. En février 2002, on constate que le président Bouteflika, en dépit de ses interventions publiques en faveur de l’ouverture et du multilinguisme, et de son désir de réformer l’enseignement, n’a pas engagé de réforme officielle. Mais des mesures concrètes expriment une réorientation : réintroduction du français dans certains départements universitaires arabisés, tolérance pour des écoles privées multilingues. La réouverture du lycée français d’Alger, fermé en 1994 du fait de l’insécurité, est envisagée pour la rentrée 2002. Dans le même temps, les troubles survenus en Kabylie depuis avril 2001 ont suscité dans cette population une revendication de reconnaissance du kabyle comme langue nationale à laquelle le pouvoir a promis de répondre en octobre 2001, sans qu’aucune décision officielle ne soit encore intervenue.
Interrogations et perspectives
La question des langues continue à diviser profondément les Algériens. Cette division, utilisée politiquement, empêche l’émergence d’un bilan objectif et nécessaire de la question de l’enseignement, de la formation, et du rôle qu’y tiennent les langues. Les dernières années ont vu apparaître des analyses remarquables de chercheurs algériens et une liberté d’expression sur la question qui contraste avec la langue de bois des années soixante-dix et quatre-vingt. Pour l’heure la question des langues demeure centrale dans la mesure où elle renvoie à des problèmes essentiels auxquels l’Algérie doit faire face dans les années qui viennent.
La qualité de l’enseignement et son adaptation
Deux problèmes apparaissent : l’importance de l’analphabétisme (entre 50 et 75 %), en dépit des parties importantes de budget national (entre 20 et 25 %) consacrées à l’Éducation, et d’autre part le chômage des jeunes, et notamment des diplômés. La question se pose de savoir quelle est la part de la langue d’enseignement dans cet échec. Les points de vue sont partagés : pour certains, c’est l’utilisation du français, qui lui confère un caractère élitiste, et en exclut les masses qui n’ont pas de contact social avec cette langue en dehors du maigre apport de l’école : opinion exprimée par le courant arabo-islamiste, mais aussi partagée par certains progressistes. Pour d’autres, l’échec est lié à l’arabisation : non seulement comme langue (l’arabe classique n’est pas la langue maternelle des élèves), mais aussi comme structure pédagogique répétitive, non ouverte, et de plus prisonnière d’une conception théocratique de l’islam. Les réflexions commencent depuis quelques années à s’intéresser à l’apport positif que pourrait représenter l’utilisation des langues maternelles dans le cursus scolaire, ne serait-ce que dans une phase transitoire.
La langue de la religion et la langue du pain
La langue de la réussite économique et sociale est le français. Une évolution, partiellement en cours, lui substituerait l’anglais, mais certainement pas l’arabe. C’est dans ces langues que fonctionne le secteur économique. Le rapprochement de l’Union européenne, l’ouverture économique ne feront qu’accentuer cette tendance. Aucune réforme de l’enseignement crédible ne peut se permettre d’ignorer cet aspect. Ceci ne signifie pas que la langue arabe, sous ses formes populaires ou dans sa forme classique, n’ait pas sa place. Les politiques d’arabisation se sont peut-être égarées en voulant mettre la langue arabe à la place du français, dans les mêmes fonctions, alors qu’une fonction d’ancrage identitaire, de revalorisation du passé, d’adaptation culturelle ne pouvait être bien assurée que dans cette langue : or ce dernier aspect a été généralement ignoré, et s’est vu substituer des langages idéologiques autoritaires qui n’en sauraient tenir lieu.
Sous ce double point de vue, économique et culturel, l’opposition entre les deux langues nourrie par les politiques n’a abouti qu’a créer une fracture sociale entre deux couches de populations définies par des niveaux de vie et des références culturelles de plus en plus éloignées. La question des langues est profondément impliquée dans ce fossé qui tend à se créer au sein de la société. La prise en compte quasi-exclusive des langues écrites a fait perdre de vue la réalité de la société qui s’exprime dans ses langues maternelles, et négliger l’intérêt que peut présenter la reconnaissance de parlers nationaux par rapport à la conscience d’intégration dans la nation.
Quelles orientations ?
En Algérie comme dans le reste du Maghreb se pose la question décisive du passage des populations à l’ère moderne. En chacun d’eux, ce passage n’est acquis que pour une minorité privilégiée, que son ascension conduit à se couper de plus en plus de la masse. Les politiques suivies par les pouvoirs ont envisagé l’aspect matériel, économique de cette modernisation, en considérant que la culture, l’idéologie, pourraient se maintenir à un niveau traditionnel dans le cadre de l’islam, un lieu qu’on voyait volontiers comme le repère d’une identité propre, distincte de l’acculturation occidentale. Cela a conduit à oublier que les deux aspects ne sont pas séparables, et que la culture enracinée dans la tradition maghrébine doit aussi passer à l’ère moderne, c’est-à-dire qu’elle a besoin d’être repensée dans le cadre réel où elle s’exerce. Ceci conduit à envisager l’importance de la formation comme conception globale, allant de la formation professionnelle à l’éducation de la personnalité en ses divers aspects.
Cet épanouissement des individus et des sociétés doit pour se réaliser trouver un terrain où l’homme est reconnu comme tel, dans ses droits, où il a le droit de s’exprimer, de vivre en conformité avec ses propres spécificités ethniques, linguistiques, culturelles. Ceci décrit un milieu humain où les droits de l’homme sont affirmés et reconnus, dans le cadre d’une démocratie au sens large, quelle que soit la forme constitutionnelle du régime où elle s’exerce. Or, cette situation n’est pour le moment réalisée dans aucun des trois pays du Maghreb. Certes leur situation est inégale à ce point de vue, mais la démocratie comme telle n’y a pas encore trouvé place.
Cette situation empêche ces sociétés de s’exprimer dans leurs forces vives, de participer activement à leur développement, d’accéder à une vraie maturité. Il est significatif que, en Algérie et au Maroc principalement, soient tenus à l’écart, par les pouvoirs politiques, les deux éléments les plus dynamiques : les femmes, et les langues parlées. Les femmes, dont les codes tendent à faire des mineures, sont des agents actifs de la société, comme en témoigne la place prise par les étudiantes dans les universités. Les langues maternelles, par rapport aux langues figées, témoignent d’une capacité étonnante d’adaptation à la vie moderne et tant dans le langage courant que dans les expressions culturelles (chants, théâtre) savent intégrer la modernité sans coupure avec le passé. Une observation attentive de ce qui se passe dans ces lieux de foisonnement vital serait à même de suggérer les solutions à apporter aux nombreux autres problèmes qui se posent à des sociétés jeunes, mais trop souvent bloquées.
Bibliographie
Ageron, Charles-Robert 1968. – Les Algériens musulmans et la France : 1871-1919. – Paris : Presses universitaires de France, 1968. – 2 vol.
Benrabah, Mohamed 1999. – Langue et pouvoir en Algérie : Histoire d’un traumatisme linguistique. – Paris : Séguier, 1999.
Caubet, Dominique 2000. – “L’arabe maghrébin existe-t-il ?”. – In : 2000 ans d’Algérie : Carnets Séguier. – Paris : Séguier. – 2000, nº 3, p. 173-193.
Chaker, Salem 2000. – “Berbère, le retour du marginalisé”. – In : 2000 ans d’Algérie : Carnets Séguier. – Paris : Séguier. – 2000, nº 3, p. 157-171.
Djebbari, Mohamed Benamar 1999. – Un parcours rude et bien rempli : Mémoires d’un enseignant de la vieille génération. – Oran : OPU, 1999 ; 2001. – 2 vols.
Ghettas, Cherifa 1995. – L’enfant algérien et l’apprentissage de la langue arabe à l’école fondamentale. – Grenoble III : Université Stendhal : Thèse de doctorat ronéotypée, 1995.
Grandguillaume, Gilbert 1976. – Nédroma : l’évolution d’une médina. – Leiden : Brill, 1976.
— 1980. – “Relance de l’arabisation en Algérie ?”. – In : Maghreb-Machrek. – Paris. – 1980, nº 88, p. 51-63.
— 1983. – Arabisation et politique linguistique au Maghreb. – Paris : Maisonneuve et Larose, 1983.
— 1997. – “Arabisation et démagogie en Algérie”. – In : Le Monde diplomatique. – Paris. – février 1997.
— 1999. – “Abdelaziz Bouteflika, premiers pas d’un président”. – In : Maghreb-Machrek. – Paris. – octobre-décembre 1999, nº 166, p. 109-120.
Harbi, Mohammed 1980. – Le FLN, mirage et réalité : Des origines à la prise du pouvoir (1945-1962). – Paris : Jeune Afrique, 1980.
— 2001. – Une vie debout : Mémoires politiques. – Paris : La Découverte, 2001.
Labat, Séverine 1995. – Les islamistes algériens : Entre les urnes et le maquis. – Paris : Le Seuil, 1995.
Mahé, Alain 2001. – Histoire de la Grande Kabylie : XIXe-XXe siècles. – [Saint-Denis] : Bouchène, 2001.
Meynier, Gilbert 1981. – L’Algérie révélée : La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle. – Genève : Droz, 1981.
Rouadjia, Ahmed 1990. – Les frères et la mosquée : Enquête sur le mouvement islamiste en Algérie. – Paris : Karthala, 1990.
Saadi, Rabah Noureddine 1991. – La femme et la loi en Algérie. – Casablanca : Le Fennec, 1991.
Souriau, Christiane 1975. – “La politique algérienne de l’arabisation”. – In : Annuaire de l’Afrique du Nord. – Paris. – 1975, p. 363-401.
Taleb-Ibrahimi, Khaoula 1995. – Les Algériens et leur(s) langue(s). – Alger : El Hikma, 1995.
Yahiatene, Mohamed 1997. – L’arabisation de l’enseignement supérieur en Algérie. – Grenoble III : Université Stendhal : Thèse de doctorat ronéotypée, 1997.
|
|
|